Résumé

La financiarisation de l’économie française par rapport aux autres pays n’est pas toujours facile à apprécier. Certains ratios sont indiscutables comme le poids croissant des actifs financiers dans le PIB ou le rapport aux actifs non financiers ou bien le poids des dettes dans le PIB ou dans les actifs totaux des comptes de patrimoine. Il faut dire que les dividendes et autres revenus distribués des sociétés ne sont pas faciles à évaluer, notamment ceux versés aux ménages, même si les dividendes des entreprises au CAC 40 sont connus. On observe parfois des divergences entre les séries des dividendes distribués de la Banque de France et de l’Insee. S’agissant des taux de marge (excédent brut d’exploitation / valeur ajoutée) des sociétés non financières (SNF), il n’est pas non plus facile de les comparer entre les pays de la zone Euro, l’Allemagne et l’Italie assimilant certaines entreprises individuelles (dont les taux de marge sont supérieurs), à des SNF.
Le taux de marge est un indicateur de la rentabilité des entreprises. Ce taux a été assez stable dans l’UE, oscillant autour de 40 % entre 2000 et 2020. En 2020, la part de profit la plus élevée des entreprises a été constatée en Irlande (77,6 %). Le taux le plus faible a été observé en France (31,8 %).
Le ratio dette nette/revenu des SNF montre les passifs au sein du secteur des entreprises. Il est calculé comme le passif moins l’actif en pourcentage du revenu net d’entreprise. Ce taux, qui s’élevait à 328 % dans l’UE en 2004, a atteint un pic de 406 % en 2009, puis a diminué pour atteindre 275 % en 2019. En 2020, sous l’effet de la crise du COVID-19, l’endettement a de nouveau augmenté et atteint 325 %, la deuxième plus forte augmentation annuelle depuis 2000. Ce ratio diffère fortement entre les États membres, allant en 2020 de –22 % en Estonie (une dette négative signifie qu’une entreprise a peu de dettes et plus de liquidités) et 93 % aux Pays-Bas à 713 % au Portugal, 643 % en Grèce (et 588 % en France).
S‘agissant des dividendes, ceux versés aux ménages par les SNF auraient beaucoup progressé en France entre 1984 et 2010 (+838%), plus que dans les autres pays dont on dispose des données – et surtout plus que les rémunérations versées par les SNF (+400%) et que l’excédent brut d’exploitation (+250%) – mais seulement +20% entre 2010 et 2021, soit moins vite que dans les autres pays, mais avec un niveau record en 2021-2022 -. Les dividendes versés aux SNF ont, eux, explosé entre 1984 et 2010 (+1531%) avec un très net ralentissement aussi entre 2010 et 2022. Mais ils sont trois fois plus élevés que ceux versés aux ménages. Les actions et les plans d’options sur titres ont été relativement faibles en France en comparaison des autres pays. Les ménages français préfèrent parfois des placements comme l’assurance-vie ou les autres obligations et les livrets d’épargne. Les « plus-values courantes » sont plus faibles mais ces placements sont moins risqués et facilement convertibles en liquidités. La financiarisation de l’économie française a ainsi eu lieu entre 1984 et la crise de 2009 mais pas après.
Financialisation of the French economy compared to other countries is not always easy to appreciate. Some ratios are undeniable, such as the growing weight of financial assets in GDP versus non-financial assets, the weight of debt in GDP or in total assets in balance sheets. It should be noted that dividends and other income distributed by corporate enterprises are very difficult to estimate, especially those paid to households, even if CAC 40 companies dividends are well known. In France, INSEE and Banque de France statistical data of dividends distributed sometimes diverge. As regards profit share (gross operating surplus divided by value added) of non-financial enterprises (NFCs), they are also not very comparable between countries of euro zone, Germany and Italy including many unincorporated enterprise, whose profit shares rates are higher, in the (NFCs).
The gross operating surplus as a share of their gross value added, is an indicator of businesses’ profitability. This rate has been quite stable in the EU, fluctuating around 40 % in the period 2000 to 2020. In 2020, the highest profit share of businesses was observed in Ireland (77.6 %). The lowest rates were found in France (31.8 %).
The net debt-to-income ratio of non-financial corporations shows the liabilities within the business sector. It is calculated as liabilities minus assets as a share of the net entrepreneurial income. This rate, which stood at 328 % in the EU in 2004, reached a peak of 406 % in 2009 and then decreased to reach 275 % in 2019. In 2020, as an effect of the COVID-19 crisis, indebtedness rose again and reached 325 %, the second-highest annual increase since 2000. This ratio strongly differs among the Member States, ranging in 2020 from –22 % in Estonia (a negative debt means a company has little debt and more cash) and 93 % in the Netherlands to 713 % in Portugal, 643 % in Greece (and 588 % in France).
Dividends paid to households by NFCs grew significantly in France between 1984 and 2010 (+838%), more than in the other countries for which data are available – and above all more than compensation of employees paid by NFCs (+400%) and gross operating surplus (+250%) – but only +20% between 2010 and 2021, i.e. slower than in the other countries but with a record level in 2021-2022 -. Dividends paid to NFCs exploded between 1984 and 2010 (+1531%), but with a very marked slowdown between 2010 and 2022. But they are three times higher than those paid to households. In fact, shares and stock option plans have been lower in France by comparison with other countries. French households prefer sometimes investments such as life insurance or other equities and savings funds. « Nominal capital gains » are lower but they are less risky and closer to liquidity. Thus, financialisation of French economy took place between 1984 and the 2009 crisis, but not after.
«La théorie économique justifie l’existence des marchés par leur effet positif supposé sur le bien-être collectif : ils inciteraient les offreurs à produire des biens de bonne qualité à des prix bas. Pour cette raison, et pour cette raison seulement, en tant qu’ils travaillent à l’intérêt général, les profits privés sont tolérés. Il est important de rappeler cette évidence à une époque où le profit semble être devenu une valeur absolue, bonne en elle-même. Or, si on en juge la finance de marché du point de vue de l’intérêt général, on ne peut imaginer échec plus complet.», André Orléan, Pourquoi tant de crises ? Alternatives économiques, hors série n°87, 1er trimestre 2011.
«Le pire, ce sont les semaines qui ont suivi la faillite de Lehman Brothers en septembre 2008. De ces expériences qui amènent à réfléchir. Sur le fait, par exemple, que la finance est un moyen et pas une fin. » Joseph Stiglitz, interviewé par Jean-Gabriel Fredet à propos de la crise dans Challenges, 27 août 2009
I – COMMENT MESURER LA FINANCIARISATION ?
II – LES COMPTES DES SOCIÉTÉS NON FINANCIÈRES (SNF)
III – DÉLICATE MESURE DES DIVIDENDES EN EUROPE
IV – À QUI APPARTIENNENT LES SOCIÉTÉS COTÉES EN BOURSE ?
V -COMPARABILITÉ DIFFICILE DES TAUX DE MARGE DES SNF EN EUROPE
VI – LES REVENUS DISTRIBUÉS REÇUS PAR LES SNF IMPORTANTS EN FRANCE
VII – VALEUR AJOUTÉE, ÉPARGNE, INVESTISSEMENT DES SNF EN FRANCE
VIII – LES RATIOS DES SNF EN EUROPE DEPUIS LA CRISE DE 2009
IX – RENTABILITÉ ET EFFET DE LEVIER DES SNF EN EUROPE
X – STRUCTURE DES ENTREPRISES EN FRANCE ET DANS L’UE
Résumé
° Existe-t-il un lien entre désindustrialisation et financiarisation? Les placements financiers des entreprises (achat d’actions, de produits dérivés), les dividendes versés, qui s’envolent avant la crise de 2009, ont-ils eu pour effet de ralentir l’investissement de celles-ci ? Ou bien cette relation n’existe-t-elle pas vraiment? L’essor des marchés financiers dans les années 1980 s’est accompagné d’une envolée des taux de marge des sociétés non financières. Mais depuis une vingtaine d’année ces taux de marge sont inférieurs en France à ceux des autres pays même si les taux de l’Allemagne et l’Italie en étant corrigés pour permettre des comparaisons, se rapprochent du taux français.
° Le nouveau capitalisme financier donnerait davantage aux investisseurs la possibilité de « sortir » du capital des entreprises dans lesquelles ils investissent. A chaque instant, ils pourraient arbitrer, à peu de frais, entre continuer d’investir dans la même entreprise ou redéployer leurs capitaux dans une autre firme qui peut se trouver dans un autre pays. Dotés d’une meilleure « option de sortie », les investisseurs pourraient exiger une plus grosse part du « gâteau ».
° Cette financiarisation accaparerait une partie du bénéfice qui pourrait être réinvesti et accaparerait aussi de l’énergie. Des gens travaillent sur ces gains financiers potentiels au lieu de produire. Ils capteraient une partie de la valeur ajoutée.
° La financiarisation aurait de multiples facettes : achats d’actions sous forme spéculative (fonds spéculatifs), puis revente éventuelle de l’entreprise après un assainissement financier; achats d’actions des ménages en espérant faire des gains, achats d’actions de sa propre entreprise pour faine augmenter le cours des actions restantes et éviter une OPA, rachat d une entreprise pour s’agrandir (croissance externe). Les fondateurs des entreprises du GAFA rachètent ainsi d’autres d’entreprises, notamment celles innovantes dans leur domaine (nouvelles technologies) pour éviter la concurrence. D’autres entreprises se diversifient en rachetant des entreprises, afin de ne pas être sur un seul marché.
° Bref la financiarisation est un phénomène complexe à étudier à partir des comparaisons internationales. Elle est certes mondiale mais prend des formes spécifiques à chaque pays.
1/ La globalisation financière ou financiarisation de la finance
° Pour l’économiste M. Aglietta, la globalisation financière « est le nom donné à des transformations qui ont affecté les principes de fonctionnement de la finance. Ce sont des transformations très profondes qui associent étroitement la libéralisation des systèmes financiers nationaux et l’intégration internationale » [1] (les nombres entre crochet renvoient à la bibliographie en bas de page).
° « La globalisation financière résulterait de trois phénomènes : les réformes qui ont transformé le monde de la finance, les innovations technologiques et l’apparition de nouveaux instruments financiers« .
a) Les réformes qui ont transformé le monde de la finance pour le libéraliser
« La globalisation financière s’explique principalement par l’expression « 3 D » ou la théorie des « 3D » : dérèglementation, désintermédiation et décloisonnement. Cette expression a été inventée par H. Bourguinat dans son ouvrage « Les vertiges de la finance internationale » (1987).
b) Les TIC et la globalisation financière : première condition de la financiarisation
« Les technologies de l’information et de la communication (TIC) ont puissamment contribué à la globalisation financière par trois séries d’effets : l’accélération de la circulation de l’information à l’échelle de la planète, la mise en réseau des entreprises au niveau mondial et le développement de l’économie immatérielle et virtuelle non localisée, et par conséquent difficile à contrôler comme les paradis fiscaux par exemple ». De 1980 à 1998, l’indice des valeurs boursières du Dow Jones a été étroitement lié à l’investissement dans les technologies de l’information.
c) Les innovations financières : seconde condition de la financiarisation
« Avec la libéralisation des marchés financiers et la globalisation, on a assisté à l’émergence de nouveaux instruments de placement et d’emprunt avec souvent des taux d’intérêt variables comme avant et pendant la crise des subprimes. Les innovations financières contribuent à la diversification de l’offre de produits financiers (obligation à taux variable dont le taux est indexé sur le Libor, dérivé de crédit, échange de défaillance/Credit Default Swap, etc.) et à une distribution plus équilibrée des risques. Cela étant, la crise des subprimes de 2008 aurait montré les limites de la titrisation et des techniques de transfert de risque ».
° En 1973, on met au point une formule permettant de calculer le prix d’une option. Ils fournissent ainsi aux opérateurs l’instrument qui leur manquait pour confectionner plus facilement des produits de couverture des risques, ouvrant la voie à la croissance explosive des marchés de produits dérivés. À partir des années 1990, la titrisation massive des actifs financiers (pour transformer des dettes en actifs) permet aussi aux banques de se délester des risques associés à leurs énormes portefeuilles de crédits, en les segmentant pour les revendre sous forme de nouveaux titres représentant des composantes variables de risque. Cette innovation financière, jumelée à la globalisation des marchés financiers, a eu pour effet d’augmenter la spéculation et donc de créer encore plus d’instabilité. Dans ce mécanisme, les banques prennent de l’importance. Plus les banques prennent de l’importance, plus elles demandent des libertés, moins elles prennent de précaution.
° La déréglementation financière des années 1980 précède l’émergence et l’épanouissement des TIC mais l’espace ainsi ouvert à la concurrence et à l’expérimentation débouche sur de nouveaux instruments et de nouvelles pratiques financières. L’intermédiation financière cède la place à la titrisation et à la montée en régime d’une désintermédiation qui concerne d’abord les grandes entreprises mais qui grâce à divers innovations s »applique ensuite aux jeunes pousses des secteurs de la haute technologie. La finance enregistre ainsi une accélération importante de la productivité car l’information est au cœur de l’activité d’intermédiation financière.
° Ainsi la financiarisation se voit d’abord au formidable essor de l’industrie financière depuis le début des années 1980, concomitamment au développement de nouveaux acteurs à la taille impressionnante (fonds de pension, hedge funds, fonds d’investissement…). La numérisation et la mondialisation y jouent un rôle essentiel. Et quel meilleur signe de la financiarisation des économies, que la croyance d’un lien entre santé des marchés et santé de l’économie, pourtant très discutable. Les agences de notations sont à l’affût du respect des critères de convergence de la zone Euro. Mais leur surveillance n’a-t-elle pas trop centré la politique économique sur les questions financières, développées dans les manuels internationaux du SCN 2008 et du SEC 2010, au détriment d’autres aspects (désindustrialisation, déficit extérieur, transition énergétique, systèmes de soin et d’éducation, etc…) ?
2/ De la financiarisation des années 1920 …
° Malgré les conclusions de J.K. Galbraith dans son livre « la crise économique de 1929 », – qui ne prévoyait pas de crises d’une telle ampleur dans le futur – , que de ressemblances mais aussi certaines différences entre la crise des années 30 et celle de 2008 : durant la décennie 1920-1930 il y a de multiples innovations financières et une financiarisation de l’économie américaine comme avant 2008 : développement des holdings de sociétés, des fonds d’investissement au Royaume-Uni puis aux États-Unis.
° En 1929, la bulle spéculative est amplifiée par le nouveau système d’achat à crédit d’actions nommé le call loan (« emprunt à appel »), qui est permis comme pour les terres agricoles de la Floride dès 1925. C’est l’accroissement phénoménal des affaires sur marges ; il suffisait au spéculateur d’un droit d’achat de 10 % du prix des actions pour en percevoir les plus-values : pour dix dollars achetés, les investisseurs ne déposent qu’un dollar, quitte à revendre ensuite l’option au prix payé plus le total intégral de l’augmentation. D’ailleurs, avec la crise d’octobre 1929, les banques en augmentant ces droits jusqu’à 50% ou plus ont accentué la crise (baisse du cours des actions) en empêchant des investisseurs d’en acheter .
° Autre innovation de la financiarisation des années 20, le levier. comme le mentionne J.K. Galbraith. « Vers l’été 1929, on ne parlait plus des sociétés d’investissement en tant que telles : on parlait des sociétés à grand levier, à petit levier ou sans levier du tout. Si les actions ordinaires de la société qui avaient si miraculeusement augmenté en volume étaient détenues par une autre société ayant un levier semblable, les actions ordinaires de cette autre société connaîtraient une augmentation d’entre 700 et 800% par rapport à l’avance originelle de 50 % …. et ainsi de suite. Il y eut une ruée pour fonder des sociétés d’investissement qui en fonderaient d’autres qui à leur tour en fonderaient de nouvelles » .
° À cette financiarisation s’ajoute l’endettement excessif que connaît l’Amérique en 1929. L’économie américaine avait connu une décennie de croissance en partie basée sur l’endettement. Le surendettement des ménages et des entreprises, y compris pour acheter des actions et autres produits financiers, s’est traduit par des effets de levier dangereux. La crise provoque une incapacité des agents économiques à rembourser leurs emprunts, ce qui cause des faillites en série tant des ménages que des entreprises, dont des banques. Le principe est le suivant : dans le cadre d’un investissement locatif, le propriétaire a un apport personnel de 20% et réalise un emprunt de 80% du montant du bien immobilier. Le levier calculé est de 4 (80/20). L’effet de levier est positif si le bien est loué et que le loyer perçu est plus élevé que le remboursement du prêt immobilier. En revanche, si le bien n’est pas loué, ou si les prix s’effondrent, alors le coût des charges est supérieur aux bénéfices. L’effet de levier est négatif pour le propriétaire.
3/ … à la financiarisation des années 1980
° L’influence de la finance sur l’activité économique, malgré des crises régulières, est longtemps restée relativement cantonnée. En Europe, les marchés étaient de faible taille et très cloisonnés et le secteur financier relativement peu développé. Aux États-Unis, une série de règles héritées de la crise de 1929 limitait son développement . À la fin des années 1970 s’ouvre une nouvelle ère : les marchés supplantent la banque commerciale traditionnelle dans son rôle de principal financeur de l’économie. Subitement, ils deviennent omniprésents dans la vie économique et politique.
° À partir de 1971, la fin de la convertibilité or-dollar donne une nouvelle volatilité aux marchés des changes et des taux d’intérêt. Les entreprises ont besoin de couvrir ces risques nouveaux, avec une forte demande d’assurance adressée au secteur financier. Ce sera la cause première du développement très rapide des activités sur produits dérivés, originellement centrés sur la couverture de la volatilité des prix des matières premières.
° Sous l’influence de l’école de Chicago (Milton Friedman) et d’une croyance aveugle en la capacité des marchés à s’autoréguler, R. Reagan et M. Thatcher enclenchent au début des années 1980 un grand mouvement de dérégulation, qui remet en cause tous les cloisonnements hérités de la crise de 1929. Les marchés s’imposent au détriment des banques, dans un grand mouvement de « désintermédiation ». L’influence de l’État recule. Les frontières entre les métiers financiers s’estompent (banque-assurance). Un important mouvement de restructuration des acteurs se développe : le modèle de la banque commerciale traditionnelle s’efface au profit de grands conglomérats financiers, qui offrent désormais dans le monde entier l’ensemble des services de banque et d’assurance.
° De nouveaux besoins apparaissent. Ils sont d’abord le fait des États, qui voient leur endettement exploser et ne peuvent plus recourir à leur banque centrale pour se financer par la planche à billets. Les États sont alors passés d’un mode de financement de leurs déficits par la planche à billet (l’émission de monnaie) à un financement sur les marchés financiers (par l’émission d’obligations). Depuis, les taux d’intérêt en vigueur pour une économie sont déterminés par l’offre et la demande de titres obligataires. Dans les années 1980 s’est amorcé aussi un mouvement de libéralisation des taux d’intérêt. C’est la financiarisation totale.
° Ainsi la loi du 3 janvier 1973 sur la Banque de France est une loi qui modifie le statut de la Banque de France et précise notamment les conditions autorisant l’État à emprunter à celle-ci (financement monétaire) : principe de contrôle et de limitation sur la capacité du Trésor d’emprunter auprès d’elle. « Les conditions dans lesquelles l’État peut obtenir de la Banque des avances et des prêts sont fixées par des conventions passées entre le ministre de l’économie et des finances et le gouverneur, autorisé par libération du conseil général. Ces conventions doivent être approuvées par le Parlement ». D’un point de vue strictement juridique, la loi de 1973 ne présentait pas de forte rupture par rapport à ce qui préexistait : ainsi, l’article 25 de la loi de 73-7 du 3 janvier 1973 dispose : « le Trésor public ne peut être présentateur de ses propres effets à l’escompte de la Banque de France ». En outre, l’endettement de l’État auprès des particuliers existait déjà avant 1973, et ce à des taux également élevés (emprunt Pinay au taux de 3,5 %, etc.).
° Toutefois cette loi n’a pas mis fin au financement de l’État par la Banque de France. En 1983 le financement du déficit budgétaire était encore majoritairement effectué par la elle. Ce n’est qu’en 1984 que le véritable tournant historique a lieu, avec un recours majoritaire au marché, sous l’influence des idées monétaristes, et dans un contexte plus vaste de libéralisation des marchés financiers. Même si toute date est approximative n‘est-ce pas le début de la financiarisation en France ? La crise actuelle des dettes souveraines en Europe serait d’abord une crise liée à l’ampleur des mouvements spéculatifs et la régulation insuffisante du système financier.
° De leur coté, les entreprises se sont aussi endettées pour financer leurs investissement avec la baisse des taux d’intérêt. L’idée se propage volontiers chez les gestionnaires des entreprises et surtout de leurs actionnaires qu’une organisation doit « optimiser » le montant de capitaux propres qu’elle détient ou auxquels elle doit faire appel. Cette ressource étant rare et coûteuse, sa rentabilité doit être maximisée selon le mécanisme de l’effet de levier pour pouvoir intéresser les détenteurs actuels (pour qu’ils restent fidèles) et les éventuels apporteurs (pour qu’ils soient intéressés). Cette pratique conduit donc à privilégier le financement par la dette plutôt que par l’augmentation de capital (financiarisation). Pour expliquer cette optimisation de la rentabilité des fonds propres, quitte à la simplifier, on peut dire que le même bénéfice (en réalité amputé des frais financiers dus à la dette supplémentaire), rapporté à moins de capitaux propres, double la rentabilité de ceux utilisés. C’est l’« effet de levier financier ». On peut le définir par la proportion dette / fonds propres.
° Tout se mesure désormais en « valeur de marché » à partir des années 1980-90. Tout a un prix et doit être rentabilisé. Avec cette financiarisation effrénée surtout aux États-Unis, aucun champ ne paraît exclu de la finance de marché : des produits dérivés assurent contre les risques climatiques, des obligations voient leur rendement indexé sur les catastrophes naturelles… La financiarisation s’étend au secteur social, avec la création des « social bonds », des obligations dont la rémunération dépend de l’impact social de l’investissement. Le champ géographique de la finance devient à l’échelle de la planète.
° Enfin, dans le contexte de l’idéologie néolibérale, la financiarisation – aux côtés de la déréglementation, de la privatisation et de la marchandisation – a suscité l’émergence de l’idée « sacro-sainte » de l’efficience de tous les marchés, au-delà des marchés financiers eux-mêmes. Et cette hypothèse d’efficience aurait trouvé, et possède encore, un symétrique dans la « nouvelle gestion du secteur public » (new public management) concernant le rôle de l’État dans la prestation des services dans lesquels le secteur privé n’a pas encore suffisamment pénétré. En parallèle, la Commission Européenne n’a cessé de prôner la libre concurrence sur les marchés des produits : énergie, transports, services,…
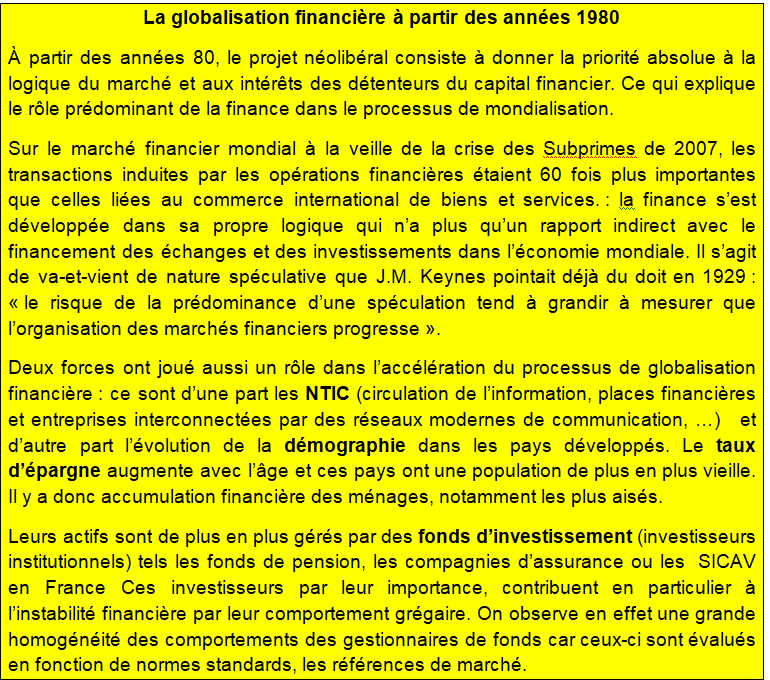
4/ Comment mesurer la financiarisation à partir des comptes nationaux ?
° La financiarisation peut être mesurée à partir de plusieurs caractéristiques notamment aux États-Unis et dans les pays anglo-saxons. La financiarisation de l’économie s’explique d’abord par la multiplication exponentielle des types d’actifs financiers et un développement spectaculaire de la pratique des opérations financières tant par les entreprises et autres institutions que par les particuliers. Les actifs financiers nets rapportés au produit intérieur net (PIN) ont été multipliés par 4 en France entre 1969 et 2019. Ce développement a mis en évidence l’essor du capital financier débordant la notion plus étroite de capital productif exclusivement centré sur les investissements en équipements de production.
° En second lieu, la financiarisation se caractérise non seulement par l’expansion et la prolifération des actifs financiers, mais aussi par le fait qu’elle s’est réalisée au détriment de l’économie réelle, en termes de niveau et d’efficacité des investissements. La financiarisation ce serait donc plutôt le fait d’acheter des actions que de faire un investissement productif. En France, les achats d’actions par les entreprises voire les ménages ont connu un bond prodigieux entre 1984 et 2010.
° Ensuite, la financiarisation a été imputée aux divers booms tirés par la consommation et fondés sur le crédit aux États-Unis. Le marché du logement y fut, en particulier, à l’origine d’un mouvement de spéculation. Aussi longtemps que la bulle immobilière put gonfler, il en alla de même du crédit aux consommateurs et de leurs dépenses. Mais elle éclata finalement à cause de sa taille excessive et de la vente des crédits hypothécaires subprime au-delà de la capacité de remboursement des emprunteurs, ainsi que de l’incapacité à maintenir la croissance du prix des logements.
° Le crédit hypothécaire n’est qu’un aspect de la financiarisation, mais il occupe un rôle symbolique en ce qu’il représente la pénétration générale de la finance dans des domaines de plus en plus nombreux de la vie économique et sociale, comme les retraites, l’éducation, la santé et les infrastructures économiques et sociales. Il s’agit ici tant de l’entrée du secteur privé dans de telles activités aux dépens du secteur public que de la nécessité pour les consommateurs de recourir au crédit pour pouvoir acheter les services correspondants.
5/ De la difficulté des comparaisons spatiales et temporelles de la financiarisation
° La financiarisation est un problème aux facettes multiples, qui attire particulièrement les économistes, mais auquel il leur est impossible d’apporter une vision définitive, parce que les comparaisons internationales leurs échappent dans la mesure où les concepts (taux de marges, dividendes,..) font l’objet de mesures parfois différentes selon les pays, notamment dans la Zone Euro. Il ne suffit pas en effet dans le cas de ces variables comme dans beaucoup d’autres, de relever avec soin les données des bases internationales puis de les modifier en tenant compte de travaux antérieurs qui ça ou là ont par exemple montré des différences de classement des unités de secteurs institutionnelles, puis de les confronter. Si le travail d’investigation achevé, l’économiste se contente d’élaborer une interprétation vraisemblable à partir de corrections de certaines données, il ne fait que de l’économie approximative quelque soit les méthodes utilisées à partir de recoupements et d’hypothèses ; mais celle-ci sera peut être plus vraisemblable que celle issue des données brutes.
° Puis l’économiste, qui veut résoudre ce problème de comparabilité entre les pays, peut courir un autre risque, c’est d’accommoder inconsciemment les indicateurs que les sources lui fournissent, une fois les chiffres modifiés, à la conception personnelle qu’il s’est faite « à priori » de la réalité économique à partir de la lecture d’autres documents sur cette même comparabilité (encadré suivant). Ainsi ne réussit-il pas à convaincre tous ceux qui le lisent, et d‘autres économistes viennent après lui, qui opposent hypothèse à hypothèse, sous le prétexte qu’ils ont découvert dans les données quelques erreurs inaperçues avant eux ou qu’ils prétendent avoir poursuivi leur enquête avec plus de soin ou plus d’impartialité que leurs devanciers. Le résultat – il en est tout particulièrement dans le cas de la financiarisation de l’économie – c’est l’extrême abondance de littérature économique.
° Les comparaisons des dividendes et des marges entre pays sont délicates mais possibles moyennant certains calculs. En Allemagne, le montant des dividendes nets versés par les sociétés en capital situées sur le territoire national n’est pas connu. Ce sont les revenus distribués des sociétés qui sont connus mais ils incluent les prélèvements sur les revenus des quasi-sociétés. Autre exemple, la présence au sein des sociétés non financières (SNF) des quasi-sociétés voire de certaines entreprises individuelles en Allemagne et en Italie conduit à gonfler l’excédent brut d’exploitation (EBE) des SNF dans ces 2 pays. On peut estimer qu’une part très substantielle de l’écart des taux de marge (EBE/VA) des SNF entre la France et ces 2 pays – de l’ordre de 4 à 5 points – est attribuable à la présence de non-salariés dans le champ des SNF allemandes et italiennes. Voici pourquoi il faut trouver des méthodes de comparabilité des taux de marge des SNF.
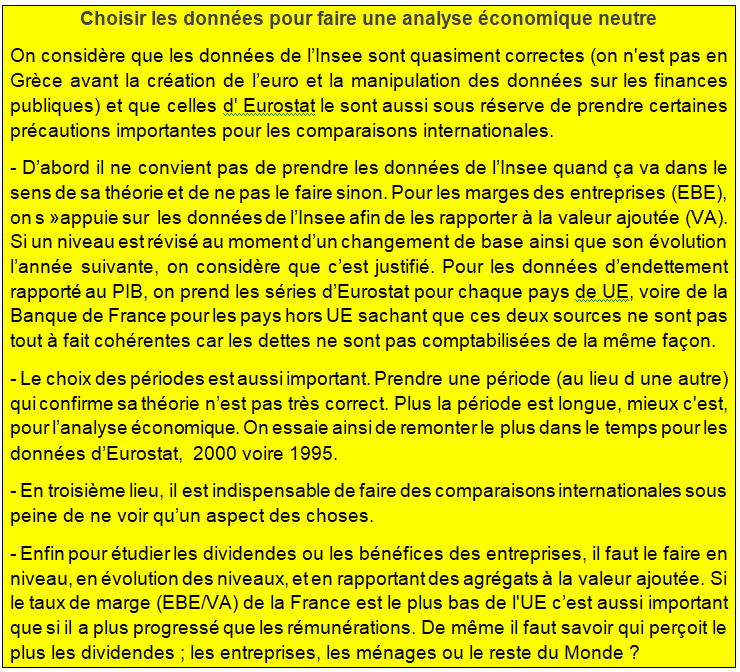
Le mouvement dit de la financiarisation de l’économie pointe la part croissante des activités financières (services de banque, d’assurance et de placements) dans le PIB. La financiarisation de l’économie consiste dans le primat des intérêts financiers sur les intérêts industriels [3]. Aujourd’hui on parle ainsi de la financiarisation de l’agriculture (les cours du blé dont déterminés sur les marchés mondiaux de cotation), de la financiarisation de l’eau (cette ressource tend à avoir un prix déterminé en fonction de sa rareté par des entreprises cotées en bourse comme en Australie).
1/ Un premier ratio de la financiarisation : le poids des actifs financiers dans le PIB
La financiarisation s’est accompagnée d’une «hypertrophie de la finance désignant le poids – et par conséquent l’influence – qu’ont acquis les grandes organisations du secteur financier que sont notamment les banques systémiques et les fonds d’investissement . Au Canada, on observe une croissance phénoménale des actifs financiers en circulation depuis les années 1970, parmi lesquels figurent notamment les devises, les prêts, les hypothèques, les obligations et les actions. En effet, la valeur des actifs financiers est passée au Canada de 405 % du PIB en 1970 à 866 % en 2011, comme on peut le voir au graphique suivant. En comparaison, les actifs non financiers, parmi lesquels on compte entre autres les immeubles, les biens de consommation durables, les terrains, les machines et le matériel, représentent bon an mal an depuis 1970 environ 360 % du PIB. À en croire les données du nouveau système de comptabilité nationale, ces chiffres seraient même beaucoup plus élevés. Le poids des actifs financiers aurait atteint 1436 % du PIB au 1er trimestre de 2020, contre 510 % du PIB pour les actifs non financiers.
La financiarisation au Canada : actifs financiers et actifs non financiers en pourcentage du PIB, 1970-2011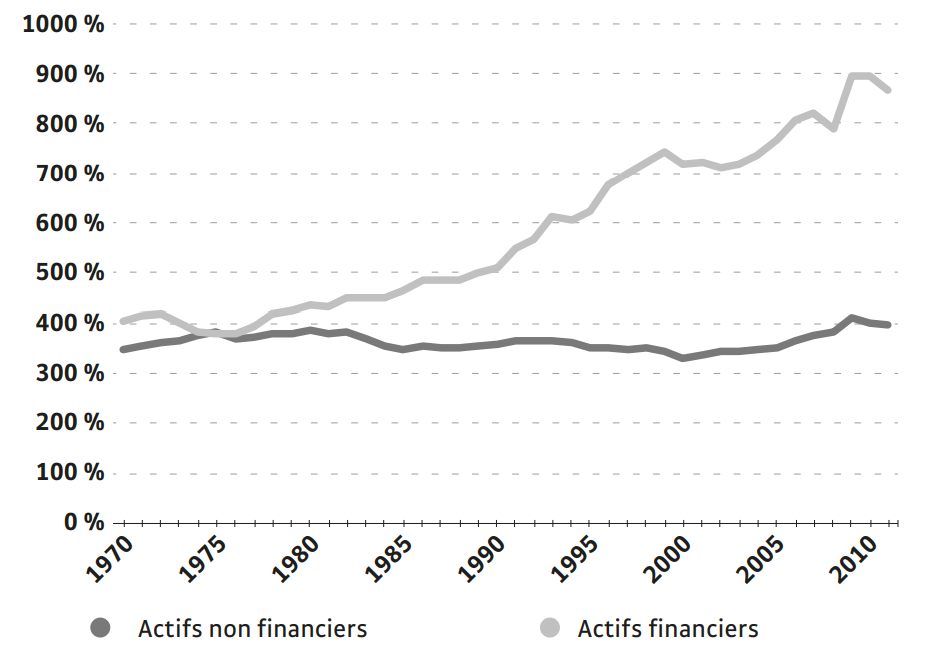
Source : Statistics Canada
Cette financiarisation est mondiale même si elle est d’une ampleur variable selon les pays. Le graphique suivant est le même que le précédent pour la France. Il présente les évolutions, rapportées au PIB, des actifs non financiers et financiers (croissance continue de la financiarisation de l’économie). En 2020 les actifs financiers représentent 16 fois le PIB. Les actifs non financiers en représentent 7,8 fois le PIB.
Le produit intérieur brut est égal à la somme des valeurs ajoutées nouvellement créées par les unités productrices résidentes au cours d’une période donnée, évaluées aux prix du marché (voir page Le PIB).
Le produit intérieur net (PIN) s’obtient en déduisant du PIB la consommation de capital fixe, qui correspond au coût d’usure du capital au cours de la même période. Il en est de même pour le revenu disponible net par rapport au revenu disponible brut.
Il est plus pertinent de comparer le stock de patrimoine avec des flux macroéconomiques nets plutôt qu’avec des flux bruts. En effet, le patrimoine est lui-même un stock net, qui tient compte de l’état d’usure et d’obsolescence du capital. On a choisi ici de le comparer au PIB pour simplifier et comparer au graphique du Canada. Dans la page Comptes financiers et non financiers, le patrimoine est comparé au PIN.
La financiarisation de l’économie française : actifs financiers et non financiers rapportés au PIB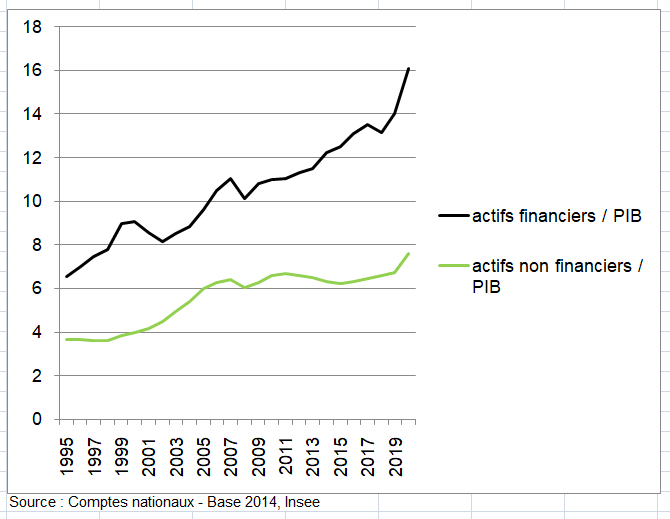
Le graphique du Canada était auparavant disponible dans les comptes français entre 1960 et 2017. La divergence des 2 courbes (actifs financiers / PIB) et (actifs non financiers / PIB) au début des années 80 était très marquée. Cette divergence se ralentit un peu à partir du milieu des années 90. En 1995, les AF représentent 6,5 fois le PIB quand les ANF en représentent autour de 4 commençant à progresser au début des années 2000. En 2017, ces ratios sont respectivement de 16 et 8. Mais en 1981, au début de la financiarisation ils étaient quasiment égaux autour de 4 fois le PIB sans avoir beaucoup changé durant la décennie 70.
Cette financiarisation concerne surtout les sociétés. Le graphique suivant montre le rapport entre actifs financiers pour le total de l’économie, les sociétés financières (SNF) et non financières (SF), et les ménages. On observe que les actifs financiers représentent un peu plus du double des actifs non financiers. Le ratio entre les deux a légèrement progressé de 1,8 en 1995 à 2,1 en 2020. Malgré un retournement au début des années 2000, ce ratio ne cesse de progresser pour les SNF et les SF. Pour les sociétés, les actifs financiers sont presque 5 fois supérieurs aux actifs non financiers. En fait ce ratio est 2,1 fois supérieur pour les SNF (soit comme pour l’ensemble de l’économie) et 47 fois supérieur pour les SF.
Ce n’est pas le cas pour les ménages français qui investissent beaucoup dans l’immobilier et dont les prix en forte hausse ont permis aux actifs non financiers de progresser plus vite que les actifs financiers entre 1995 et 2020. Leurs actifs non-financiers sont supérieurs à leurs actifs financiers (encadré ci-dessous). Selon une étude de l’Insee, le patrimoine brut des ménages est principalement constitué de biens immobiliers en 2021, dont la part est stable depuis 2004 (62 %). Les ménages les mieux dotés détiennent des types d’actif plus variés comme le compte d’épargne logement, salariale ou retraite, les assurances-vie, les valeurs mobilières. Les 10 % les moins dotés en patrimoine financier en possèdent au maximum 400 euros, tandis que les 10 % les mieux dotés possèdent au moins 150 000 euros, soit 344 fois plus.
Actifs financiers rapportés aux actifs non financiers par secteurs institutionnels 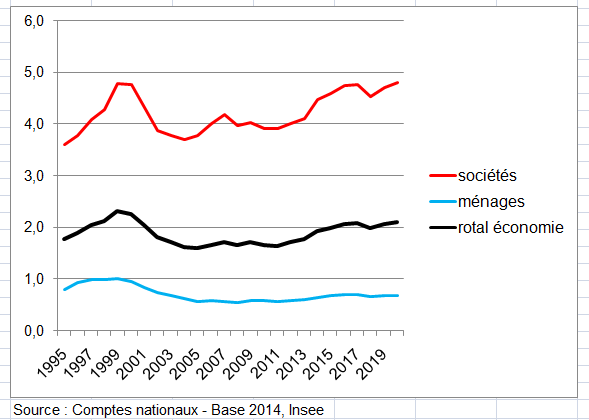
Mais la financiarisation des ménages est aussi variable selon les pays. Un ratio d’Eurostat rapporte le taux des actifs financiers nets des ménages (BF90/(B6G+D8net)) où BF90 est la valeur nette des actifs financiers (actifs – passifs), B6G le revenu disponible brut, D8net le solde des ajustements pour droits à pension. Outre les logements, une autre composante de la richesse des ménages est leurs actifs financiers (actions, obligations, dépôts, etc.). Le ratio des actifs financiers nets des ménages représente ainsi l’accumulation d’actifs financiers, après déduction des passifs, des ménages en proportion de leur revenu annuel. Ce ratio ne tient pas compte des actifs non financiers tels que les logements.
Après avoir fluctué autour de 200 % dans l’UE depuis 2001, le ratio n’a cessé d’augmenter depuis 2012 pour atteindre 253 % en 2017, après quoi il est tombé à 241 % en 2018 pour passer à 276 % en 2020. Le taux varie considérablement d’un État membre à l’autre, allant de 81 % en Slovaquie, 118 % en Pologne et 122 % en Lettonie à 521 % au Danemark, 500 % aux Pays-Bas, 476 % en Suède et 403 % en Belgique avec une croissance spectaculaire dans ces pays depuis 2000. Il est de 280% en France en 2020 (166% en 1995). La progression est proche de celle de l’Italie et du Royaume-Uni avec des ratios plus élevés dans ces deux pays. Leurs niveaux sont plus faibles en Espagne, Allemagne et Autriche (et dans les pays de l’Est de l’UE).
Taux des actifs financiers nets des ménages (valeur nette des actifs financiers/Revenu disponible brut) en %: la financiarisation en Europe

Taux des actifs financiers nets des ménages (valeur nette des actifs financiers/Revenu disponible brut) en %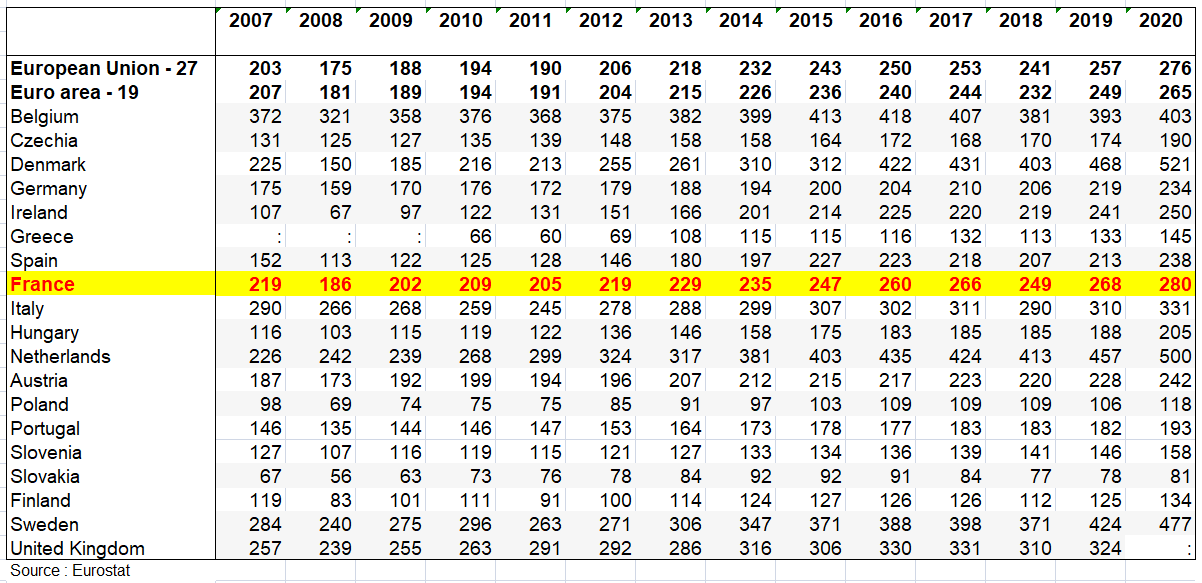
En pourcentage du RDB, la part des actifs financiers nets est légèrement supérieure en France que dans l’UE. Le graphique suivant présente les actifs nets des passifs financiers des ménages en pourcentage du PIB. En 2021, les actifs étaient évalués dans l’UE à 240,9 % du PIB, tandis que ces passifs étaient évalués à 62,6 %, ce qui se traduisait par des actifs nets équivalant à 178,3 % du PIB. En France ce ratio était de 187,1% soit un peu supérieur comme le pourcentage des actifs financiers nets des ménages/Revenu disponible brut.
Dans tous les États membres de l’UE, la valeur des actifs financiers des ménages en 2021 était supérieure à celle des passifs. En Finlande, les actifs financiers des ménages étaient 2,1 fois plus élevés que leurs passifs, soit le ratio le plus bas parmi les États membres de l’UE. Ailleurs, les actifs financiers étaient au moins 3,0 fois plus élevés dans 21 États membres et au moins 4,0 fois plus élevés dans sept États membres. Ce ratio était le plus élevé en Bulgarie (5,8 fois plus élevé), en Hongrie (5,9 fois plus élevé) et en Italie (6,0 fois plus élevé).
Actifs net (des passifs financiers) des ménages en pourcentage du PIB, 2021, (%)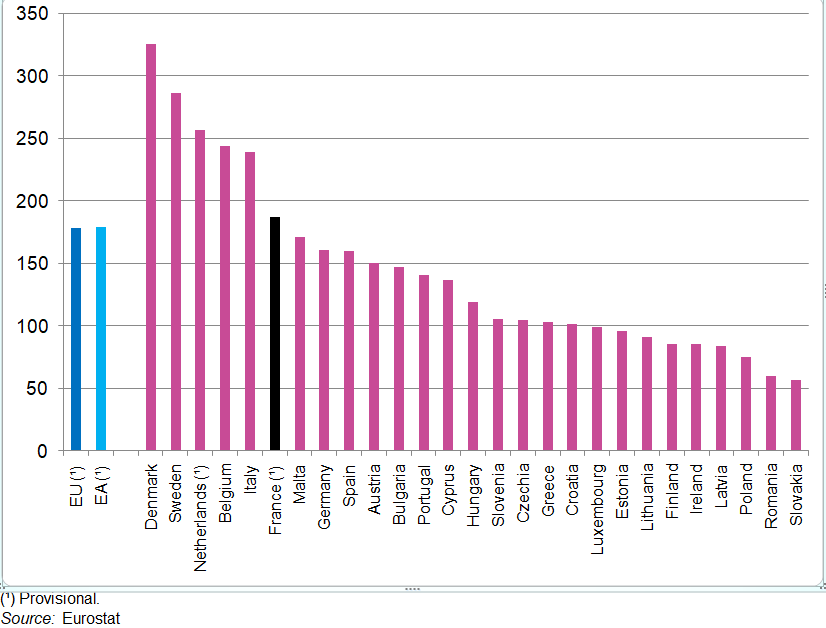
Sur le total des actifs financiers des ménages de l’UE en 2021, les actions et les parts de fonds d’investissement représentaient la part la plus importante (32,9 %) (graphique suivant). Viennent ensuite le numéraire et les dépôts (31,6 %) et les assurances, pensions et garanties standardisées (31,1 %). Des parts plus faibles ont été enregistrées pour les autres comptes à recevoir/à payer (2,5 %), les autres instruments (1,6 %) et les prêts (0,3 %).
Parmi les États membres de l’UE, les principaux types d’actifs détenus par les ménages en 2021 étaient généralement le numéraire et les dépôts, les actions et les parts de fonds d’investissement, et d’autres instruments.
Part du type d’actifs des ménages, 2021, (part en % du total des actifs financiers des ménages)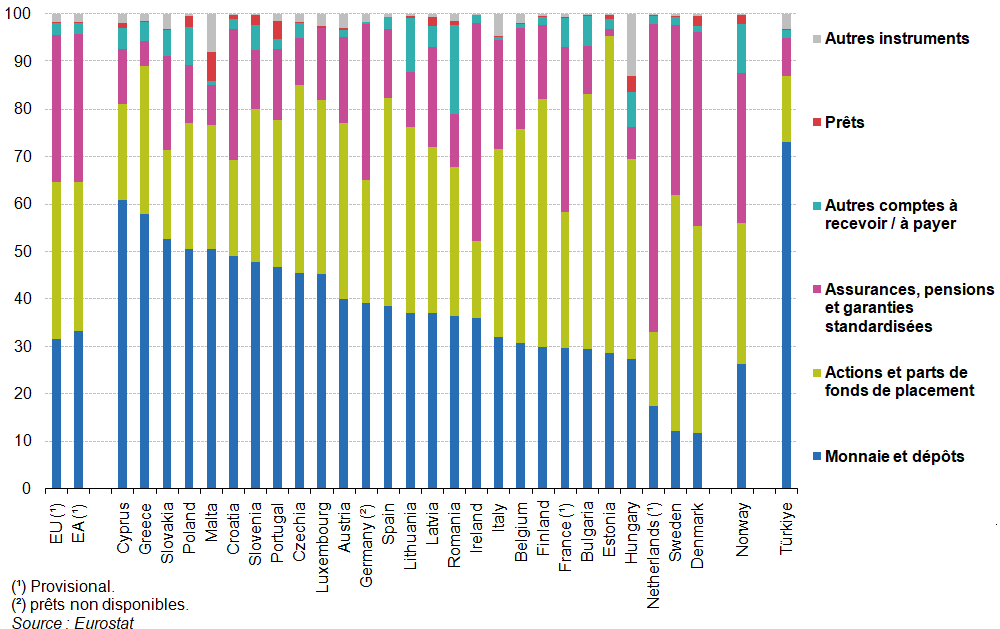
2/ un second ratio de la financiarisation : le poids des dettes dans le PIB en forte hausse à partir des années 80
Cette hypertrophie de la finance, la financiarisation de l’économie, a des conséquences directes sur l’économie dite réelle, car lorsque les bulles financières, qui résultent de la spéculation entourant certaines catégories d’actifs, explosent, cela peut entre autres paralyser le marché du crédit et donc freiner le déroulement normal de l’économie. Par exemple, la crise mondiale de 2008 prend son origine dans l’éclatement de la bulle des hypothèques à risque et l’effondrement des produits financiers dérivés de ces prêts hypothécaires [4]. Le graphique suivant met en évidence ce mouvement de la financiarisation aux États-Unis. Il compare le PIB en valeur à l’encours de la dette sur le marché du crédit. La divergence est sans appel à partir du début des années 80.
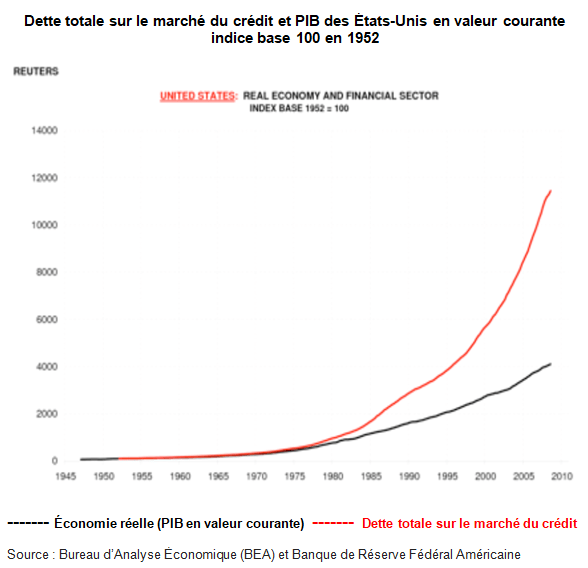
De même, la financiarisation est l’importance grandissante du recours au financement par endettement des agents économiques. Elle se traduit par une augmentation notable de la part des activités financières dans le PIB de la France (environ 5 % aujourd’hui de la valeur ajoutée globale, le double qu’il y a 50 ans). La valorisation des actifs se fait en fonction des valorisations par les marchés financiers. Les revenus des activités de services dans la banque, l’assurance et les placements sont d’importance croissante. L’ingénierie financière multiplie les types d’actifs financiers, les sommes en cause deviennent colossales, et si les profits sont énormes, il en est de même des pertes, les risques paraissant devenir hors de contrôle dans le cadre des dérapages et dérives financières.
Notons toutefois que le secteur financier est très hétérogène : Une étude du BEA américain ventile le secteur financier en cinq sous-secteurs : les institutions de dépôt, les banques de la Réserve fédérale, les fonds de pension, les compagnies d’assurance et les autres institutions non dépositaires. Les tendances récentes des revenus et de l’épargne diffèrent considérablement dans ces sous-secteurs, ce qui souligne la nécessité d’une présentation plus détaillée du secteur financier. Les tendances récentes dans différents agrégats (excédent net d’exploitation, revenu national net, intérêts nets reçus, prêts ou emprunts nets) ont également varié entre les sous-secteurs financiers [5].
3/ La titrisation des créances avant la crise de 2008, autre aspect de la financiarisation
La titrisation est une technique financière qui transforme des actifs peu liquides, c’est-à-dire pour lesquels il n’y a pas véritablement de marché tels que les crédits, en valeurs mobilières facilement négociables comme des obligations qu’un investisseur peut acheter et vendre à tout moment [6]. La titrisation a consisté en pratique à mélanger plusieurs actifs plus ou moins sûrs avant la crise de 2007 (voir ci-dessous). On dit que ces obligations sont adossées à un portefeuille d’actifs. Les banques émettrices des crédits créent des sociétés intermédiaires dans lesquelles ces crédits constituent les actifs et qui émettent en contrepartie des obligations qui constituent le passif. Les intérêts et les remboursements des crédits servent au paiement des intérêts des obligations émises et à leur remboursement. Ces sociétés sont appelées SPV pour « Special Purpose Vehicule » ou « véhicule spécial », car elles n’ont pas d’autre objet social et sont créées au cas par cas. Quant aux investisseurs, il peut s’agir de ces mêmes banques ou d’autres banques, de fonds de pension, de hedge funds, etc.
Le processus de titrisation des créances : dispositif emblématique de la financiarisation
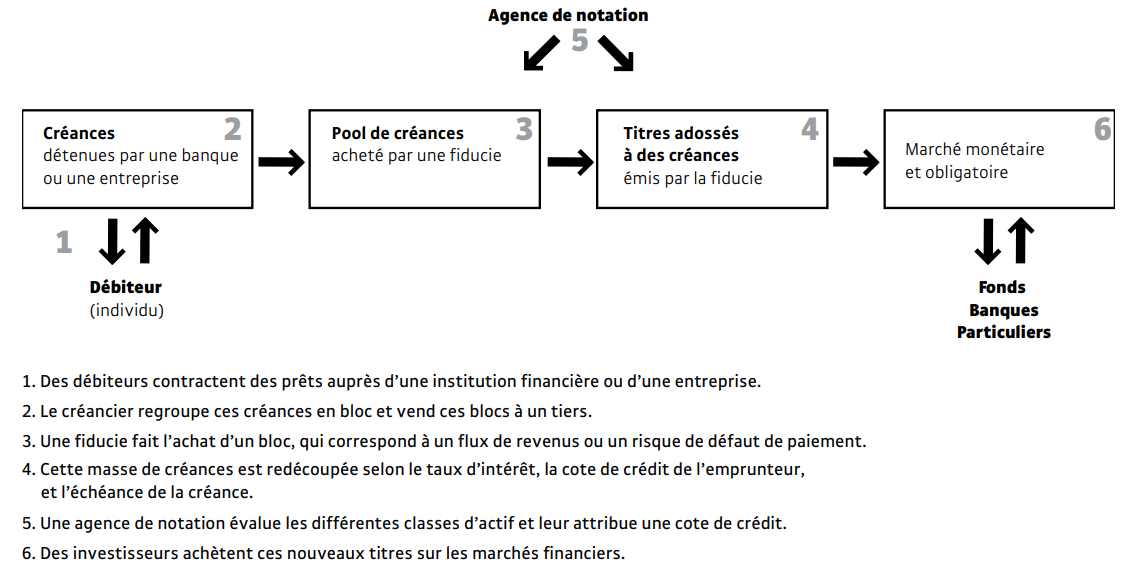
« Cette financiarisation sans fin a en partie été au cœur de la crise des subprimes de 2008. Celle-ci a débuté avec les difficultés rencontrées par les ménages américains à faible revenu pour rembourser les crédits qui leur avaient été consentis pour l’achat de leur logement. Mais c’est la titrisation qui permet de comprendre pourquoi et comment la contagion s’est opérée. Les banques d’affaires qui organisent la titrisation ont regroupé des « paquets » de crédits qu’elles mettent à l’actif des véhicules. Elles ont constitué des « paquets de crédits » « subprime », mais aussi des paquets mixtes, mélangeant des crédits subprime avec d’autres crédits hypothécaires, ou avec des crédits destinés à d’autres financements.
« La contagion et l’amplification ont alors tenu à la façon dont ont été construites les obligations souscrites par les investisseurs en contrepartie des paquets d’actifs. Celles-ci ont également été découpées en « tranches ». Certaines tranches comportaient des rendements plus élevés, mais aussi plus de risques, en ce sens qu’elles étaient les premières à être pénalisées si intervenaient des accidents de paiement sur les actifs. Mais l’effondrement des actifs a entraîné même ces obligations dans la débâcle à la surprise de leurs souscripteurs puisqu’il n’y a pas eu d’alerte progressive par une détérioration de la notation ».
« Facteur supplémentaire, les investisseurs qui ont acheté les obligations n’ont pas tous acheté en payant comptant, mais en s’endettant à leur tour pour bénéficier de l’effet de levier d’un endettement à bas taux d’intérêt. Ces investisseurs, banques et hedge funds notamment ont opéré en quelque sorte une titrisation au second degré en créant de nouveaux véhicules (appelés cette fois-ci SIV ou « conduits ») dont l’actif a été constitué par des obligations des véhicules de premier niveau et dont le passif a été constitué par du papier commercial à court terme (appelés « Asset Backed Commercial Paper » ou ABCP). Il en a été émis plus de 1000 milliards de dollars. On s’est ainsi retrouvé dans un mécanisme de « transformation bancaire » consistant à utiliser des ressources à court terme pour effectuer des prêts à long terme« .
4/ Les marchés à terme : la financiarisation des matières premières ou de l’énergie
Aujourd’hui la finance est partout notamment sur les cours des matières premières ou de l’énergie. Un marché à terme est un engagement d’acheter ou de vendre un actif à un prix fixé au moment de la transaction, mais pour une livraison ou un règlement à une date ultérieure.
Les contrats à terme furent créés pour répondre aux problèmes posés par le commerce des marchandises, qui peuvent concerner la qualité de celles-ci, et surtout les fluctuations de leurs prix. Avec une livraison à terme selon un prix et des conditions fixées à l’avance, acheteurs et vendeurs réduisent le risque de la transaction, et sont donc en mesure de planifier leurs opérations de manière plus efficace.
Soit un producteur de blé. Sur le marché au comptant, le blé se négocie à 1000 euros la tonne. Le producteur qui vendra sa récolte dans 3 mois, est incertain du prix futur du blé, mais craint tout de même une baisse des cours, qui peut résulter d’une offre trop abondante ou d’une spéculation à la baisse. Pour éviter de vendre à un prix inférieur à 1000 euros, le producteur a intérêt à s’entendre avec un acheteur sur un prix fixé dès maintenant (1000 euros si les deux acteurs se basent sur le marché au comptant). L’acheteur, qui de son côté a une stratégie inverse du vendeur, anticipe plutôt une hausse de cours du blé, et cela d’autant plus que le prix des matières premières agricoles fluctue beaucoup en fonction des événements climatiques relativement imprévisibles. Son intérêt est donc d’acheter à 1000 euros pour réaliser une plus-value qui sera d’autant plus importante que le cours du blé aura augmenté à échéance du contrat.
Les marchés de contrats à terme permettent de procéder à des opérations d’arbitrage ou de couverture des risques (hedging). L’arbitrage est l’action qui consiste à tirer un profit sans risque de différences de prix ou de cours sur le même titre, la même devise ou le même produit de base, en intervenant sur 2 ou plusieurs marchés différents. Il consiste alors à acheter et à vendre simultanément sur un autre marché. Il prend des formes multiples, mais le plus classique est l’arbitrage comptant-terme. C’est l’achat d’un titre au comptant avec des fonds généralement empruntés et la vente de contrats de futures sur ce titre de façon à fixer le prix de revente. Dans ce cas, l’arbitragiste compare le taux de rendement de l’opération d’achat de titres au comptant couvert par une vente à terme avec le taux de rendement d’un placement de même durée et effectue l’arbitrage si le taux de rendement de la première opération est supérieur au taux de rendement de la seconde.
Le but du marché à terme est d’abord de garantir le prix d’achat ou de vente d’un bien, donc de couvrir le risque économique. Mais les marchés à terme sont également des marchés spéculatifs, dans lesquels l’objectif est de réaliser un gain en capital en pariant sur la variation des cours. D’une manière générale, la spéculation est une opération consistant à faire des choix qui engagent le futur, en anticipant certaines évolutions, ce qui implique de prendre le risque que ces anticipations ne se produisent pas. C’est précisément ce risque qui justifie la rentabilité importante de l’engagement de certains spéculateurs, rémunération d’autant plus élevée que le risque est lui-même important. Si la spéculation concerne énormément d’actifs (les monnaies, les matières premières, les immeubles, les valeurs boursières…), elle est amplifiée sur les marchés à terme, compte-tenu du décalage temporel entre le moment de la conclusion du contrat et celui de son exécution.
La spéculation déstabilise parfois les marchés, en amplifiant les déséquilibres, et en produisant des processus cumulatifs. Avant que la correction de marché ne puisse s’exercer, on a pu observer que sur les marchés spéculatifs, à la différence des autres marchés, « la hausse appelle la hausse », ou que « la baisse appelle la baisse ». Les phénomènes mimétiques y sont en effet très présents, indépendamment de toute analyse rationnelle des situations (sauf à évoquer une « rationalité mimétique »). Ce marché de « contrat » attise ainsi l’appétit des spéculateurs qui délaissent d’autres marchés pour venir spéculer sur les marchés de denrées agricoles ou les produits énergétiques (pétrole, gaz,…) . Ces « traders » qui disposent de masses financières importantes accentuent la volatilité des prix. Pourtant la spéculation peut améliorer le fonctionnement des marchés. Le spéculateur achète des marchandises quand le prix de marché lui semble inférieur à ce qu’il devrait être (alors que le consommateur agit en sens inverse), et vend quand les prix sont trop élevés (ce qui va bien sûr à l’encontre de l’intérêt des producteurs).
5/ L’analyse des économistes « sociaux » de la financiarisation
Une autre thèse sur la financiarisation a été développée par les « économistes atterrés » [6]. Elle est fondée sur la forte augmentation des dividendes ce qui est vrai en France entre 1960 et 2021 mais pas après 2010 (notamment par rapport aux autres pays). Les dividendes versés aux ménages progressent certes sensiblement en 2021 et 2022 mais ils ne représentent pas même un dixième de l’excédent brut d’exploitation (EBE) des SNF en France (voir ci-dessous). Cette analyse omet aussi de dire que la part de l’EBE dans la valeur ajoutée (VA) brute est plus faible en France que dans les autres pays.
Il reste que cette analyse a le mérite de s’appuyer en partie sur les données de la comptabilité nationale. Mais elle peut être précisée dans le choix subjectif des périodes. Dans le chapitre 7, on présente un autre graphique du taux de marge (EBE/VA) depuis 1949.
La part des rémunérations reste à peu près stable en 2022 par rapport à 1950. Comme un des deux graphiques de cette étude commence en 1960, on a choisi la période 1960-2021 (voire 1960-2022 pour le partage de la VA, disponible sur le site de l’Insee) et non la période 1971-2021 comme dans l’étude. Ce dernier choix est ainsi justifié : « La périodisation commence au début des années 1970 parce que cette date marque la fin du régime de croisière du capitalisme d’après-guerre et que cela constitue un bon point de comparaison pour donner à voir les modifications entraînées par l’entrée dans le nouveau régime néolibéral à partir des années 1980 ».
a) La financiarisation contribuerait-elle à modifier l’affectation des profits ?
« Mesurer la valeur ajoutée soulève nombre de problèmes méthodologiques : il est possible de discuter de la répartition au niveau des seules sociétés non financières ou de l’ensemble de l’économie ; la valeur ajoutée à répartir peut être brute ou nette. Cependant, sur l’ensemble des mesures possibles, le périmètre le plus adéquat pour analyser les rapports entre le capital et le travail dans les entreprises serait celui du partage de la valeur ajoutée brute évaluée au prix de base sur le champ des sociétés non financières : valeur ajoutée brute[ car la consommation de capital fixe (CCF) fait bien partie des profits bruts et privilégier une répartition de la valeur ajoutée nette reviendrait à exonérer de toute discussion une partie de la rémunération du capital ; au prix de base ». De plus, les bases de données d’Eurostat et OCDE ne donnent pas une mesure précise de la CCF des SNF sans compter que les règles d’amortissement varient dans le temps et selon les pays..
« La VA brute (VAB) se partage en trois morceaux : la rémunération des salariés (qui inclut les cotisations sociales), l’excédent brut d’exploitation (EBE) qui correspond aux profits bruts, c’est-à-dire avant déduction de la consommation de capital fixe (ce qu’on appelle aussi les amortissements) et des autres impôts sur la production nets de subventions ».
« Entre 1971 et 2021, trois phases apparaissent :
« La baisse de la part des rémunérations n’est d’ailleurs pas spécifique à la France : sur la période 1995-2022, une même tendance baissière apparaît dans toutes les grandes économies européennes. La déformation de la répartition de la VA pourrait être expliquée par le changement technologique et la détérioration du pouvoir de négociation des salariés ».
‘L’économie mondiale est marquée par une tendance générale à une forte diminution de la progression de la productivité du travail. Parmi les hypothèses permettant de comprendre cette évolution, on note le basculement des économies vers les services (voir page Secteur tertiaire), un ralentissement de l’investissement productif, une dégradation générale des conditions de travail, un trop grand éclatement des chaînes de production et donc de valeur, … .
« S’y ajoute la faible capacité des nouvelles techniques à engendrer une nouvelle génération d’objets porteurs de dynamisme économique comme avaient pu l’être ceux de la période précédent, en particulier l’accélération de la CCF dont le corollaire est un ralentissement de l’investissement net. Le renouvellement du capital productif de plus en plus rapide serait exigé, non seulement par le rythme du progrès technique, mais aussi par la moindre efficacité du capital productif : il faudrait plus de capital pour produire un euro de valeur ajoutée brute. La FBCF inclut désormais les investissements immatériels, tels que les logiciels et les dépenses en R&D (voir page Investissement incorporel pays). Or la durée d’amortissement pour les investissements immatériels est beaucoup plus courte (2 à 3 ans) que pour les investissements matériels. De plus, les investissements en technologies de l’information et de la communication (TIC) sous formes d’ordinateurs et autres équipements matériels occupent une place grandissante (environ 20 % de la FBCF aujourd’hui) et s’amortissent aussi sur des durées plus courtes que les infrastructures industrielles traditionnelles ».
« La dégradation du pouvoir de négociation des salariés serait liée à la mondialisation, la financiarisation, et la situation du marché de l’emploi. La mondialisation impose la concurrence entre les forces de travail à travers le monde, avec à la clé des conditions imposées aux salariés tirées vers le bas. La financiarisation aurait de multiples effets : priorité à la valeur pour les actionnaires par rapport aux investissements, aux salaires et à l’emploi, L’utilisation des profits à des fins essentiellement de rentabilité financière serait un puissant levier de modification de la répartition de la valeur ajoutée. La corrélation entre un indice de financiarisation (part des profits non investis) et l’évolution du taux de chômage pour la France resterait vraie (graphique suivant). La financiarisation contribuerait à modifier l’affectation des profits, en les dirigeant davantage vers les dividendes et les rachats d’actions, au détriment de l’investissement des entreprises ».
« Part des profits non-investis par les sociétés non financières et taux de chômage en France » repris de (https://blogs.alternatives-economiques.fr/les-economistes-atterres/2023/06/28/la-repartition-de-la-valeur-ajoutee-ou-en-est-on-ou-va-t-on
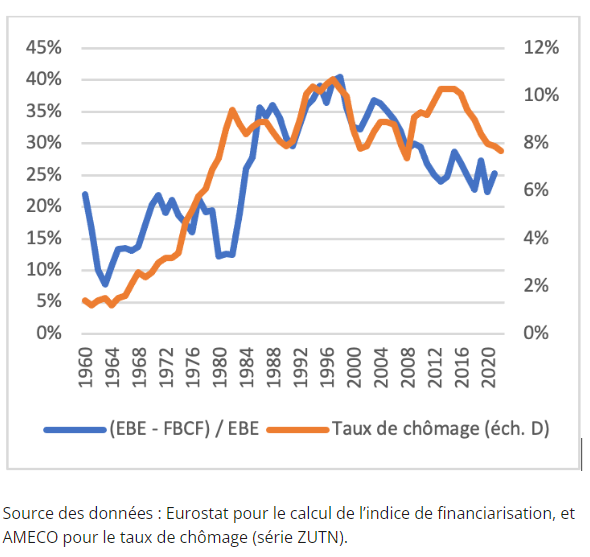
b) … est il confirmé par les chiffres ?
Que s’est-il passé d’après les données de l’Insee et d’Eurostat (en sachant que les données de l’Insee sur les revenus distribués des sociétés ont été assez fortement révisées lors de la dernière campagne des comptes en base 2014) ?
1 – En France en base 2020….
Tout d’abord, les données du graphique suivant nuancent quelque peu les propos sur le partage de la valeur ajoutée dans l’ensemble de la période 1960-2022. Le fait de choisir 1960 (au lieu de 1971) et 2023 (au lieu de 2021) atténue fortement la baisse de la part des rémunérations (qui n’est plus que de – 1 point au lieu de – 2,8 points entre 1971 et 2021) mais pas la hausse de la part de l’EBE (qui est de +3 points au lieu de +0,6 points entre 1971 et 2021), ce dernier se partageant entre une hausse de la consommation de capital fixe (amortissements en comptabilité privée) que l’Insee ne publie qu’après 1978 à et une baisse des profits nets (voir page Comptabilité nationale et comptabilité privée). Les impôts liés à la production augmentent de 1 point.
Part des 3 composantes de la valeur ajoutée brute des sociétés non financières entre 1960 et 2023 en %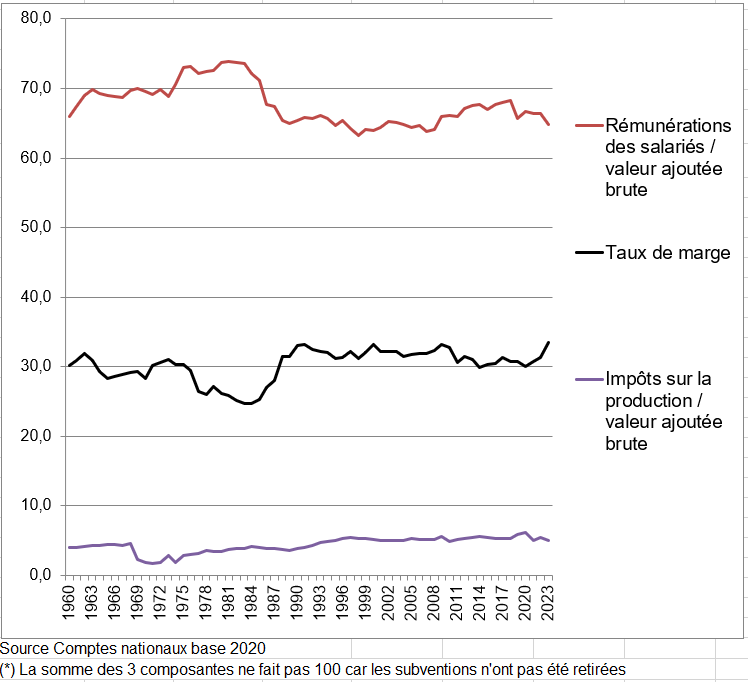
Part de la FBCF, épargne brute et autofinancement dans la valeur ajoutée brute des sociétés non financières entre 1960 et 2023 en %
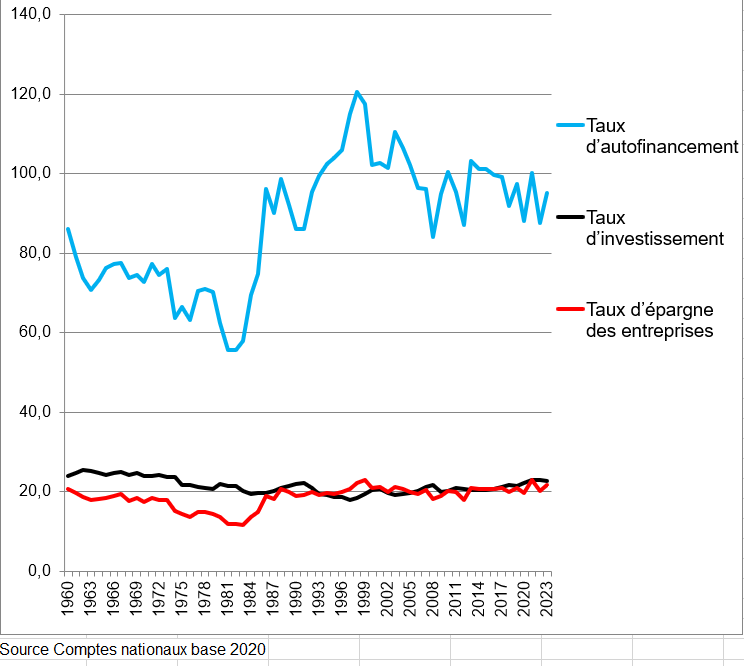
Ensuite, sur 310 Mds de revenus distribués versés en 2021, (quasiment les dividendes dans le cas de la France), 192,7 Mds l’étaient par les SNF, 33,7 Mds par les sociétés financières (SF) et 83,7 Mds par le reste du Monde (RdM). Ceux-ci étaient perçus pour 151,8 Mds par des SNF, 56,4 Mds par des SF, 55,7 Mds par des ménages et 39,3 Mds au RdM (tableau suivant). Les sociétés mères et leurs filiales détiennent des prises de participations et actions entre elles. Mais de nombreuses sociétés détiennent des actions d’autres sociétés non filialisées. ce qui explique le montant élevé de 151,8 Mds qui toutefois diminuerait fortement par rapport à 2019 (183 Mds).
Les SNF en ont ainsi versé 44% de l’EBE (192,7 / 437,4). Le montant de 55,7 Mds de dividendes versés aux ménages est donc un maximum, soit un peu plus de 10% de l’EBE des SNF. Pour avoir le montant exact, il faudrait disposer des comptes de « qui à qui ». Les grosses entreprises du CAC 40 versent la grande majorité des dividendes. sachant que toutes les sociétés n’en versent pas.
Autre point délicat, on ne tient pas compte içi des plus-values (moins values) souvent bien plus importantes que les dividendes surtout dans les années 1990-2009. Elles sont comptabilisées dans les gains de détention (pertes de détention) des comptes de patrimoine en comptabilité nationale (voir page Comptes financiers et non financiers). Les bases de « l’effet-richesse » (effet-Pigou) sont ainsi : les ménages qui possèdent des actifs dont la valeur augmente, se sentent « plus riches ». Du coup, leurs habitudes de consommation changent et ils dépensent plus. Les actifs en question peuvent être des portefeuilles d’investissements boursiers, tout autant que des biens immobiliers.
Mais à qui et à quoi servent les 151,8 Mds de dividendes distribués aux SNF ? où vont ils? Dans leur fond de réserve? Les entreprises peuvent utiliser ces dividendes pour investir. Il est possible aussi qu’une SNF ait un déficit d’exploitation compensé par ces revenus. Mais surtout ces dividendes peuvent être versés à des holdings, souvent classées en SNF, qui ne les distribuent pas. En revanche ils ne sont normalement pas versés à des fonds de pension qui font partie du secteur des sociétés financières (S12) mais plus probalement du Reste du Monde pour les fond de pension étrangers.
De façon générale, les unités légales (UL) détiennent des titres de participation dans d’autres UL et du coup perçoivent des dividendes, d’où les flux internes entre SNF. On peut d’ailleurs imaginer qu’il y a beaucoup de flux de dividendes internes aux groupes : si une UL, par exemple la maison-mère, détient une autre UL (une filiale), alors elle reçoit des dividendes de cette UL. Autrement dit, si l’unité institutionnelle était l’entreprise profilée, on aurait probablement une chute des flux de dividendes des SNF vers les SNF.
Autre évolution significative jusqu’en 1984, les dividendes n’augmentent pas plus vite que l’EBE, sauf les dividendes versés aux ménages, mais qui sont faibles (4 Mds en 1984 contre 0,5 Mds en 1960, montant à peine inférieur aux dividendes versés aux SNF).
Après 1984 c’est la financiarisation : explosion des dividendes versés d’abord aux SNF (1673 en 2021 indice base 100 en 1984) et dans une moindre mesure aux ménages (1406 en 2021 indice base 100 en 1984) mais avec un très net ralentissement de leur croissance à partir la crise de 2009 pour les SNF : +2,5% entre 2010 et 2021 ! (mais +50% pour les dividendes reçus par les ménages).
L’année 2022 marque une hausse des dividendes versés aux ménages (+10%) après l’explosion de 2021 suite à la chute de 2020. Au cours des décennies précédents la crise de 2009, les actionnaires ont donc beaucoup gagné d’argent à la bourse, par exemple dans l’immobilier. Ces gains ont été freiné entre 2009 et 2020 mais sont repartis à la hausse en 2021 et 2022. Si on tient compte des héritages et des autres donations, on ne peut pas dire que les « personnes riches » aient subi fortement la crise de 2009, un peu comme en 1929.
En fait les dividendes (revenus distribués versés pour la France) augmentent fortement, bien plus que les autres variables économiques et financières jusqu’en 2010 mais beaucoup moins après. De 1984 à la crise de 2009 et en 2021-2022, on peut parler de financiarisation de l’économie française.
Évolutions de quelques éléments du tableau économique d’ensemble (TEE) des SNF entre 1960 et 2021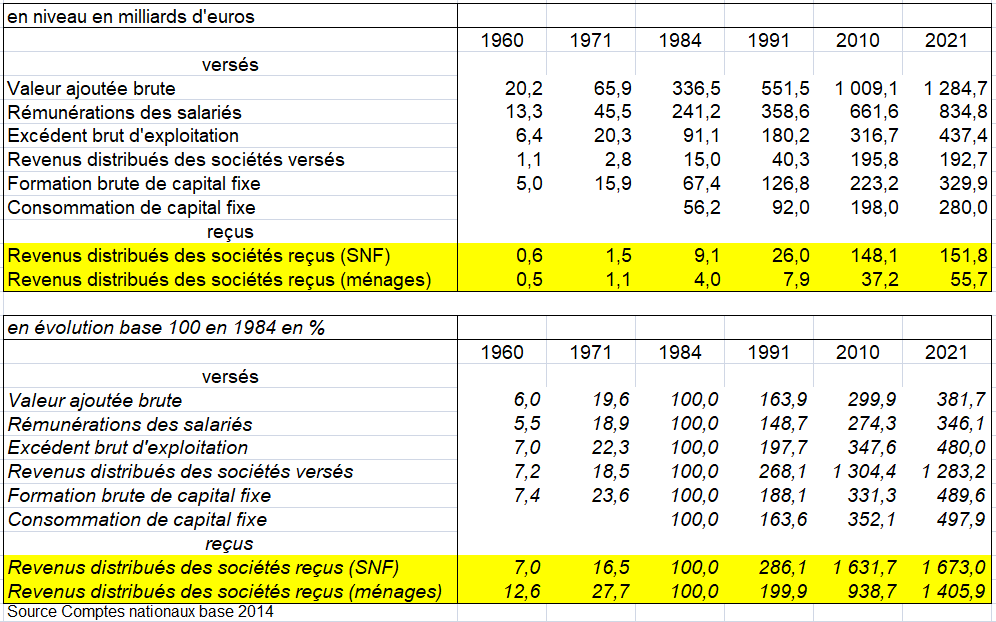
2 – … et en France par rapport aux autres pays de l’UE
On fera des comparaisons internationales mais on peut déjà observer les grandes tendances. Première évolution, les rémunérations salariales et l’EBE évoluent moins vite en France que dans les autres pays. Base 100 en 2000, les premières augmentent de 76% en 2021 en France contre +93% dans l’UE, soit un ratio d’évolution de 0,91 quand l’EBE progresse respectivement de 80% et 103%, soit un ratio de 0,90 (tableaux suivants).
Tableau-18-Eurostat-dividendes-et-autres-variables-1995-2021-SNF-1
Niveaux en milliards d’euros et évolutions en % base 100 en 2000 des rémunérations salariales dans l’UE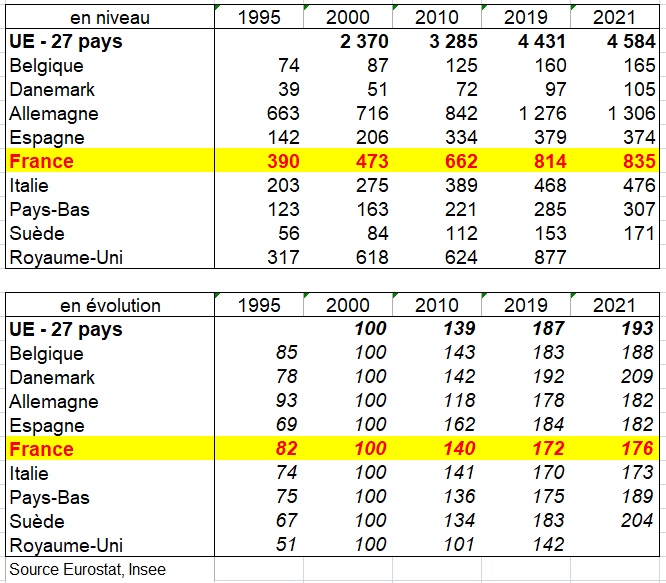
Niveaux en milliards d’euros et évolutions en % base 100 en 2000 de l’excédent brut d’exploitation dans l’UE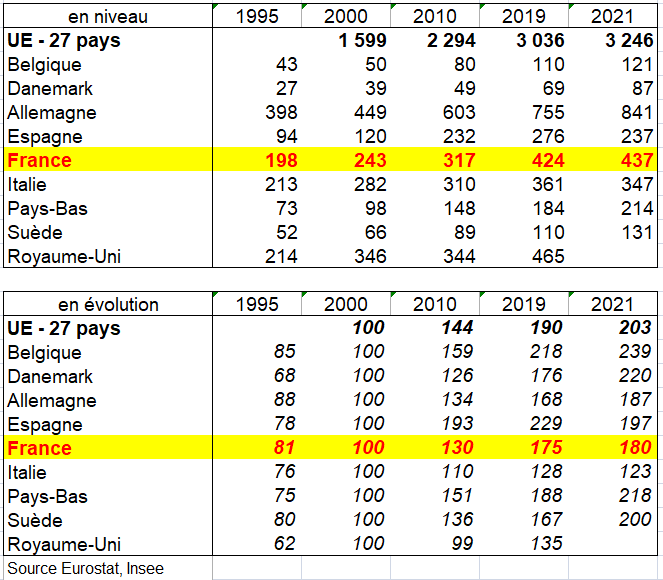
De leur côté, les revenus distribués des sociétés (D42) versés, qui comprennent les dividendes (D421) et les prélèvements sur les revenus des quasi-sociétés (D422) augmenteraient un peu plus en France (+102% base 100 en 2000) que dans l’UE (+99%). Mais ils augmentent bien plus dans de nombreux pays qu’en France : Espagne, Danemark, Pays-Bas, probablement Royaume-Uni. Ce sont surtout l’Italie, la Suède et l’Allemagne qui tirent vers le bas la progression de ces revenus dans l’UE.
Mais d’une part on a vu qu’ils sont surtout versés à d’autres SNF. D’autre part, cette croissance plus rapide s’arrête en 2010. Entre 2010 et 2020, ces revenus distribués diminuent de 2% en France contre +25% dans l’UE.
En outre, on ne dispose pas des dividendes dans tous les pays mais seulement des revenus distribués des sociétés avec de plus une non comparabilité entre l’Allemagne et l’Italie et les autres pays. On explique plus loin pourquoi la présence au sein des SNF des quasi-sociétés voire de certaines entreprises individuelles fausse les comparaisons internationales dans la mesure où ces entreprises ne pèsent pas le même poids dans tous les pays. On ne publie pas ici les revenus distribués des sociétés reçus par les ménages, particulièrement élevés en Italie et en Allemagne. On propose de faire la somme, plus significative, des deux revenus distribués des sociétés reçus (SNF+ménages).
Enfin dire que la croissance de la FBCF a été freinée en France par cette augmentation forte des revenus distribués des sociétés reste à prouver : La FBCF augmente en effet plus en France que dans l’UE : +102% entre 2000 et 2021 contre +86% dans l’UE, sous réserve que la FBCF est bien estimée en France (voir page Investissement incorporel pays). Ce constat est en niveau. A-t-il une influence sur les évolutions? (voir page la FBCF). Mais on vient de voir que les rémunérations et l’EBE augmentaient moins vite en France, signe d’une certaine vigueur de la croissance de la FBCF.
Tableau 18 Eurostat dividendes et autres variables 1995 2021 SNF
Niveaux en milliards d’euros et évolutions en % base 100 en 2000 des revenus distribués des sociétés versés par les SNF dans l’UE
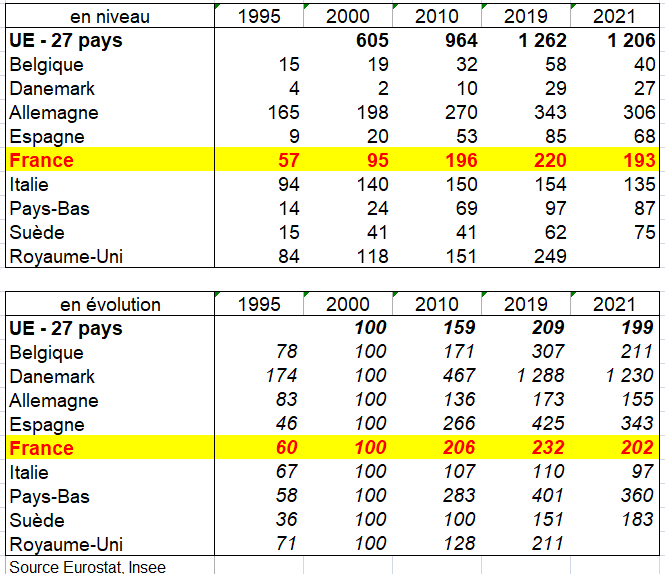
Niveaux en milliards d’euros et évolutions en % base 100 en 2000 des revenus distribués des sociétés reçus par les SNF dans l’UE
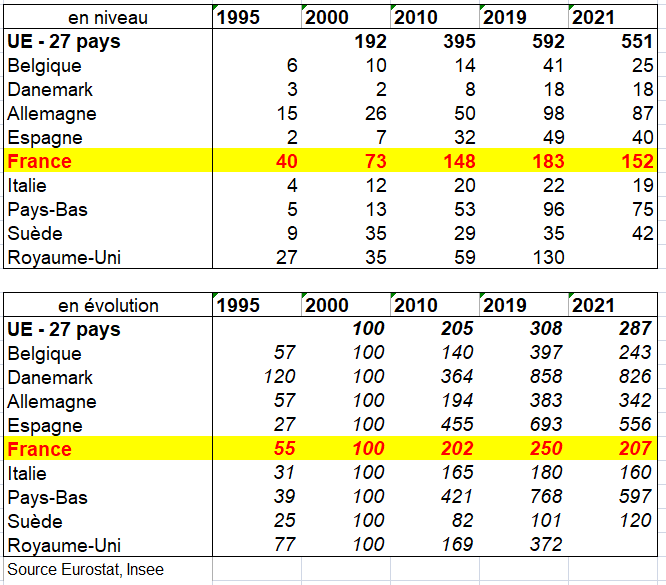
Niveaux en milliards d’euros et évolutions en % base 100 en 2000 des revenus distribués des sociétés reçus parles ménages dans l’UE
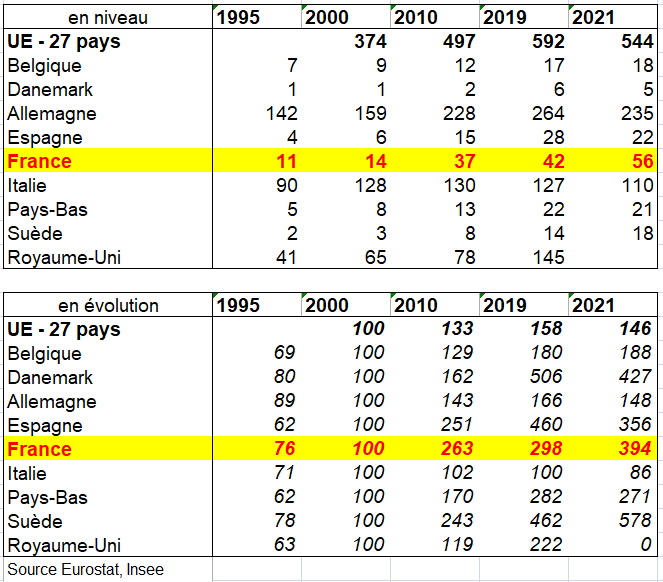
Niveaux en milliards d’euros et évolutions en % base 100 en 2000 de la FBCF dans l’UE
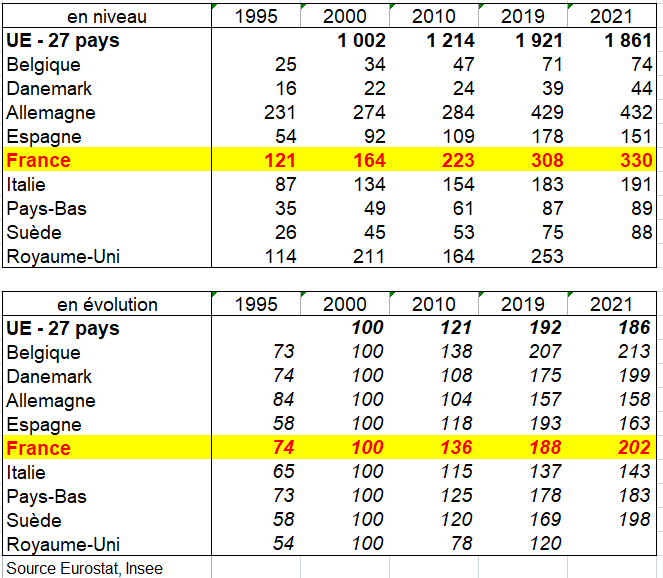
6/ La financiarisation dans les manuels internationaux de Comptabilité nationale
La financiarisation, c’est enfin l’aspect de plus en plus important pris par le tableau des opérations financières (TOF) qui décrit par type d’instruments financiers, par ordre de liquidité décroissante (capacité à être reconverti sans délai et sans coup en moyen de paiement), les variations d’actifs et de passifs financiers qui composent le besoin ou la capacité de financement. Il suffit de lire l’introduction du SCN 2008 pour se rendre compte de l’importance prise par le secteur financier.
« En réponse aux orientations de la Commission, les nouveautés du SCN 2008 comprennent l’introduction de traitements pour les aspects de l’économie qui ont pris de l’importance ces dernières années, le développement de certaines questions qui sont de plus en plus au cœur de l’analyse et la clarification du traitement comptable national de toute une série de thèmes. Ces nouveaux éléments s’appuient sur des recherches et des expériences pratiques, ainsi que, le cas échéant, sur des normes comptables internationales pour les entreprises et le secteur public. Toutefois, les changements apportés entre le SCN 1993 et le SCN 2008 sont moins étendus que ceux introduits en 1993. Les nouveaux éléments se répartissent en cinq groupes principaux : actifs; secteur financier; mondialisation et questions connexes; secteur des administrations publiques et secteur public; et secteur informel ».
« Les recommandations concernant le secteur financier ont été mises à jour afin de refléter les évolutions dans l’un des segments dont la mutation est la plus rapide dans de nombreuses économies. Le SCN 2008 donne notamment un aperçu général plus complet des services financiers. Les deux changements les plus significatifs sont, d’une part, l’extension de la frontière des actifs financiers afin d’inclure les contrats de produits financiers dérivés, indépendamment du fait qu’une « transaction » a lieu sur le marché ou hors marché, et d’autre part, l’enregistrement des flux associés à des échanges de taux d’intérêt et des contrats de garantie de taux en tant qu’opérations financières plutôt que comme flux d’intérêts. De nouvelles nomenclatures fonctionnelles ont en outre été introduites. Des orientations pour le traitement des crédits douteux (non performants) sont proposées. La méthode de calcul des services d’intermédiation financière indirectement mesurés, connus sous l’acronyme SIFIM, a été affinée à la lumière de l’expérience acquise dans la mise en œuvre des recommandations du SCN 1993″. Le changement le plus étendu dans le domaine financier concerne de nouvelles lignes directrices pour l’enregistrement des droits à pension ».
1/Les sociétés non financières (SNF)
On tente de répondre à la question de ce lien entre financiarisation et investissement pour l’ensemble de l’économie et non pour la seule industrie. On analyse surtout les comptes des SNF et parfois des sociétés financières (SF). Les SNF regroupent des unités institutionnelles dont la fonction principale est de produire des biens ou des services non financiers marchands, c’est-à-dire dont les ventes représentent au moins 50% de leurs coûts. Elles se distinguent des entreprises individuelles (EI) par leur statut juridique. Mais cette notion varie selon les pays, rendant parfois délicates les comparaisons entre pays des ratios des SNF tels que le taux de marge (voir ci-dessous). Et elle varie aussi dans un même pays avec le temps; certains agriculteurs français ont récemment choisi le statut juridique de SNF.
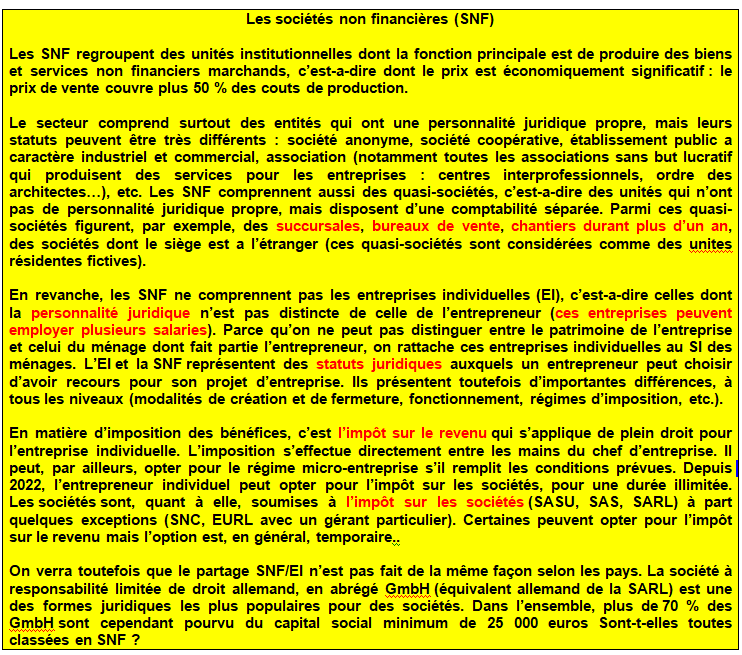
2/ la séquence des comptes des SNF
Ces comptes étant présentés dans la page Comptes financiers et non financiers, on les résume ici aux 5 principaux. Ils sont issus du tableau économique d’ensemble (TEE).
La valeur ajoutée des SNF génère des revenus qui sont distribués aux autres agents économiques, notamment les ménages et les administrations publiques. Parmi ces revenus, certains sont directement liés à la production et peuvent être considérés comme des coûts de production pour l’entreprise, d’autres ne le sont pas.
Ainsi, les rémunérations sont considérées comme des coûts de production car les heures de travail payées sont étroitement liées au volume de la production. A l’inverse, les intérêts payés par les SNF ne peuvent pas être considérés comme des coûts de production car ils dépendent, non du niveau de la production, mais de leur dette. De même, les dividendes sont liés au bénéfice des SNF et non directement à leur production.
Ainsi, la comptabilité nationale introduit un compte, le compte d’exploitation, qui reprend la VA en ressources et les coûts de production comme les salaires en emplois. Le solde du compte d’exploitation est l’excédent d’exploitation.
Le TEE comprend différents soldes. Le solde final du TEE est la capacité (ou besoin) de financement. On verra que que ceci est important dans le cas français, comparé aux autres pays : avec un taux de marge (EBE/VA) le plus faible en Europe, les SNF dégagent une épargne brute rapportée à la VA plus proche de la moyenne des autres pays, et un besoin de financement rapportée à la VA encore plus proche (-0,6% en 2019 contre 1% dans l’UE).
Dans le compte de production de la séquence des comptes des SNF et EI, la valeur ajoutée mesure de la richesse créée par les unités institutionnelles.
Le compte d’exploitation présente la rémunération des facteurs de production du point de vue du producteur donc comme des coûts (de production). La consommation intermédiaire (P2), la rémunération des salariés (D1), et les impôts nets des subventions d’exploitation (D29+D39) représentent des coûts de production « explicites ». La consommation de capital fixe (P51c) est un coût de production « implicite » qui résulte de la dépréciation subie par le capital fixe. La séquence des comptes peut être présentée brute ou nette de cette CCF.
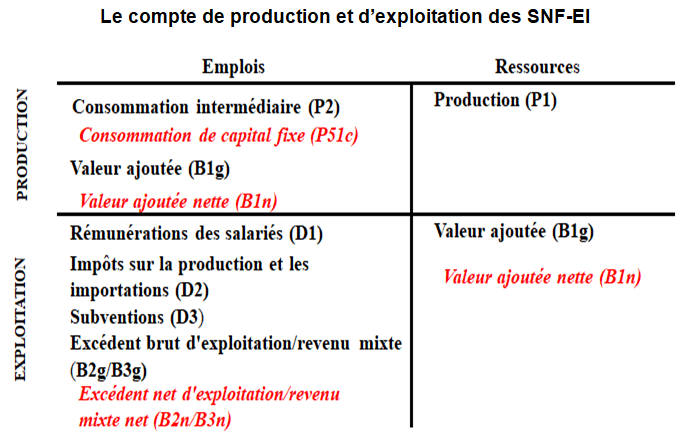
Le compte d’affectation du revenu primaire apour solde, solde le revenu des revenus primaires. c’est dans ce compte que sont comptabilisés les intérêts et les dividendes. Dans le cas des SNF, les masses sont importantes aussi bien les dividendes versés que les dividendes reçus par les SNF. Comme les comptes sont faits à partir des unités légales (UL), il n’y a pas de consolidation. Ce qui serait le cas si les comptes étaient faits à partir des entreprises profilées (EP). A la limite,le solde est presque plus important que les flux bruts.
Le compte d’affectation des revenus primaires retrace les revenus perçus au titre de la participation à la production et les revenus de la propriété :
Les revenus de la propriété sont les revenus que perçoit le propriétaire d’un actif financier ou d’un actif corporel non-produit en échange de sa mise à disposition d’une autre unité institutionnelle
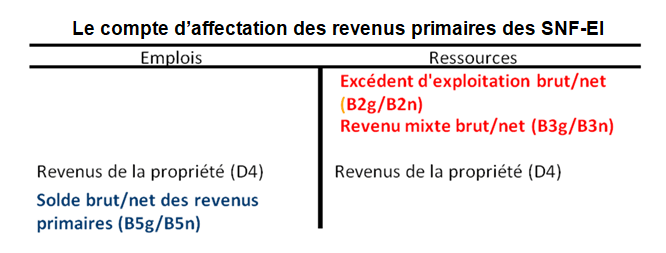
Dans le compte de distribution secondaire du revenu, le revenu disponible brut mesure les ressources disponibles pour la consommation finale et l’accumulation.
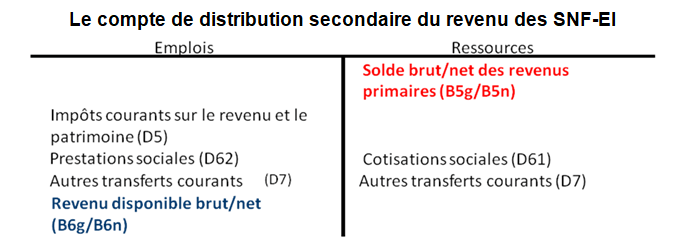
Le compte de capital retrace l’utilisation de l’épargne et des transferts en capital (ressources) pour l’accumulation non-financière. Rappelons qu’on ne retient que les actifs fixes produits qu’ils soient corporels (P51A) ou incorporels (P51B). Ces acquisitions d’actifs comprennent aussi les variations de stock (P52).
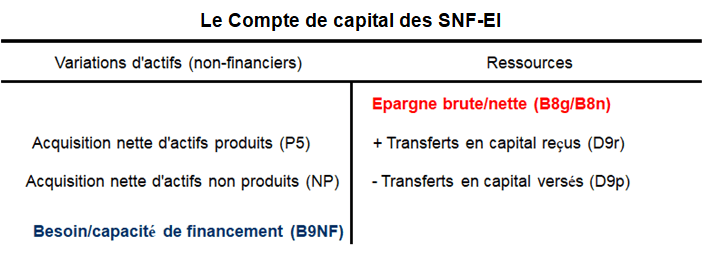
3/ De l’EBE à l’épargne et au besoin de financement des SNF
Une autre manière de présenter ces comptes est de voir comment se décomposent les ressources disponibles des SNF. La valeur ajoutée (au « prix de base ») – B1 – dégagée par les sociétés non financières (S11) est égale à la valeur de la production diminuée des consommations intermédiaires (biens et services entièrement consommés dans le processus de production).
Cette valeur ajoutée se décompose en rémunération des salariés (D1), excédent brut d’exploitation (B2), et impôts nets sur la production (D29+ D39). Une partie des impôts payés par les entreprises n’est donc pas incluse dans l’EBE. Certains économistes définissent un « EBE élargi » qui correspond à une notion extensive du profit, égale à la valeur ajoutée moins la rémunération des salariés : B2 + D29 – D39. Ils décomposent ainsi la valeur ajoutée des entreprises en deux composantes : les salaires (direct et socialisé), et l’EBE élargi.
On peut distinguer 4 utilisations de ce profit au sens large (schéma suivant). On précise à chaque fois si l’opération est en emplois ou en ressources du TEE.
– le paiement des impôts (impôts sur la production, impôts sur le bénéfice des sociétés, etc.) nets des transferts reçus (comme les aides à l’investissement de l’État) :
D29 (emploi) + D39(emploi) + D62(emploi) – D61(ressource) + D7(emploi) – D7(ressource)
– la distribution des revenus nets de la propriété : intérêts, dividendes, et autres : D4(emploi) – D4(ressource). En effet, on parle de revenus nets car les unités d’un secteur institutionnel versent des revenus de la propriété (dividendes, intérêts, etc.) mais elles en reçoivent également des autres secteurs institutionnels. Dans les graphiques suivants, la différence « revenus versés moins revenus reçus » donnent les revenus nets.
– l’investissement (formation brute de capital fixe) : achat de capital fixe (d’une durée de vie d’au moins un an)
– autres : variation des stocks et acquisitions d’actifs non produits (terrains, gisements, fonds commerciaux).
Les emplois de ce profit ne sont pas forcément égaux à la valeur de l’EBE élargi :
– s’ils sont supérieurs, les entreprises ont un « besoin de financement » : elles doivent emprunter des ressources supplémentaires pour couvrir leurs dépenses. La somme de l’EBE élargi et des fonds empruntés constitue les « ressources disponibles » pour faire face aux emplois.
– s’ils sont inférieurs, les entreprises dégagent une « capacité de financement » : elles peuvent prêter à d’autres secteurs institutionnels.
Par construction, nous avons l’égalité comptable entre les « ressources disponibles » dont disposent les entreprises et les quatre grands types d’emploi que font les entreprises de ces ressources.
Il faut en outre distinguer l’investissement brut (formation brute de capital fixe) et l’investissement net (formation nette de capital fixe). Une partie de l’investissement brut remplace le stock de capital fixe déclassé (amortissement ou « consommation de capital fixe»), et une autre partie (l’investissement net) augmente la capacité de production.
En France, les SNF ont globalement un besoin de financement.
L’intérêt de cette approche est de calcule un EBE élargi avant impôts, sachant qu’il existe deux grands impôts dans les comptes des entreprises, à savoir les impôts sur la production et les impôts sur les bénafices et que leur répartition peut varier selon les pays. L’idée serait de calculer soit un EBE élargi avant impôts, soit un EBE net des deux catégories d’impôts. En fait il est simple de décomposer le total rémunération + EBE entre ses 2 composantes.
Dans la suite du texte, le taux de marge sera défini comme l’EBE (B2)/VA (B1). Il faudrait d’ailleurs exclure les impôts liés à la production nets des subventions (D29 -D39) pour connaître la répartition de la valeur ajoutée brute au coût des facteurs (VA – D29+D39) entre les rémunérations et l’EBE. On le fait pas au chzpitre 7 pour les comparasions internationales, tout en s’intéressant surtout à l’évolution du taux de marge dans le temps et entre pays.
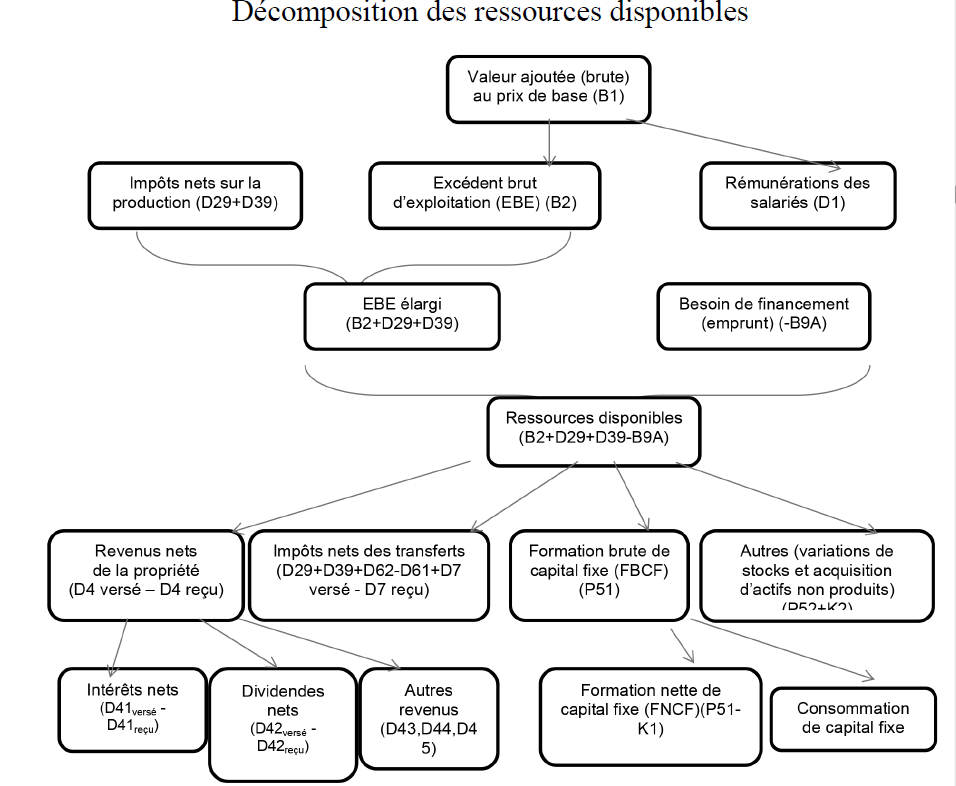
4/ Les ratios
Quels sont les ratios utiles pour l’étude de la financiarisation? Dans la mesure où les comptes ont été construits pour faire apparaître quelques soldes significatifs, il n’est pas étonnant que ceux-ci figurent au numérateur et/ou au dénominateur des ratios les plus répandus : taux de marge, d’épargne, d’investissement et d’autofinancement. D’une façon générale, il faudrait s’intéresser à l’évolution de la valeur ajoutée (VA) avant de commenter les principaux ratios.
Le taux de marge est le rapport entre l’excédent brut d’exploitation (EBE) et la VA. L’EBE est ce qui reste à l’entreprise après paiement des coûts directement liés à la production de la VA. Il est indépendant de l’origine et du mode de rémunération des capitaux mis en œuvre (actions ou emprunt, niveaux des taux d’intérêt, politique de distribution des dividendes,…). Le taux de marge peut alors être considéré comme un indicateur de profit (brut). C’est un indicateur de performance des entreprises, si l’on admet que l’aptitude à verser des salaires élevés (ils diminuent l’EBE) n’est pas une performance.
Le taux d’épargne – rapport de leur épargne brute à leur VA – est indicateur de profit brut retenu (conservé) par les SNF. Il n’évolue pas nécessairement comme le taux de marge. Notamment parce que la part des intérêts versés (net des intérêts reçus) des SNF est susceptible de varier en fonction des taux d’intérêt et de l’endettement.
Le taux d’investissement (rapport de la FBCF à la VA) est également un ratio important. Il indique quelle proportion de la VA est consacrée à l’effort d’investissement, que ce soit pour accroître leur capital fixe (accumulation) ou pour amortir celui qui s’est usé au cours de la période (puisque la FBCF est brute).
Le taux d’autofinancement rapporte l’épargne brute (EB) à la FBCF. Il indique quelle part de ‘investissement est financée par les ressources de l’entreprise. Comme (EB / FBCF) = (EB / VA) * (VA / FBCF), le taux d’autofinancement peut s’analyser comme le rapport du taux d’épargne au taux d’investissement. L’amélioration du taux d’autofinancement n’est pas toujours analysée comme la preuve d’une amélioration de la situation financière de l’entreprise : elle peut traduire par exemple une baisse plus forte du taux d’investissement que du taux d’épargne.
Le choix des périodes est important [2]. Ainsi le redressement du taux de marge pendant les années 1980 à 1995, n’a pas entraîné une hausse du taux d’investissement, mais uniquement du taux d’épargne, et donc des placements financiers, par exemple des investissements directs à l’étranger (IDE) (voir page chaînes de valeur mondiales). Une partie des placements a été faite aussi auprès d’entreprises françaises. En outre ces évolutions, comparées aux autres pays, deviennent différentes à partir de 1995 avec une hausse du taux d’investissement en France (mais n’est-elle pas exagérée du fait du traitement des logiciels en FBCF et de leur surestimation en base 2010?) des alors que le taux de marge est en légère baisse (voir page la FBCF).
Tous les ratios ci-dessus ne prennent en compte que des flux. On peut construire d’autres ratios, notamment des taux de rentabilité, en mettant des stocks au dénominateur (obtenus dans les comptes de patrimoine) : capital brut, actifs nets, etc. Les flux font référence à des actions et aux conséquences d’événements ayant lieu au cours d’une période déterminée, tandis que les stocks reflètent une situation à un moment précis dans le temps. «Un flux économique rend compte de la création, de la transformation, de l’échange, du transfert ou de la disparition d’une valeur économique. Il entraîne une variation de la valeur des actifs et passifs d’une unité institutionnelle».
° La multiplicité des ratios envisageables indique que la rentabilité et l’accumulation sont des notions dont les mesures sont complexes et dépendent de la perspective adoptée par l’analyse.
° Il faudrait compléter les ratios globaux par des ratios selon la taille des entreprises : grandes, PME, petites (moins de 20 salariés) et selon la forme juridiques. Les évolution moyennes recouvrent des divergences selon les entreprises (voir page comptes bâtiment travaux publics).
° En outre, il serait utile pour l’analyse économique de comparer ces ratios (part des salaires dans la VA, taux de marge) aux évolutions de la productivité du travail et du coût horaire du travail.
La financiarisation est le reflet de la lutte pour le partage de la valeur ajoutée entre rémunérations salariales et excédent brut d’exploitation dont une partie sert à distribuer des dividendes aux actionnaires. Mais que le chemin est long pour mesurer à peu près correctement ces deux derniers agrégats et les comparer entre les pays, ne serait-ce qu’en Europe.
L’interprétation des écarts entre les pays est parfois rendue difficile du fait que dans l’ensemble des revenus distribués (D42), les INS de plusieurs pays, tel l’Insee, ne publient pas les dividendes (D.421). Eurostat ne les publie que pour quelques pays dont la France. Ce n’est d’ailleurs pas la seule fois qu’Eurosat publie des données qui ne sont pas sur le site de l’Insee. Compte tenu des possibles différences de classement selon les pays à l’intérieur des Revenus distribués des sociétés (D42), on étudiera les deux séries (D42 et D421) en niveau et en proportion de la VA.
1/ Le calcul des dividendes : un souci pour apprécier la financiarisation
Les revenus distribués des sociétés (D42) comprennent :
– les dividendes (D421) : Ils constituent une forme de revenu de la propriété auquel ont droit les détenteurs d’actions (AF.5) qui ont, par exemple, mis des capitaux à la disposition d’une société.
L’émission d’actions constitue pour une société une façon de se procurer des capitaux autrement que par l’emprunt. Contrairement au capital emprunté, le capital-actions n’est pas à l’origine d’une créance fixe en termes monétaires et ne permet pas aux porteurs des actions de percevoir un revenu fixe ou prédéfini. Il faut entendre par «dividendes» tous les types de distribution de bénéfices par les sociétés à leurs actionnaires ou à leurs propriétaires. Ceci est à rapprocher de la distinction entre impôts sur les sociétés et impôts sur le revenu. En Allemagne ou en Italie, comme des non-salariés sont enregistrés dans les SNF, cette dernière composante est gonflé de même que l’EBE au détriment du revenu mixte des entreprises individuelles.
– Les prélèvements sur les revenus des quasi-sociétés (D422) sont les montants que les entrepreneurs prélèvent pour leurs propres besoins sur les bénéfices réalisés par les quasi-sociétés qui leur appartiennent.
Lorsque les bénéfices sont réalisés dans le reste du monde par des succursales (qui sont des établissements et non des unités légales), agences, bureaux ou autres d’entreprises résidentes, pour autant que ceux-ci soient considérés comme des unités non résidentes, les revenus non distribués sont comptabilisés comme bénéfices réinvestis des investissements directs étrangers (D.43). Seuls les revenus effectivement transférés à l’entreprise mère sont comptabilisés comme prélèvements sur les revenus des quasi-sociétés reçus du reste du monde. Un traitement symétrique est suivi pour retracer les relations entre les succursales, agences, bureaux ou autres opérant dans le pays et les entreprises mères non résidentes dont ils dépendent (voir page chaînes de valeur mondiales).
Un rapport sur le coût du capital publié par le CNIS en 2015 fait état des difficultés rencontrées par la comptabilité nationale pour estimer certains revenus de la propriété, en particulier les dividendes [7]. « La difficulté de trouver une source permettant une estimation fiable des dividendes au sens de la comptabilité nationale conduisait les comptables nationaux à faire des choix pour partie conventionnels. Cette lacune était d’autant plus problématique que la dynamique des dividendes est l’objet d’une attention particulière dans le débat public ». Le changement de base 2014 a été l’occasion, en plus du calage sur les données de la balance des paiements, de conduire un important travail méthodologique sur les estimations de flux de revenus de la propriété. La nouvelle méthode mobilise systématiquement les données fiscales sur les ménages issues de la déclaration de revenus (encadré suivant).
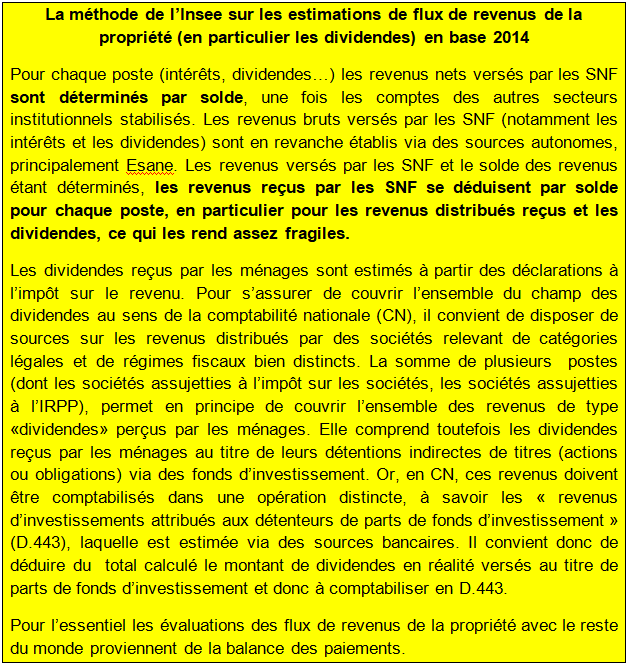
a) l’aspect conceptuel
Un premier obstacle est lié à l’internationalisation des grands groupes qui réalisent une partie importante de leur chiffre d’affaires à l’étranger et distribuent aussi des dividendes à des actionnaires non-résidents. La complexité des liaisons industrielles et financières rend difficile l’identification de ces flux financiers et par conséquent aussi les comparaisons internationales. Une grande entreprise, qui peut être une filiale, verse des dividendes à d’autres sociétés non financières (SNF) qui ont des prises de participation dans l’entreprise ou bien à une société-mère, aux sociétés financières (SF), notamment les holdings, aux ménages, aux entités étrangères comme les fonds de pension (reste du monde).
La présence au sein des SNF des quasi-sociétés voire de certaines entreprises individuelles fausse les comparaisons internationales dans la mesure où ces entreprises ne pèsent pas le même poids dans tous les pays : cela revient à inclure dans les revenus distribués des entreprises des revenus qui s’apparentent beaucoup plus à une rémunération du travail qu’à celle du capital. C’est notamment le cas en Allemagne ou en Italie, où une part importante des entreprises de type familial sont constituées en quasi-sociétés. En Allemagne par exemple, une part prépondérante des revenus distribués par les sociétés non financières irait aux quasi-sociétés : les 2/3 pour l’année de référence (2001) pour laquelle des résultats détaillés sont diffusés en Allemagne, près de 86 % en Italie (2013). En France, les dividendes versés représentent 161 milliards d’euros en 2019 contre seulement 0,7 milliard pour les prélèvements sur les revenus des quasi-sociétés.
La comparabilité entre pays est enfin rendue délicate par l’opération D443 : Revenus de placement attribuables aux actionnaires des fonds communs de placement. Les revenus d’investissements attribués aux détenteurs de parts de fonds d’investissement, dont les organismes de placement collectif et les fonds communs de placement, sont enregistrés sous deux postes distincts:
Les dividendes distribués aux détenteurs de parts de fonds d’investissement sont enregistrés exactement de la même manière que les dividendes des sociétés individuelles, comme décrit plus haut. En France, les ménages reçoivent des fonds des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM). Leur activité consiste à investir sur les marchés l’épargne collectée auprès de leurs porteurs de parts. À l’actif de l’OPCVM figurent les instruments financiers qu’il détient. Au passif de l’OPCVM figurent les capitaux apportés par les souscriptions des porteurs. Les sociétés d’investissement à capital variable (SICAV) font partie avec les fonds communs de placement de la famille des OPCVM. En 2018, le D443 versé aux ménages représente 6 milliards d’euros en France contre 16 Mds en Allemagne, 9 Mds en Italie, 7 Mds en Espagne et un peu plus de 4 Mds au Royaume Uni. Ces fonds ne sont donc pas plus élevés en France que dans les autres pays.
À ces difficultés liées à la structuration juridique du tissu productif s’ajoute le fait que, à l’étranger comme en France, le système statistique est mal outillé pour mesurer ce type de revenus. En Allemagne, le montant des dividendes nets versés par les sociétés en capital situées sur le territoire national n’est pas connu. Seul l’est celui des dividendes nets versés par les entreprises étrangères, via les statistiques de balance des paiements. Il en résulte que le montant des dividendes versés par les entreprises résidentes en Allemagne est estimé sur la base des recettes de l’impôt sur le revenu du capital. Il en va de même pour les revenus distribués des quasi-sociétés, estimés comme le solde de l’ensemble des revenus dans le compte des ménages. On retrouve ainsi en Allemagne cette même convention comptable consistant à traiter les dividendes nets comme une variable d’ajustement (« un solde »), avec tous les biais pouvant potentiellement en découler.
b) les estimations des dividendes par l’Insee en base 2014
A la suite de ces remarques, il faut être un peu prudent sur les comparaisons internationales des dividendes des SNF. L’Insee a eu l’occasion de recalculer les comptes des SNF en base 2014. Certains économistes ont critiqué les divergences d’évolution des dividendes entre la base 2005 et la base 2010 [8]. Ils s’appuient sur ce graphique. Mais un changement de base n’est-il pas l’occasion de modifer des niveaux et des séries sur les années de base ?
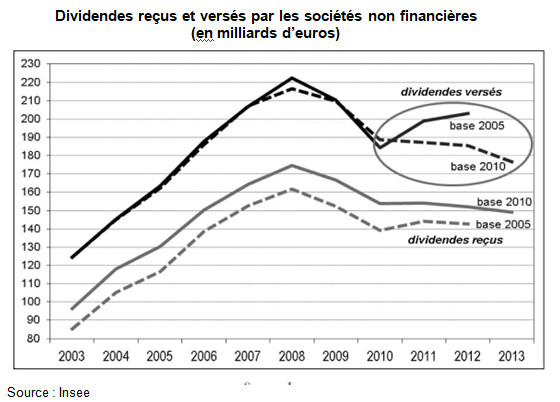
Les évolutions des comptes nationaux sont elles fiables en base 2014 ? L’Insee a confirmé les évolutions de la base 2010 entre 2010 et 2012. Il faut de nouveau se référer au rapport du CNIS. Il insiste sur la difficulté de comparer plusieurs sources françaises.
« De multiples facteurs limitent la comparabilité des données issues de ces différentes sources. La question de la territorialité en particulier est cruciale. La dynamique des versements de dividendes peut être extrêmement différente entre les différentes sources, notamment entre les données de la comptabilité nationale et celles relatives aux groupes cotés. La forte internationalisation des grands groupes cotés, fortement implantés dans les zones émergentes où la croissance économique est plus soutenue qu’en Europe (en Asie notamment) pourrait en partie expliquer le plus grand dynamisme des dividendes versés par ces groupes que des versements de dividendes comptabilisés par l’Insee ».
« Les données les plus médiatisées émanent des grands groupes cotés au CAC 40, qui annoncent chaque année le montant des dividendes qu’ils s’apprêtent à distribuer au titre du dernier exercice clos. Le site vernimmen.net fait la synthèse des informations publiées par les groupes et propose une estimation des distributions totales effectuées par les groupes du CAC 40, que ce soit sous forme de dividendes stricto sensu ou bien de rachats d’actions. La comptabilité nationale fournit également une estimation des dividendes versés : l’agrégat le plus analysé correspond aux dividendes versés par les SNF.
« La Banque de France publie également une estimation des dividendes versés par les entreprises d’une certaine taille (chiffre d’affaires supérieur à 750 000 €) en exploitant le fichier bancaire des entreprises (Fiben) ».
Le graphique suivant compare les évolutions des différentes sources en valeur, en base 100 en 2006. Il met en lumière des divergences d’évolution des dividendes versés selon les sources. Entre 2009 et 2014, les deux séries (Insee et Banque de France- source Fiben) divergent. Depuis 2014, il semblerait que les divergences continuent d’exister.
Toutefois la comparaison des sources s’avère périlleuse : les données ne couvrent pas les mêmes champs. Ainsi, les données du CAC 40 portent par définition sur des groupes de grande taille tandis que la comptabilité nationale a une visée exhaustive et couvre donc toutes les entreprises, quelle que soit leur taille. Les données de la Banque de France correspondent à un cas de figure intermédiaire.
« Les messages envoyés par les différentes sources sont extrêmement divergents » :
• les données relatives aux groupes du CAC 40 sont marquées par une très forte volatilité (plus nette encore si l’on inclut les rachats d’actions dans l’analyse) : après un maximum atteint en 2008, les masses de dividendes versés connaissent une chute brutale et ce n’est qu’en 2014 que le montant des dividendes versés retrouve (et dépasse) son niveau d’avant-crise ;
• en comptabilité nationale, les masses de dividendes versés baissent progressivement après un maximum enregistré là aussi en 2008. En base 2005, ils connaissent un léger rebond à partir de 2011 (sans jamais retrouver toutefois leur niveau d’avant-crise) tandis qu’en base 2010 la baisse se poursuit – à un rythme modéré – jusqu’en 2013. Notons aussi que les comptes nationaux de la base 2014 confirment largement les évolutions de la base 2010. En outre, un redressement de la part des revenus distribués dans la VA s’opère en 2015 et 2016, interrompu en 2017;
• dans la source Banque de France la croissance des dividendes est beaucoup plus régulière : l’indicateur ne connaît en 2009 qu’une baisse limitée (d’un peu plus de 5 %) et retrouve ensuite son dynamisme, les masses de dividendes versées en 2012 s’établissant 18 % au-dessus du niveau de 2008. L’année 2013 est toutefois marquée par un recul sensible ».
2/ les dividendes versés aux ménages et aux SNF dans quelsues pays de l’UE
À court terme, le versement de dividendes constitue un prélèvement sur les ressources de l’entreprise. Au moment où ils sont distribués, le cours de l’action enregistre cette diminution des ressources par une baisse des cours. C’est pourquoi certaines entreprises autorisent les actionnaires à réinvestir leur dividende sous forme d’achat d’actions.
Tout d’abord, les dividendes sont surtout versés à des sociétés non financières notamment en France. C’est même une caractéristique française que ceux-ci sont très importants (autour de 72% des dividendes versés aux SNF et aux ménages en 2022). Avant la crise financière et mêêm jusqu’en 2019, cette part nest à peu près stable. Ce n’est plus du tout le cas plus le cas en France durant les dernières années (premier tableau suivant).
Il reste que les dividendes totaux distribués aux SNF et aux ménages ont quand même fortement progressé en France entre 2000 et 2022 (mais surtout entre 2000 et 2010 et en 2021-2022) : +151% en France base 100 en 2000 dont +334% aux ménages (et seulement +114% aux SNF). Mais la progression se situe encore entre 2000 et 2010 : + 163% pour les ménages. Après la progression est assez faible, en tout cas plus que dans les autres pays et surtout pour les SNF : entre 2010 et 2021, les dividendes versés aux SNF ne progressent presque pas en France contre entre +50% dans les autres pays sauf au Portugal où ils diminuent.
Si il y a eu financiarisation en France en terme de dividendes distribués aux entreprises et aux ménages c’est avant 2010 et aussi en 2020-2022 pour les ménages. Il est d’ailleurs très difficle de commenter les évolutions qui varient fortement selon les périodes. L’année 2022 en est un bon exemple : les comparaisons d’évolutions par pays entre 2000 et 2021 ne sont pas les mêmes qu’entre 2000 et 2022. La France se situerait dans la moyenne supérieure pour les dividendes reçus par les ménages avec une phase très intense entre 2000 et 2010 et en 2021-2022 et dans la moyenne inférieure pour les dividendes reçus par les SNF même si ils restent largement supérieurs à ceux versés aux ménages mais bien moins qu’en 2000. Les profils d’évolution en Suède seraient assez proches de la France entre 2000 et 2022 mais pas par sous-périodes.
tableau-37-dividendes-distribues-SNF-menages-europe
Part des dividendes versés aux sociétés non financières (SNF) et aux ménages par les secteurs institutionnels (SNF, SF et Reste du Monde) en %
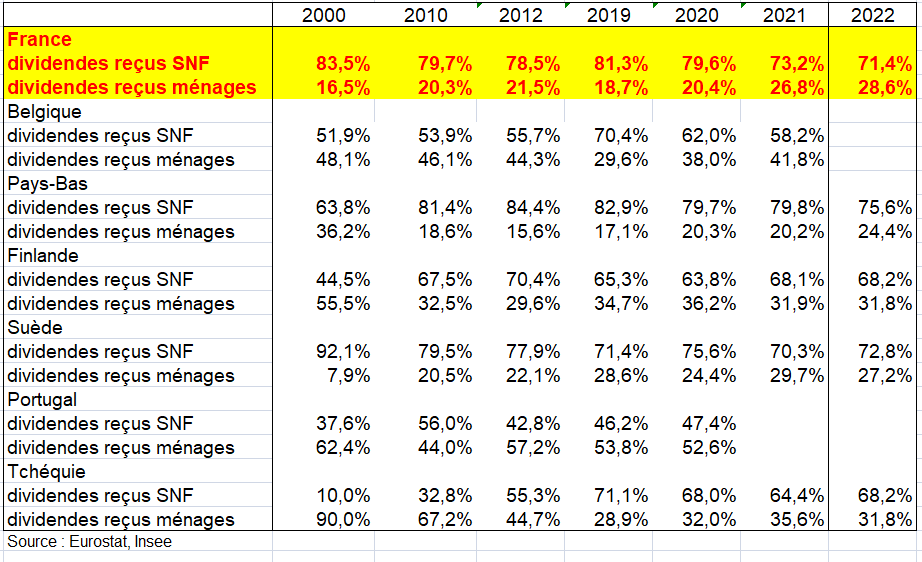
Évolution des dividendes versés aux sociétés non financières (SNF), aux ménages et au total des deux secteurs par les secteurs institutionnels (SNF, SF et Reste du Monde) en % base 100 en 2000
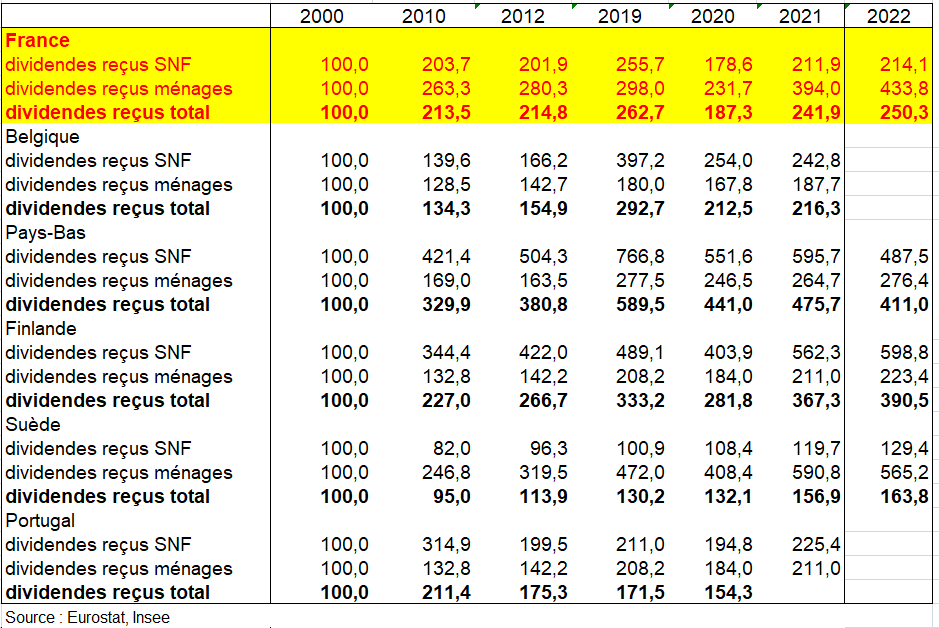
Dividences versés aux ménages dans les pays où on les connaît : niveaux et évolution depuis 2000
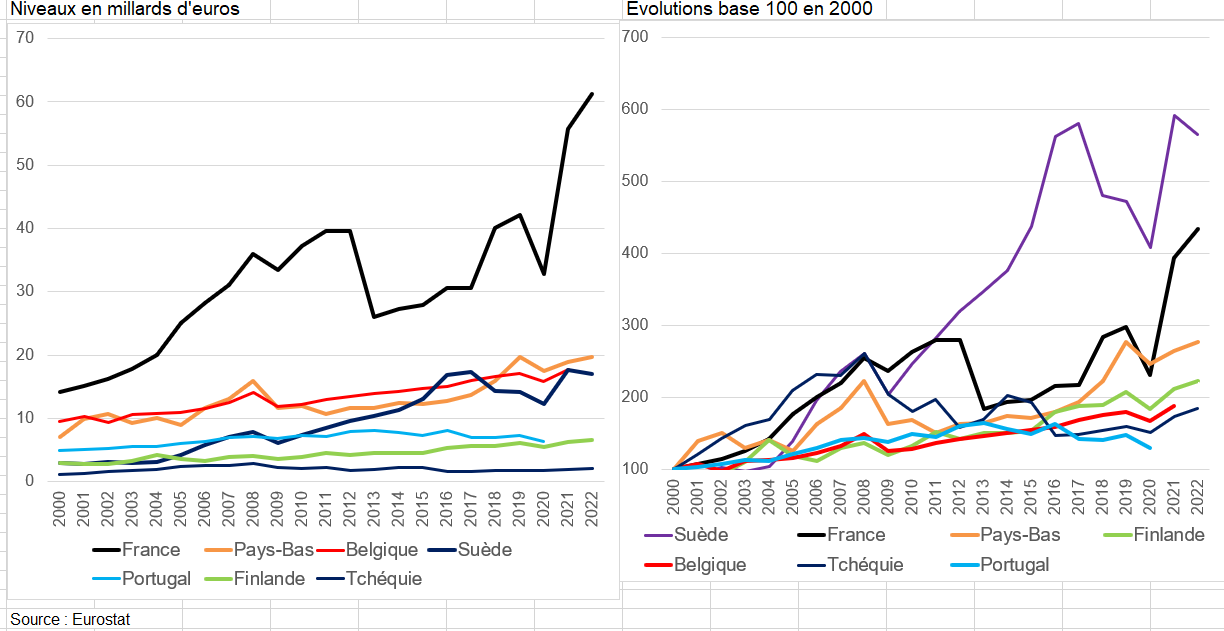
Dividences versés aux SNF dans les pays où on les connaît : niveaux et évolution depuis 2000
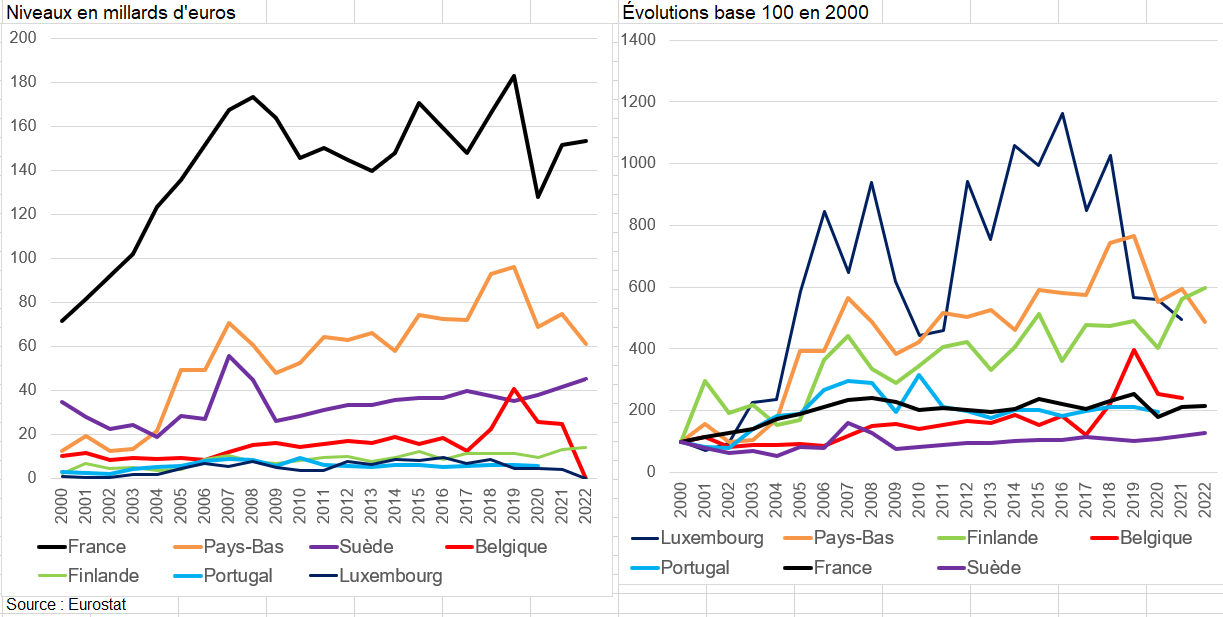
Au niveau européen, selon les données d’Eurostat à partir de celles des INS, les dividendes distribués aux ménages des pays dont on en connait le montant, ont augmenté d’environ 15 % en 2021 (graphique suivant). Cette hausse rapide a été consécutive à une baisse de -10 % du montant des dividendes versés dans ces pays en 2020, en raison de la crise liée à la pandémie de Covid-19. En 2022, la hausse serait tès forte en France : +37% contrairement à une quasi-stagnation dans les autres pays, montrant une fois de plus la difficulté de tirer des conclusions selon le choix des périodes.
Mais les revenus distribués des sociétés (D42) versés aux ménages de l’ensemble des pays de l’UE ont nettement moins progressé dans l’UE. Leur progression est d’ailleurs bien plus faible entre 2012 et 2021. Ceux-ci comprennent outre les dividendes, les prélèvements sur les revenus des quasi-sociétés (D422)
Variation des dividendes (D421) versés aux ménages des pays de l’UE dont on en connait le montant en %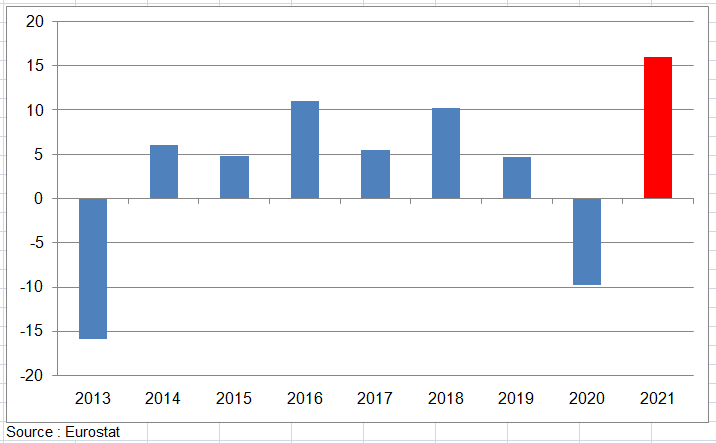
Variation des revenus distribués des sociétés (D42) versés aux ménages de l’ensemble des pays de l’UE en %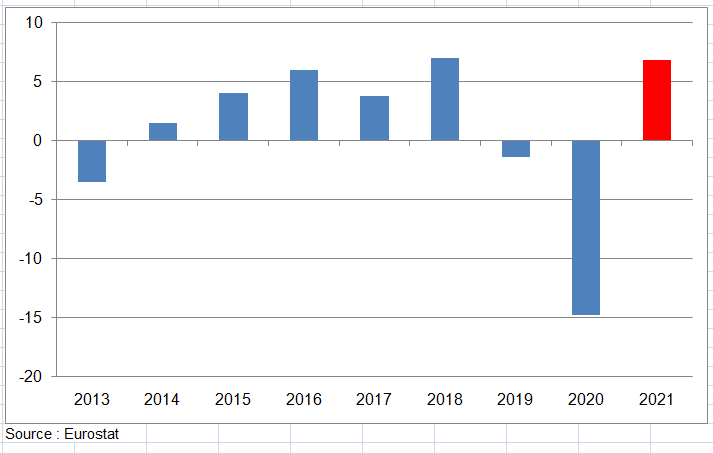
Pour l’année 2021, les entreprises du CAC40 ont procédé à 23,8 milliards de rachats d’actions et ont distribués 45 milliards de dividendes. Leur progression serait assez faible en France entre 2012 et 2021 : +12,5% du fait d’une chute importante en 2013.
Pour l’année 2022, les entreprises du CAC40 ont distribué, en 2022, 80,1 milliards d’euros à leurs actionnaires (dont 23,7 milliards via des rachats d’actions et 56,4 milliards sous forme de dividendes), selon les données compilées par la lettre financière Vernimmen.net., chiffres différents de ceux de l’Insee. Cette hausse de la rémunération des actionnaires en 2022 s’explique par la forte reprise économique et les profits record enregistrés par certaines entreprises.
De même, au niveau européen, les dividendes distribués auraient, à nouveau, augmenté en 2022 pour atteindre 382 milliards d’euros, selon les données d’Allianz GI. Selon les données d’Eurostat disponibles pour quelsques pays, la progression serait du même ordre de grandeur qu’en 2021 : +19%, mais avec des divergences selon les pays, la progression étant très forte en France en 2022, plus dans d’autres pays en 2021 (Suède par exemple),
Un rachat d’actions est une opération par laquelle une entreprise rachète ses propres actions sur le marché. Une fois le rachat effectué, une entreprise peut utiliser les actions acquises de deux manières. Elle peut tout d’abord les annuler, ce qui entraîne une diminution du capital social de l’entreprise. Elle peut également les offrir ou les attribuer à ses salariés et dirigeants, par exemple dans le cadre d’un plan d’actionnariat salarié. Dans la première hypothèse, le rachat d’actions est un moyen pour une entreprise de redistribuer des fonds à ses actionnaires. La même valeur de l’entreprise étant divisée par un nombre inférieur d’actions, la valeur de chaque action augmente mécaniquement.
De plus en plus utilisés par les sociétés – en 2022, les rachats d’actions effectués par 425 des plus grosses entreprises cotées en Europe ont atteint 161 milliards d’euros, un record – cette méthode présente, dans certains pays, une fiscalité plus attrayante que le versement de dividendes. C’est le cas notamment aux États-Unis où les fonds de pensions sont exonérés d’impôt sur les plus-values. Afin de corriger cela et d’inciter les entreprises à utiliser leur trésorerie pour investir davantage, une disposition de l’Inflation Reduction Act votée par le Congrès américain à l’été 2022 a introduit une taxe sur les rachats d’actions. Ces derniers font, depuis le 1er janvier 2023, l’objet d’une taxation équivalente à 1 % de la valeur de l’opération.
Variation des dividendes (D421) versés aux ménages en France en %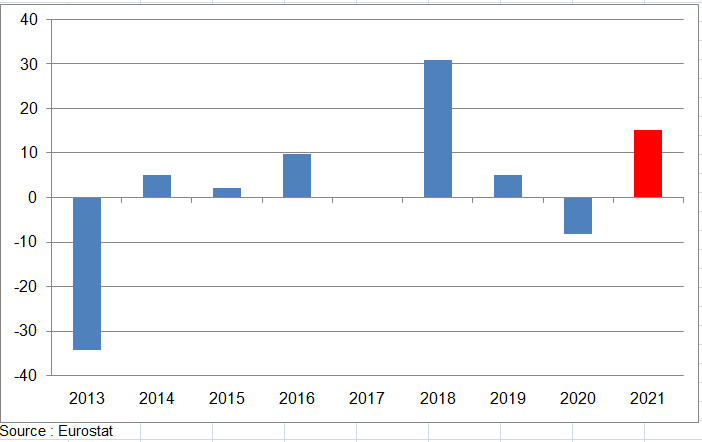
Les entreprises françaises ne seraient, toutefois, pas les plus généreuses en Europe avec les actionnaires en comparant le rendement moyen des actions. On appelle souvent rendement le rapport entre le dividende de l’action et le cours de l’action. Mais , ces comparaisons internationales ne seraient pas forcément pertinentes : elles ne tiennent pas compte des différents profils d’entreprises (grandes entreprises matures ou jeunes entreprises technologiques ou de croissance) dans les indices boursiers de chaque pays.
Rendement moyen des actions en 2022 en %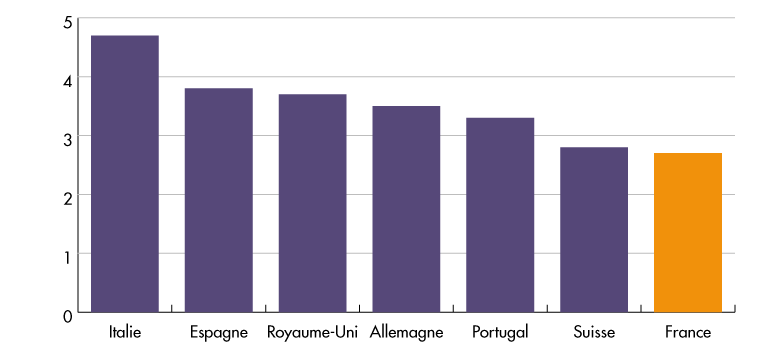
Source : La Finance pour tous.com d’après Allianz GI
1/ Les propriétaires des sociétés cotées en bourse en 2017 : la financiarisation est mondiale
À la fin de l’année 2017, environ 41 000 sociétés financières et non financières étaient cotées en bourse dans le monde. Un rapport de l’OCDE présente la structure de l’actionnariat des 10 000 plus grandes de ces entreprises provenant de 54 marchés qui, ensemble, représentent 90 % de la capitalisation boursière mondiale. L’ensemble des données comprend 77 456 investisseurs uniques et 1,4 million de liens entreprise-investisseur. La structure de l’actionnariat sur chaque marché est construite sur la base des enregistrements des propriétaires de chaque entreprise, qui comprennent les investisseurs de portefeuille ainsi que des investisseurs de contrôle et des investisseurs stratégiques.
a) Répartition monidlae des actions cotées en bourse
Le tableau suivant présente une comparaison entre les 10 000 plus grandes entreprises cotées en bourse couvertes par le rapport et les 41 000 sociétés cotées dans le monde en termes de capitalisation boursière, de nombre et de la taille moyenne des entreprises par région. Le tableau suivant compare les 10 000 plus grandes entreprises cotées en bourse couvertes par ce rapport avec les 41 000 entreprises cotées en bourse dans le monde. La capitalisation boursière, le nombre d’entreprises et la taille moyenne des entreprises sont indiqués pour les deux groupes d’entreprises par pays/région. Les données sont arrêtées à la fin de l’année 2017.
L’univers des sociétés cotées en bourse par pays/région 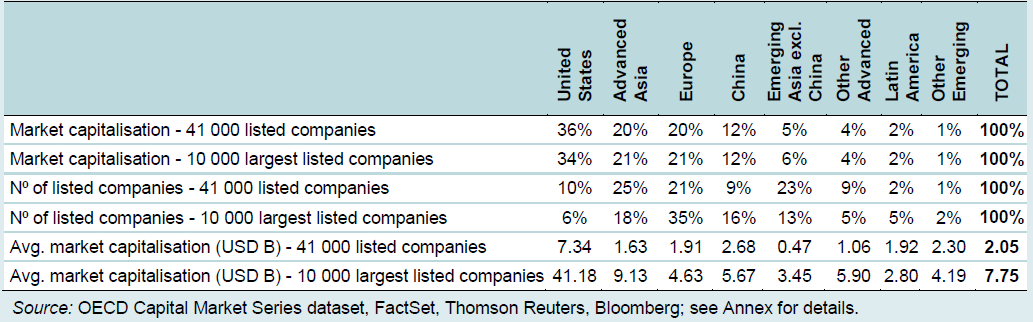
À la fin 2017, les marchés mondiaux accueillaient quelque 41.000 sociétés cotées, pour 84.000 milliards de dollars de capitalisation – l’équivalent du PIB mondial -. L’OCDE s’est penchée sur l’actionnariat des 10.000 plus grosses d’entre elles, qui représentent environ 90 % de la capitalisation totale.
Les informations relatives à la capitalisation boursière totale et au nombre d’entreprises cotées en bourse pour chaque marché inclus marché inclus dans l’analyse sont présentées dans le tableau suivant. Pour chacun des 54 marchés, il indique également la part de la capitalisation boursière et du nombre d’entreprises incluses dans l’ensemble de données provenant de ces 54 marchés. Pour un grand nombre des plus grands marchés, marchés, il suffit d’inclure environ 15 % des sociétés cotées pour couvrir plus de 85 % de la capitalisation boursière totale.. L’exception, parmi les plus grands marchés, est la Chine où la taille des entreprises est plus uniformément répartie et il faut inclure 42 % des entreprises pour couvrir 89 % de la capitalisation boursière. Pour les autres marchés, la moitié des sociétés doivent être incluses pour couvrir 85 % de la capitalisation boursière.
L’univers des entreprises cotées en bourse par marché, à la fin de l’année 2017
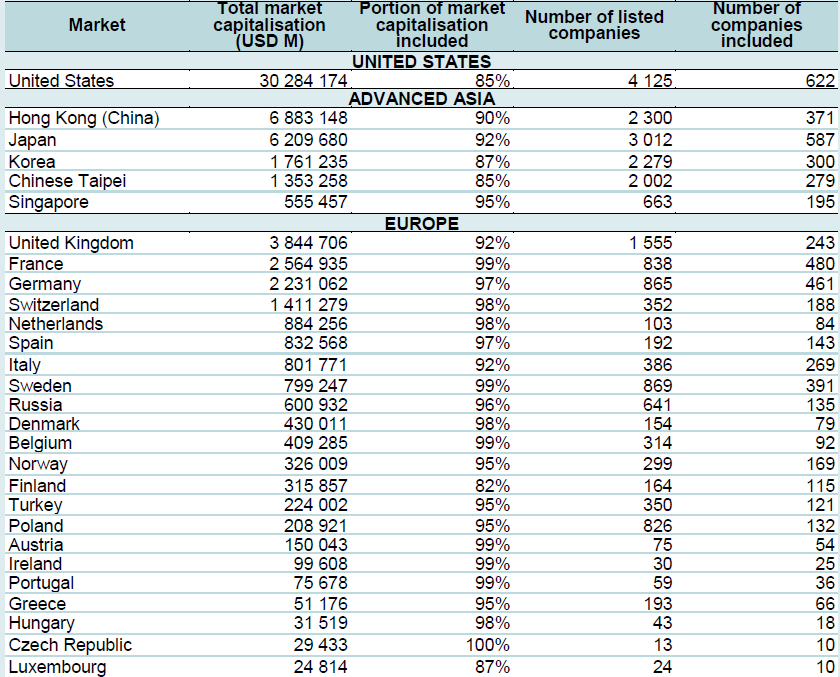
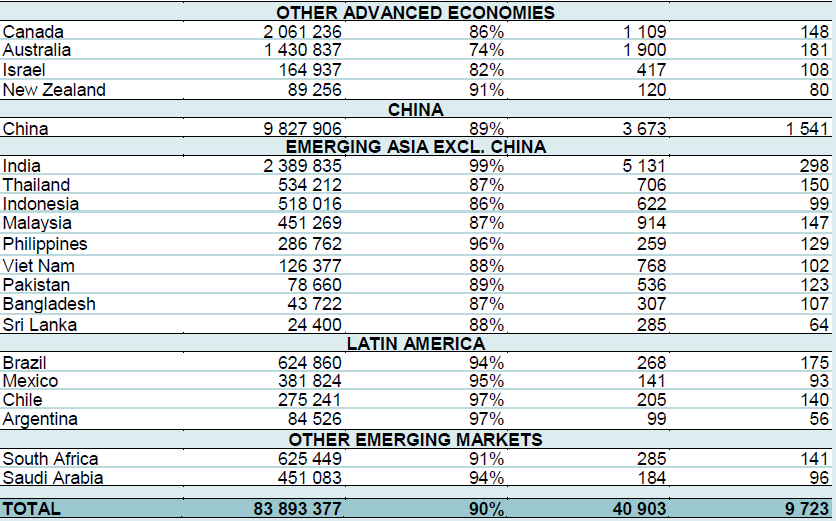
Source: OECD Capital Market Series dataset, FactSet, Thomson Reuters, Bloomberg; see Annex for details.
b) Structure de l’actionnariat par catégorie d’investisseurs
Les investisseurs en actions publiques se distinguent les uns des autres par leurs modèles d’entreprise commerciale, ce qui influe sur leurs incitations et leurs stratégies d’actionnariat, qui, à leur tour, influencent leurs incitations et leurs stratégies d’actionnariat. Ces différences ont une profonde sur la manière dont ils répartissent leurs capitaux entre les sociétés cotées, dont ils surveillent les performance des entreprises dans lesquelles ils investissent et la manière dont ils participent au processus de prise de décision des entreprises bénéficiaires en exerçant leurs fonctions d’actionnaire. En conséquence, le rapport dze l’OCDE classe les propriétaires en cinq catégories différentes d’investisseurs. Il convient toutefois de noter qu’à l’intérieur même de ces grandes catégories de propriétaires, des des différences significatives peuvent exister en ce qui concerne la capacité et les incitations économiques des propriétaires à d’exercer leurs fonctions de propriétaire.
1/ Les sociétés privées et les sociétés holding (ci-après « sociétés privées ») comprennent sociétés privées cotées et non cotées, leurs filiales, coentreprises et divisions opérationnelles. d’exploitation.
2/ Le secteur public comprend la propriété directe des gouvernements centraux, des gouvernements locaux, les fonds de pension publics, les entreprises publiques et les fonds souverains.
3/ Les personnes et familles stratégiques (ci-après « personnes stratégiques ») désignent les personnes physiques qui sont soit des propriétaires de contrôle, soit des membres d’une famille de contrôle, soit les détenteurs de blocs et les family offices.
4/ Les investisseurs institutionnels sont les fonds de pension, les compagnies d’assurance, fonds spéculatifs. Les avoirs des investisseurs institutionnels sont enregistrés selon pays de domiciliation, qui peut être différent du pays de domiciliation du bénéficiaire effectif.
5/ L’expression « autre flottant », y compris les investisseurs individuels (ci-après « autre flottant »), désigne les actions détenues par des investisseurs qui ne sont pas tenus de divulguer leurs avoirs. Il comprend les participations directes des investisseurs institutionnels qui ne dépassent pas les seuils requis pour la publication de leurs participations.
À la fin de l’année 2017, les avoirs combinés de toutes les catégories d’investisseurs dans les 10 000 plus grandes sociétés cotées en bourse s’élevaient à près de 75 000 milliards de dollars. Le panneau A de la figure suivante montre la répartition de ces 75 000 milliards USD entre les cinq catégories d’investisseurs pour les économies de marché avancées et émergentes. Pour compléter les informations sur les avoirs des investisseurs, le panneau B montre la répartition par pays et par région du marché mondial des actions.
Les investisseurs institutionnels sont de loin la catégorie d’investisseurs la plus importante dans le monde, avec plus de 30 000 milliards de dollars investis sur les marchés publics d’actions. Ces derniers détiennent 41 % du capital de l’ensemble des sociétés cotées. Cela représente trois fois le montant investi par les propriétaires du secteur public et six fois la valeur des investissements des individus stratégiques. Dans la catégorie des catégorie des investisseurs institutionnels, les investisseurs des États-Unis, du Royaume-Uni et du représentent respectivement 65 %, 11 % et 4 % des investissements institutionnels mondiaux en actions. Le secteur public, deuxième catégorie par ordre d’importance, détient 10 000 milliards d’USD sur les marchés publics d’actions. Dans ce secteur, la Chine représente 57 % du total des actions détenues par le secteur public sur les marchés boursiers mondiaux, avec un montant de 5 800 milliards d’USD. La catégorie « autre flottant » du graphique suivant comprend principalement les investissements directs des particuliers et les avoirs des investisseurs institutionnels qui sont inférieurs aux seuils de divulgation.
Le panneau B montre qu’au niveau mondial, 78 % des fonds investis sur les marchés publics d’actions sont détenus par des investisseurs des économies avancées et 22 % par des investisseurs des marchés émergents. Les États-Unis, qui sont traditionnellement le plus grand marché public d’actions au monde, représentaient 34 % de la capitalisation boursière mondiale en 2017. En raison de la forte croissance de l’utilisation des marchés publics d’actions en Asie au cours de la dernière décennie, la région dans son ensemble représente aujourd’hui 38 % de la capitalisation boursière mondiale. Les marchés boursiers de Chine et de Hong Kong (Chine) représentent la moitié de la part de la région, suivis par le Japon avec 20 %. La part totale des marchés d’Amérique latine en en termes de capitalisation boursière mondiale était inférieure à 2 %, ce qui est bien en deçà de la part de la région dans le PIB mondial.
Répartition de la propriété par catégorie d’investisseurs et capitalisation boursière mondiale par région/pays
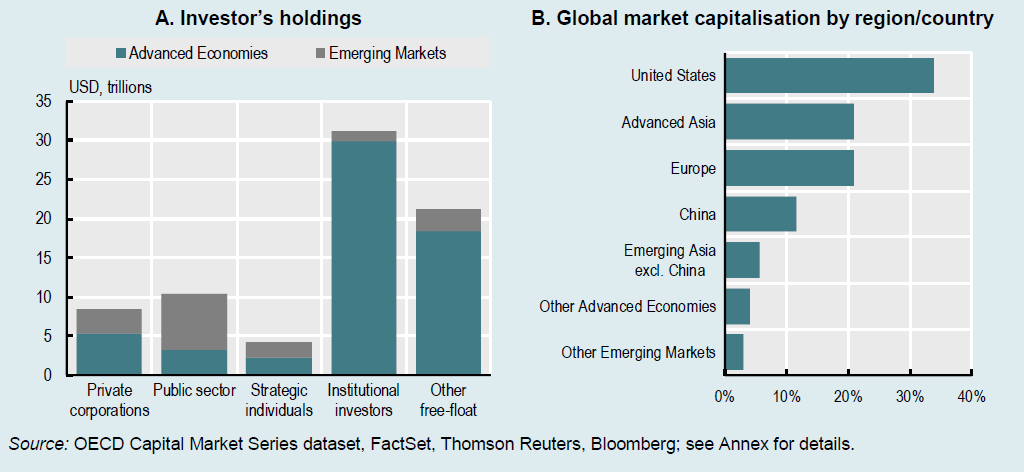
La présence et l’importance des différentes catégories d’investisseurs varient selon les régions (tableau suivant). Comme mentionné ci-dessus, les investisseurs institutionnels constituent la plus grande catégorie d’investisseurs au niveau mondial, détenant 41 % des actions publiques, soit l’équivalent de 31 000 milliards d’USD investis sur les marchés des actions publiques. Cette domination globale est largement due à leur présence significative dans les marchés avancés, notamment aux États-Unis. La présence des investisseurs institutionnels dans les marchés émergents est moins importante, avec 7 % des avoirs totaux. Le secteur public, qui est la deuxième catégorie d’investisseurs dans les sociétés cotées en bourse dans le monde entier, est un actionnaire important sur de nombreux marchés asiatiques, en particulier en Chine alors qu’il n’y détient qu’une part assez limitée. Les sociétés privées et les holdings représentent 11 % des marchés publics mondiaux d’actions, et les particuliers et les familles stratégiques 7%. Malgré leur présence relativement faible au niveau mondial, ils sont d’importants investisseurs dans les pays émergents d’Asie et d’Amérique latine.
Répartition de l’actionnariat régional par catégorie d’investisseurs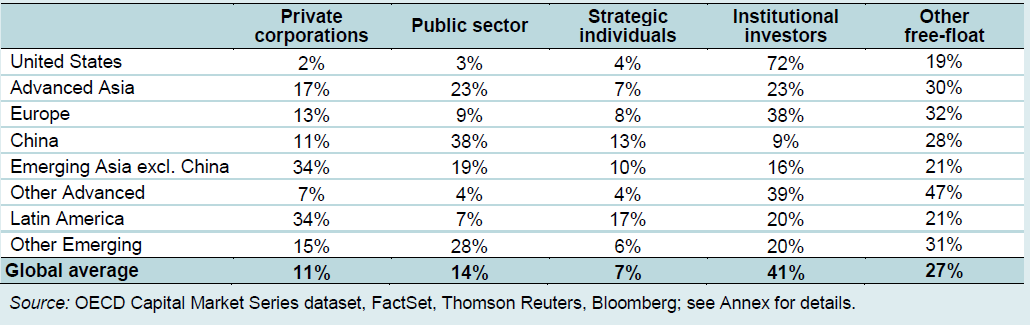
L’importance relative et la présence des différentes catégories d’investisseurs varient également beaucoup d’un marché à l’autre. Le graphique suivant présente la répartition de la propriété par catégorie d’investisseurs sur la base de la valeur totale en USD de leurs avoirs sur chaque marché. La figure montre que les sociétés privées et les holdings sont les principaux propriétaires sur plusieurs marchés, tels que le Chili, les Philippines et la Turquie, où elles détiennent respectivement 55 %, 48 % et 40 % du capital des sociétés cotées. Les personnes et les membres de la famille détiennent 34 % du capital total des sociétés cotées au Mexique. Ils sont également d’importants investisseurs en Israël et en Thaïlande, où ils détiennent 16 % du capital social des entreprises cotées en bourse. Le secteur public est un propriétaire important en Chine, en Arabie Saoudite, en Malaisie, Hong Kong (Chine) et en Norvège, où il détient entre 34 % et 46 % du capital total des sociétés cotées en bourse. Aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Canada, les investisseurs institutionnels sont très présents , détenant respectivement 72 %, 63 % et 47 % des actions cotées en bourse.
Répartition de la propriété par catégorie d’investisseurs en %
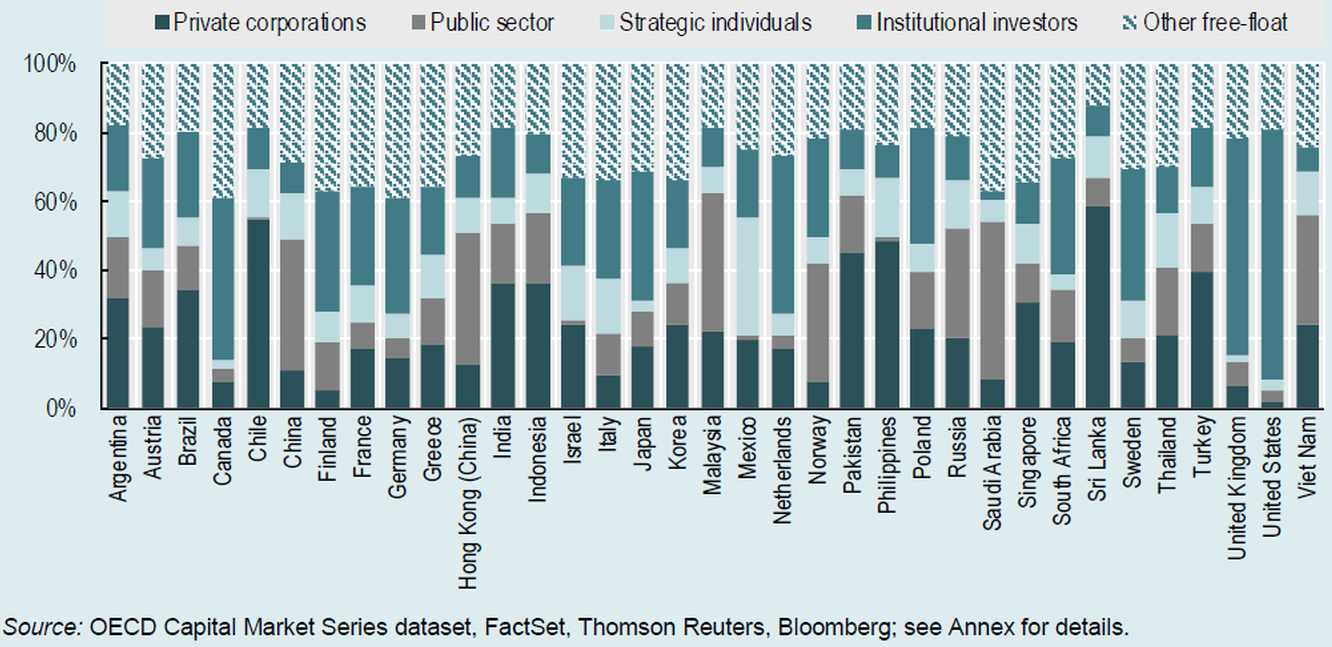
La figure montre la répartition des participations totales par catégorie d’investisseurs sur chaque marché pour l’univers des 10 000 sociétés les plus importantes cotées en bourse. Les participations par catégorie d’investisseurs sont agrégées à la valeur de marché en USD à la fin 2017 et exprimées en part de la capitalisation boursière totale de chaque marché. Les données couvrent la propriété d’origine nationale et étrangère. par exemple, en Argentine, les entreprises privées détiennent 32 % de la capitalisation boursière totale ; le secteur public en détient 18 % ; Les investisseurs institutionnels détiennent 19 %, les individus et les familles stratégiques 13 %, et le reste du marché argentin est détenu par des investisseurs privés. Le reste du marché argentin est détenu par la catégorie « autres investisseurs libres, y compris les investisseurs individuels »
2/ Internationalisation des marchés d’actions, autre trait de la financiarisation
Au cours des dernières décennies, la plupart des marchés avancés ont connu une augmentation significative de la propriété d’investisseurs étrangers. La figure suivante illustre cette évolution pour le Japon, le Royaume-Uni et les États-Unis. Au Japon, la participation étrangère est passée de 3 % à 30 % de l’ensemble des actions publiques entre 1980 et 2017. Au Royaume-Uni, la participation étrangère est passée de 4 % à 54 % et aux États-Unis, elle a triplé, passant de 5 % à 15 %.
Au total les investissements transfrontaliers représentaient à la fin 2017 près d’un quart des positions prises sur les marchés des actions. Ils proviennent essentiellement (à 75 %) des Etats-Unis et d’Europe. Les intérêts étrangers contrôlent en particulier plus de 40 % des entreprises cotées aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, au Brésil et en Argentine.
Comme le montre la seconde figure suivante, dans des pays comme les Pays-Bas, le Royaume-Uni, le Brésil et le Pakistan, les investisseurs étrangers représentent plus de 40 % de la participation au capital. Mais ils sont très minoritaires sur les deux premiers marchés mondiaux, à savoir les Etats-Unis – 36 % de la capitalisation mondiale, avec près de 30.300 milliards de dollars – et la Chine – 12 % avec 9.800 milliards -, où ils représentent moins de 15 %. En France, 28 % de la capitalisation boursière totale des sociétés cotées est détenue par des investisseurs étrangers. Le niveau significatif de l’actionnariat étranger observée à Hong Kong (Chine) s’explique principalement par le fait que de nombreuses entreprises chinoises sont cotées à Hong Kong (Chine) mais détenues par des investisseurs de Chine continentale.
Évolution des participations étrangères au Japon, au Royaume-Uni et aux États-Unis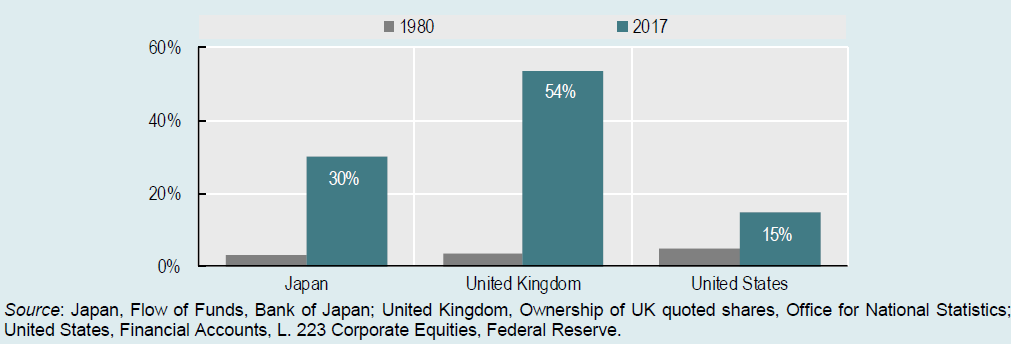
Investissements étrangers dans chaque pays en %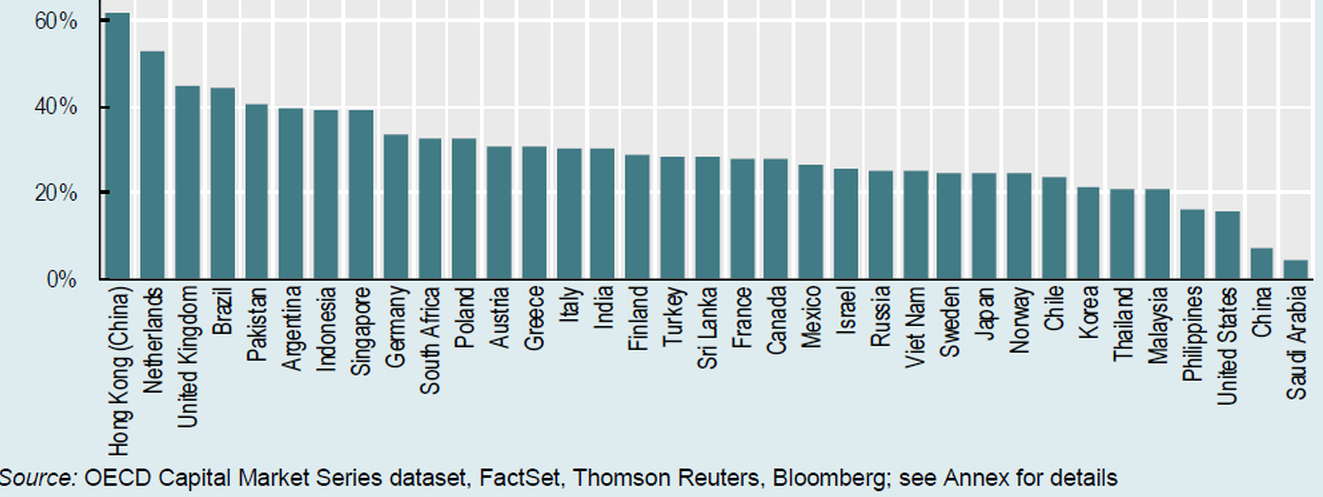
Les investisseurs institutionnels qui utilisent généralement des stratégies d’investissement de portefeuille diversifiées et qui suivent des indices s’engagent plus fréquemment dans des investissements transfrontaliers. En fait, sur la moitié des marchés, ils représentent plus de 50 % de l’ensemble de l’actionnariat étranger (graphique suivant). En outre, les sociétés privées et les holdings sont également d’importants investisseurs transfrontaliers, par exemple au Chili, en Indonésie, en Pologne, en Arabie Saoudite et à Singapour, elles constituent la catégorie la plus importante de propriétaires étrangers. Dans l’ensemble, les deux autres catégories, le secteur public et les investisseurs stratégiques, jouent en général un rôle relativement limité dans les investissements transfrontaliers en fonds propres. En France, 73% des participations étrangères correspondent à des investisseurs institutionnels.
Investissements étrangers par catégories d’investisseurs en %
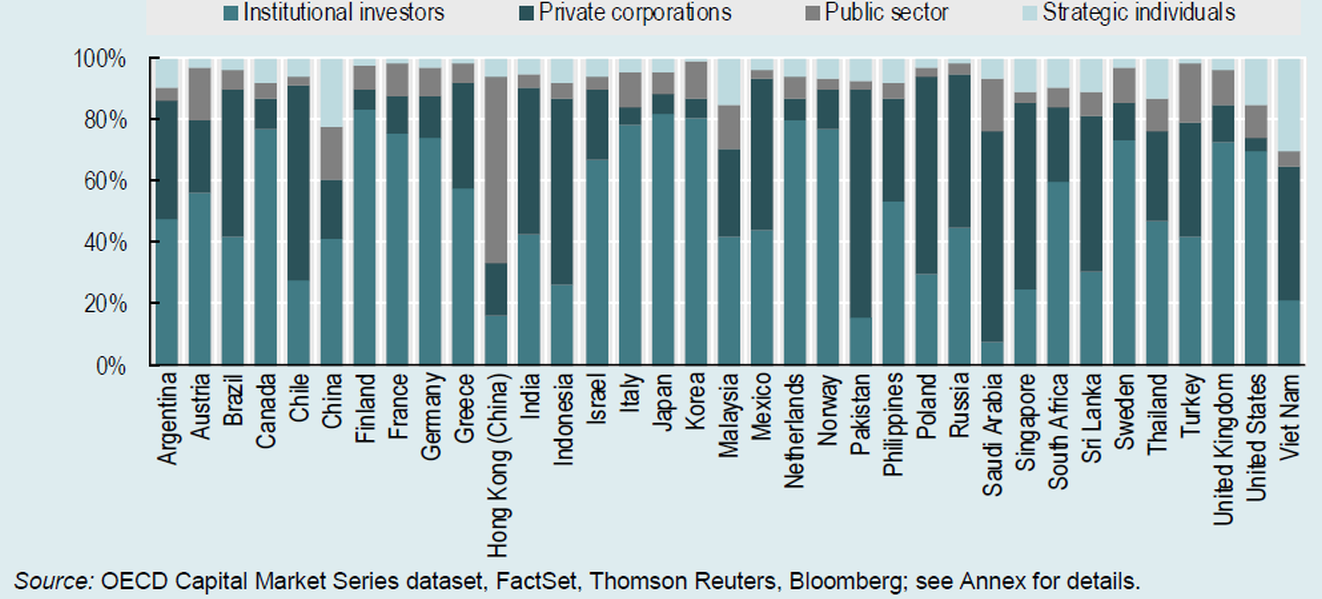
3/ La concentration de la propriété aux niveau de l’entreprise
Le capital des entreprises cotées reste donc très concentré. Les trois principaux actionnaires contrôlent plus de 50 % du capital dans la moitié des sociétés mondiales, et plus de 30 % dans les trois quarts d’entre elles. Dans seulement 1 % des entreprises cotées en bourse dans le monde, les trois principaux actionnaires détiennent moins de 10 % du capital de l’entreprise. Cette concentration est extrême en Argentine, en Russie et en Indonésie, où plus de 70 % des sociétés cotées sont contrôlées par un unique actionnaire. C’est aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, au Canada et au Japon que cette concentration est la plus faible. Mais même dans ces pays à très forte culture de marché, elle reste significative. En moyenne les trois principaux actionnaires y contrôlent entre 25 et 30 % du capital des sociétés cotées.
Le panneau A présente la part des entreprises dont le principal propriétaire détient différents niveaux de capitaux propres pour l’univers des 10 000 plus grandes entreprises cotées en bourse. Par exemple, dans 29 % des entreprises, le principal actionnaire détient plus de 50 % du capital social. Le panneau B présente la part des entreprises dans lesquelles les 3 principaux actionnaires détiennent des niveaux différents de capitaux propres. Les données se réfèrent à la fin de l’année 2017.
Répartition de la concentration de la propriété
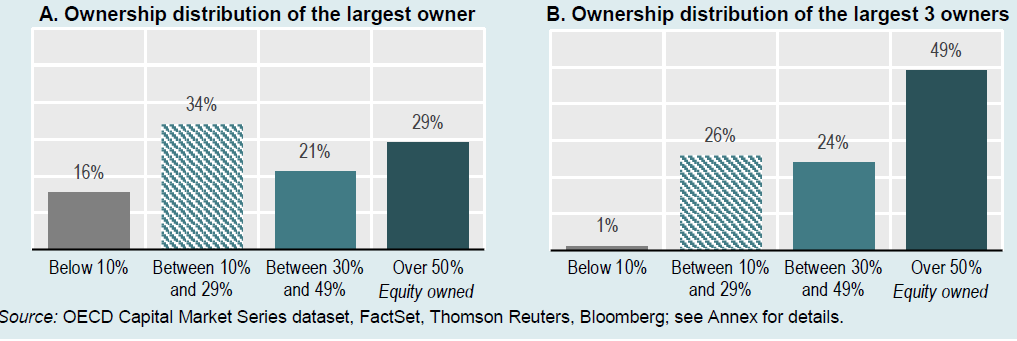
Part du ombre d’entreprises dont le plus grand et les trois plus grands actionnaires détiennent plus de 50 % des capitaux propres par rapport au nombre total de sociétés cotées sur chaque marché en %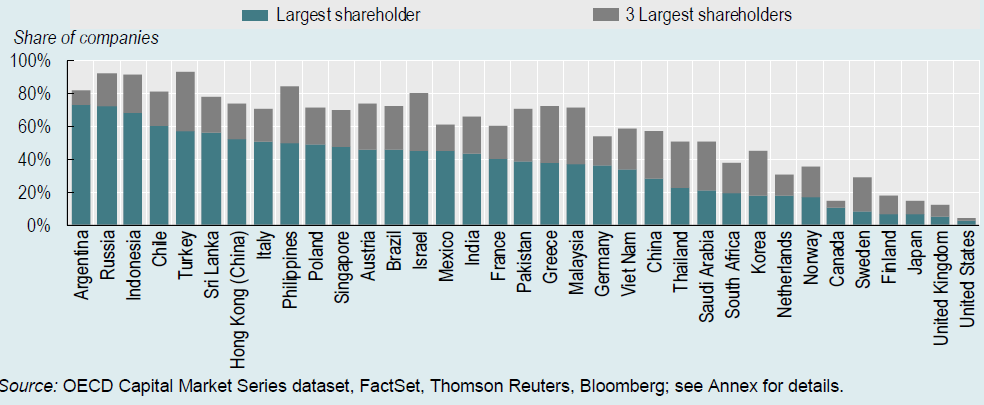
4/ En France, qui sont les plus grands actionnaires du CAC40 ?
Dans une étude, le groupe Euronext explique avoir identifié environ 61% des actionnaires du CAC40. L’une des difficultés est que les investisseurs ne sont tenus de déclarer leurs participations à l’Autorité des marchés financiers qu’à partir du seuil de 5% du capital ou des droits de vote. Néanmoins, sur cette base relativement importante, Euronext a dressé la typologie des porteurs du plus important indice de la Bourse de Paris sur l’année 2021.
a) Top 10 des actionnaires du Cac 40 en 2023
Il ressort que les groupes familiaux dominent, avec un pourcentage total de détention des groupes du CAC40 de 21,5% (en pourcentage de capitalisation totale de l’indice). Suivent les géstionnaires d’actifs avec 20,7%, les actionnaires individuels, avec 4,6%, les Etats et fonds souverains avec 4,2%, puis les investisseurs industriels (pour simplifier les entreprises non financières) avec 2,7%. Ces ratios ont évolué en 2023 (voir ci-dessous).
Top 10 des actionnaires du Cac 40 en 2023 en % des parts de capitalisation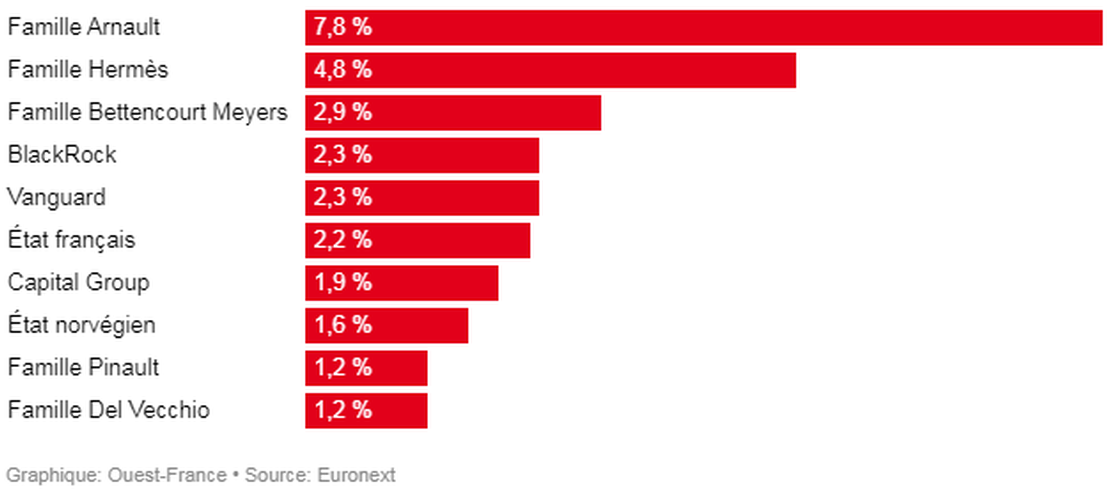
Le poids des actionnaires familiaux peut s’expliquer par la prédominance des acteurs du luxe dans la capitalisation du CAC 40. D’ailleurs le plus important actionnaire du CAC 40 n’est autre que la famille Arnault avec 7,8% de l’indice. La famille détient directement et indirectement 47,35% de LVMH, la plus importante capitalisation du CAC 40 (un peu plus de 410 milliards d’euros à l’heure actuelle) qui représente environ un sixième du poids total de l’indice, de l’ordre de 2.350 milliards d’euros en 2021. La famille Hermès (4,8%), qui possède 66,6% du sellier du même nom, la famille Bettencourt-Meyers (3,3%), qui détient 33,3% de L’Oréal, la famille Pinault (1,6%), dont la holding Artémis détient 41,7% de Kering, et la famille Dassault (1,2%) font également partie du top 10. Puis vient la famille Bettencourt Meyers (2,9 %).
La famille Dassault, via sa holding GIMD (groupe industriel Marcel Dassault) possède 40,2% des actions de l’éditeur de logiciels Dassault Systèmes et détient 62,2% de l’avionneur Dassault Aviation, qui possède lui-même 24,6% de Thales.
Le groupe issu de la fusion entre le constructeur français et Fiat Chrysler a indirectement permis à la famille Agnelli, via sa holding Exor qui détient 14,35% de Stellantis, de rentrer dans le cercle des actionnaires familiaux du CAC 40.
Les premiers gestionnaires d’actifs arrivent ensuite avec les américains BlackRock (2,3 %) et Vanguard (2,3 %), ce dernier dépasse pour la première fois l’État français actionnaire (2,2 %). Suivent Capital group (1,9 %), l’État norvégien (1,6 %), la famille Pinault (1,2 %) et la famille italienne Del Vecchio (1,2 %) qui prend la place de la famille Dassault cette année.L’Etat français, qui est notamment présent dans Thales, Orange, Engie, Airbus, Safran et Renault possède 1,9% du total. L’autre grand Etat actionnaire du CAC 40 n’est autre que la Norvège, via son fonds souverain, le plus important au monde, qui possède 1,4% du total de l’indice.
En l’espace de cinq ans, c’est-à-dire depuis 2016, le poids des actionnaires familiaux a nettement progressé, passant de 10% à 21%. Ce qui peut s’expliquer par la montée en puissance du luxe: l’action LVMH a été multiplié par quatre environ entre fin 2016 et fin 2021. Les inclusions de Dassault Systèmes (en 2018) et d’Hermès (en 2020) dans l’indice jouent aussi. De même que celle d’Eurofins, dernier arrivé dans le CAC en 2021 et détenu à 33% par la famille du fondateur Gilles Martin, et l’arrivée de Stellantis à la place de PSA.
Ce classement vient confirmer la tendance de fond sur le poids significatif des familles dans le secteur du luxe où cinq familles détiennent 18 % du Cac 40.
b) La montée des investisseurs particuliers
Autre enseignement de ce classement, toujours sur les 40 premières capitalisations françaises, les gestionnaires d’actifs arrivent en premier avec 26 % du Cac 40 (548 millions d’euros), les familles détiennent 21 %, les particuliers 5,3 % et les salariés 2,9 %. La part des particuliers dans cet actionnariat augmente pour passer de 4,6 % à 5,3 %. Ainsi, 20 sociétés en 2022 font part dans leur rapport de ces investisseurs qui atteignent 9 % de leur actionnariat. Les gestionnaires d’actifs sont diverses unités dont les fonds de pensions ou des des fonds d’investissement, etc… . C’est le gestionnaire d’actifs qui va définir l’achat ou la cession de titres. Le client peut aussi bien être un particulier qu’un investisseur institutionnel, comme un fonds de pension.
Cac 40 : répartition des participations par type d’actionnaires, en 2022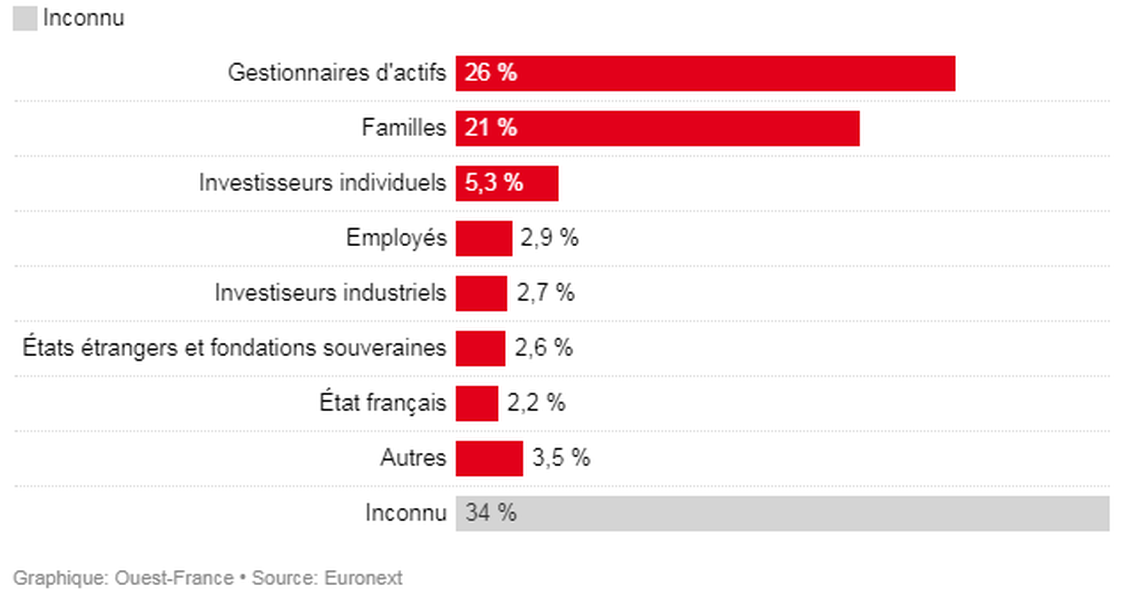
5/ Finalement les inégalités de patrimoine ressortent particulièrement sur les actions cotées
Les Français sont plutôt « fourmis » en ce sens qu’ils épargnent plus que les habitants des autres pays développés, soit presque 2 fois le PIB. Mais ils épargnent dans l’immobilier ou sur des supports sans risque. Les placements en actions cotées restent le parent pauvre en France. Ils ne représentent que 5,9 % des encours d’épargne financière des français au troisième trimestre 2023. Selon la Bnaque de France, les encours d’actions cotées étaient de 358 milliards d’euros sur un total de 6000 milliards de placements financiers des ménages (tableau suivant). Selon l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), le taux de détention d’actions a sensiblement reculé depuis la crise des subprimes de 2007-2008. En mars 2009, la part des personnes détenant des actions en direct, via un compte-titres ou un PEA (hors actionnariat salarié) atteignait 13 %. Elle n’est, en mars 2022, que de 6,7 %.
Détail des placements financiers (en milliards d’euros)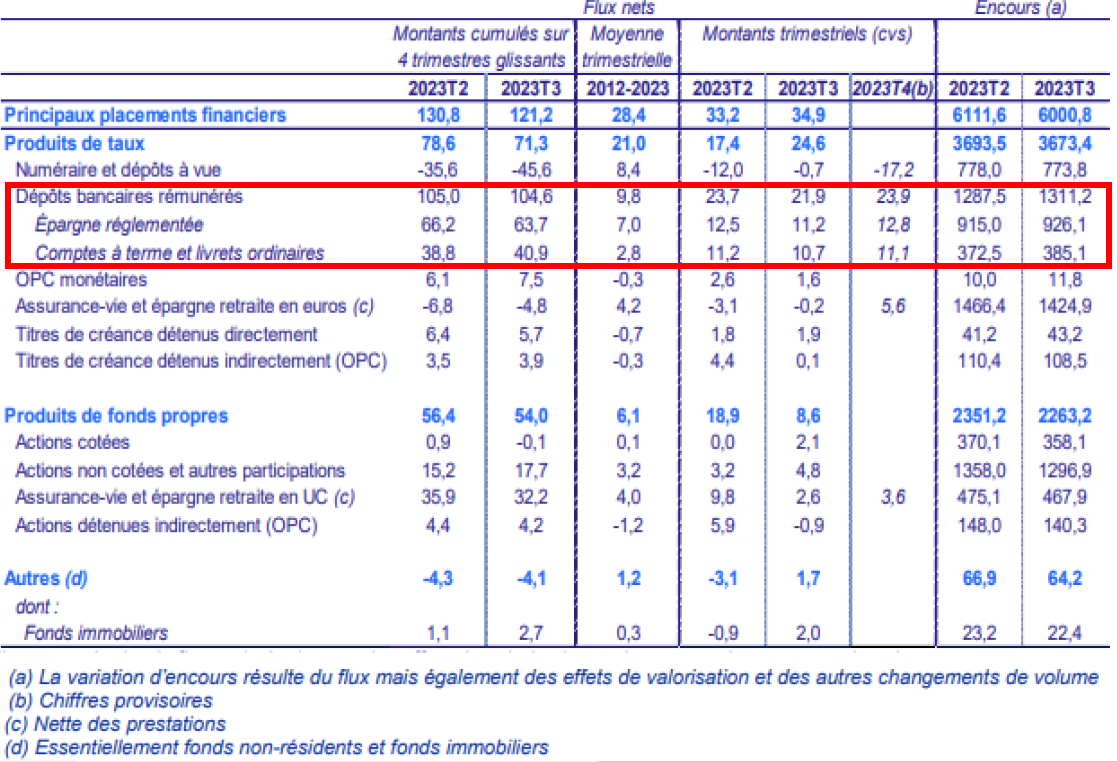 Source : Banque de France
Source : Banque de France
En fait ce sont essentiellement les riches qui achètent et détiennent des actions cotées. Comme pour d’autres types d’instruments (le patrimoine professionnel, l’assurance‑vie et retraite, les fonds d’investissement et les titres de créance), les inégalités de patrimoine ressortent particulièrement sur les actions cotées. Les deux graphiques suivants montrent que 10% des plus riches détiennent 39% du patrimoine immobilier au deuxième trimestre 2023, mais 86% des actions cotées. Et que ce caractère inégalitaire s’est renforcée depuis la crise financière (76% en 2009).
Actions cotées (en % du niveau détenu par tous les ménages)
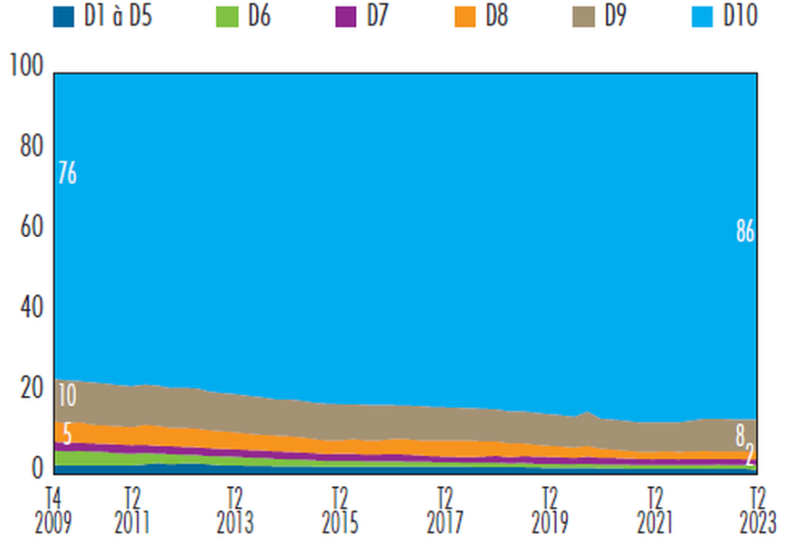
Patrimoine immobilier brut (en % du niveau détenu par tous les ménages)
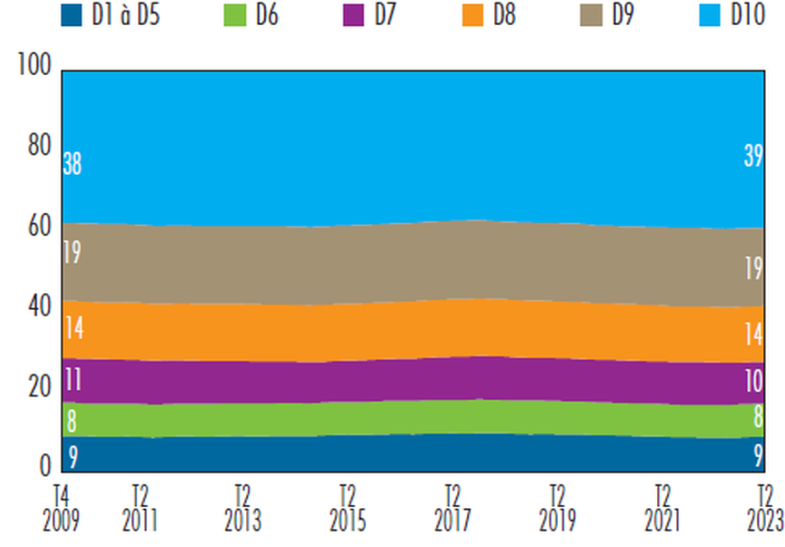
Source : Banque de France et Banque centale européenne
1/ les taux de marge des SNF sont relativement faibles en France
D’autres évolutions de ratios seraient significatives de la spécificité française des entreprises en matière financière. Mais comme déjà dit le choix des périodes est très important de même que la question de la comparabilité des taux de marge avec l’Italie et l’Allemagne.
Tout d’abord le taux d’investissement des sociétés non financières, qui baissait jusqu’en 2000 malgré des cycles, tend à augmenter en France dans les années 2000. Cette croissance ne se retrouve pas dans la plupart des pays sauf en Belgique. On note aussi que les variations du taux de marge déterminent en partie les variations du taux d’investissement avec un an de décalage.
En outre, et c’est peut-être l’évolution la plus significative, le taux de marge des sociétés non financières, déjà assez bas en France, malgré un net redressement durant la décennie 1980, a tendance à diminuer depuis 1995 (32,5%) pour atteindre 31,4 % en 2010,, ayant remonté à 31,9% en 2017. Il augmente souvent dans les autres pays entre 2000 et 2017 sauf en Italie où il baisse fortement et aussi au Royaume Uni ; mais dans ces deux pays, il reste supérieur. au taux de marge français, y compris en Italie malgré une correction nécessaire du à la comptabilisation de nombreux non-salariés dans les SNF (voir ci dessous).
Enfin les taux de marge des SNF n’évoluent pas complètement comme les taux de marge de l’industrie. C’est ainsi que de 2000 à 2017, le taux de marge des SNF de l’économie augmente de 1% dans l’UE (40,9% en 2017 contre 39,9% en 2000) tandis que le taux de marge des SNF perd 0,8 points en France (31,7% contre 32,6%). Dans le même temps, le taux de marge de l’industrie de l’UE gagne 5 points (45,1% contre 40%) tandis que ce taux perd 1,7 points en France (37% contre 38,7%).
2/ Mais des problèmes de comparabilité avec les taux allemands et italiens
Ce bas niveau du taux de marge s’explique en partie par un niveau relativement élevé des impôts sur la production. Une comparaison plus juste consisterait à ne retenir que le taux de marge net. Il reste que la part des rémunérations augmente relativement en France alors que cette part baisse dans les autres pays sauf en Italie. Mais cette part y est inférieure à celle de la France. En 1995, la part des rémunérations est la même en France et en Allemagne. En 2013, elle est de 7 points supérieure en France suite aux réformes Schröder intitulées « L’agenda 2010 ».
Mais le rapport du CNIS déjà cité insiste sur le classement différent des entreprises non salariales selon les pays et donc conduit à relativiser fortement les niveaux et les évolutions des taux de marge :
« Il apparaît ainsi que le champ des SNF n’est pas délimité de la même manière dans les comptes nationaux français que dans les comptes nationaux allemands et italiens. Plus précisément, les unités classées en SNF dans les comptes nationaux français ne comportent aucune situation de non salariat, alors que dans les comptes nationaux allemands, les SNF comptabiliseraient environ 1 million de non-salariés. Le phénomène serait plus marqué encore dans les comptes italiens, avec de l’ordre de 2 millions de non-salariés dans le champ des SNF. Ces différences de classement d’une partie des non-salariés ont une traduction directe sur le niveau du taux de marge : en effet, faute de pouvoir distinguer ce qui relève de la rémunération du travail des non-salariés de ce qui relève de la rémunération du capital immobilisé, la totalité du revenu des non salariés (« revenu mixte » en comptabilité nationale) est assimilé à de l’EBE dans les données transmises à Eurostat, ce qui relève ipso facto le taux de marge de l’Allemagne et l’Italie ».
« Il est toutefois possible de calculer un EBE corrigé du non-salariat en retranchant de l’agrégat EBE+revenu mixte publié par Eurostat une somme égale au nombre de non-salariés de chaque branche par la rémunération moyenne des salariés dans la branche considérée ». En procédant de la sorte, on obtient un taux de marge corrigé de la non-salarisation qui affiche des divergences en niveau entre pays beaucoup moins accentuées que pour le taux de marge des SNF« .
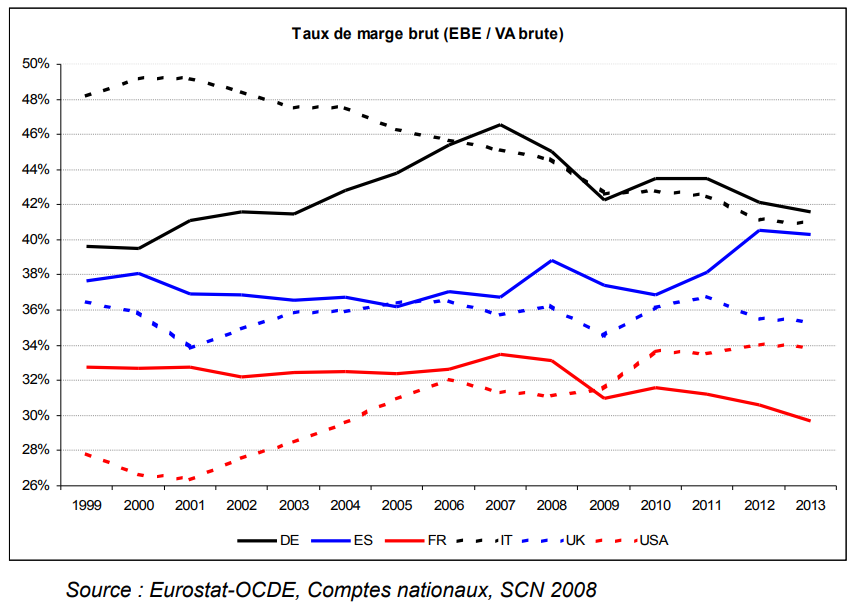
« Si l’on considère la France et l’Allemagne, on constate ainsi que l’écart de taux de marge en 1999 n’est plus que de 2 points, contre 7 points lorsque l’on considère le taux de marge des SNF, soit 5 points d’écart) (graphique suivant). En 2012, l’écart de taux de marge est d’un peu moins de 8 points si l’on considère le taux de marge des branches corrigé de la non-salarisation, contre près de 12 points si l’on considère le taux de marge des SNF (soit là aussi à un écart proche de 5 points). Le message d’une divergence d’évolution des taux de marge entre la France et l’Allemagne au cours des dix dernières années se confirme donc, mais on peut estimer qu’une part très substantielle de l’écart de taux de marge des SNF entre les deux pays – de l’ordre de 4 à 5 points – est attribuable à la présence de non salariés dans le champ des SNF allemandes. Pour l’Italie, l’écart en niveau de taux de marge avec la France serait imputable pour environ 7 points à la présence de non-salariés dans le champ des SNF« .
« Par ailleurs, les messages ne sont pas tout à fait les mêmes quant à l’évolution du taux de marge en Allemagne sur la période : le taux de marge des SNF, bien qu’ayant baissé depuis la récession, reste supérieur en 2012-2013 à son niveau de 1999 (d’environ 2 points). En revanche, le taux de marge des branches corrigé de la non-salarisation a retrouvé en 2012-2013 son niveau de 2000. On observe un phénomène similaire pour la France, où le taux de marge des branches corrigé de la non-salarisation baisse davantage que le taux de marge des SNF ».
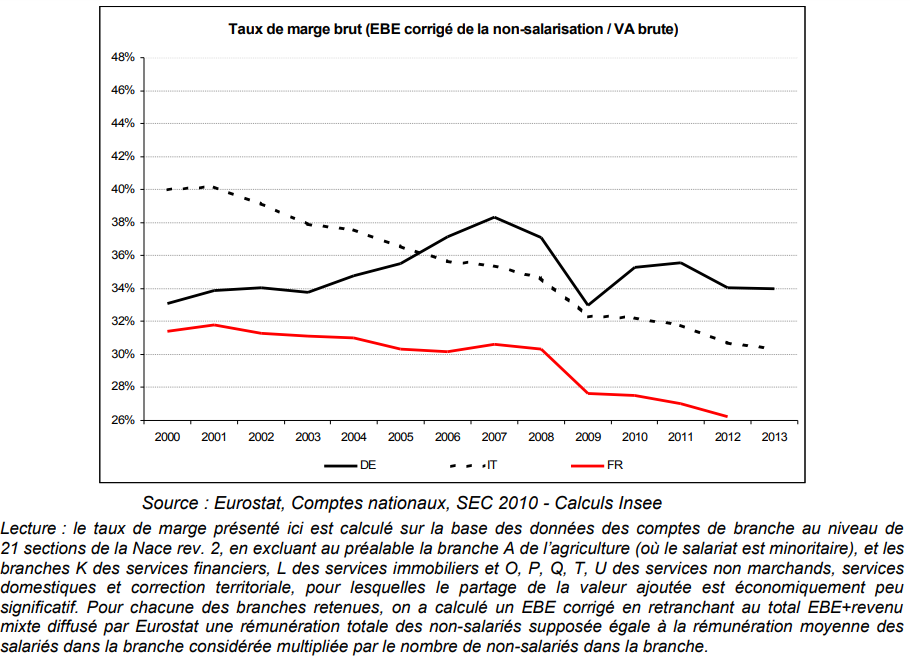
3/ Mise à jour des séries jusqu’en 2020 (méthode d’estimation et résultats)
À ces approximations peu satisfaisantes, on préférerait, évidement, des série homogènes et comparables entre pays. Mais on n’a d’autre choix que prolonger ces graphiques jusqu’en 2020 dans la mesure où la série des branches marchandes où il y a des SNF en nombre important (sections de la NAF NACE B à N sauf K et L), ne tient pas compte du classement spécifique des EI en Allemagne et Italie.
Tout d’abord, pour l’ensemble de ces branches marchandes où il y a des SNF en nombre important, on a calculé un EBE corrigé en retranchant au total EBE+revenu mixte d’Eurostat une rémunération totale des non-salariés supposée égale à la rémunération moyenne des salariés dans la branche considérée multipliée par le nombre de non-salariés dans la branche. Pour 2012, on retrouve quasiment les conclusions de l’étude présentée au CNIS : un taux de marge des SNF en Italie de 11,4% supérieur à celui de la France en 2012 alors que le taux de marge corrigé (de la non-salarisation) des « branches NACE B à N sauf K et L » est de 5,9% supérieur, soit un écart entre les deux de 5,5%. Pour l’Allemagne le taux de marge des SNF est supérieur de 9,8% quand celui corrigé des « branches NACE B à N sauf K et L » ne l’est que de 6,5%, soit un écart entre les deux de 3,3%.
Tableau-47-taux-de-marge-approche-SNF-EI-Eurostat-1 (1)
Taux de marge des branches des 3 pays (NACE B à N sauf K et L), corrigés de la non-salarisation en %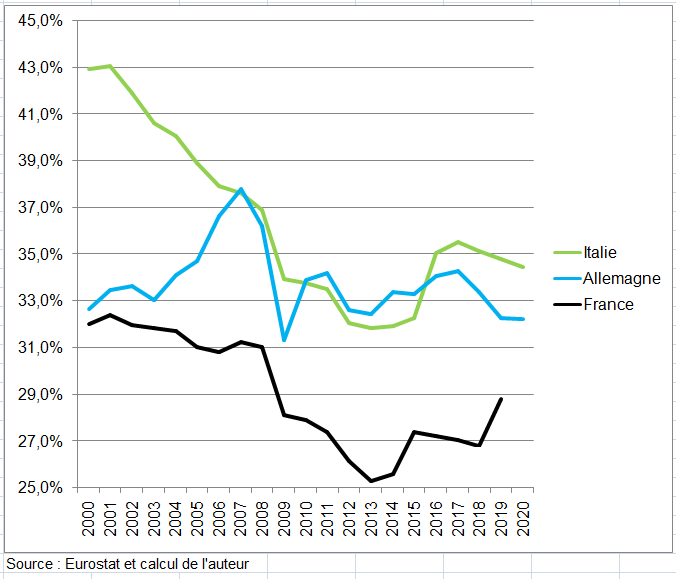
Le souci est que l’écart entre les ratios de la France et des deux pays varie dans le temps. Ainsi, pour l’Allemagne alors que la différence du taux de marge des SNF avec la France est de 6,6% en 2000, elle est de 5,9% pour les « branches NACE B à N sauf K et L » , soit un écart entre les deux de seulement 0,7%. Mais en 2012 on a vu que la différence du taux de marge des SNF avec la France est de 9,8% alors que celle du taux des « branches NACE B à N sauf K et L » est de 6,5%, soit un écart de 3,3%.
On devait tenir compte en partie de cette variation des différences pour ré-estimer au mieux les taux de marge des SNF (« taux retenu ») de l’Allemagne et l’Italie , de telle manière que l’évolution du taux de marge des SNF de la base Eurostat (graphique suivant) ne soit pas trop éloignée de l’évolution du « taux retenu » des SNF (voir encadré).
Les taux de marge des SNF de la base Eurostat (non corrigés) montrent un écart de 5 points entre le taux allemand et le taux français et de 11,6 points avec l’Italie en 2020 (premier graphique suivant) . Une fois les taux corrigés, l’écart n’est plus que de 3 points avec l’Allemagne et de 5 points avec l’Italie (second graphique suivant). Les données corrigées montrent que les taux de marge décroissent en Italie et en Allemagne depuis 2000 et tendent ainsi à se rapprocher du taux français tout en restant supérieurs. Les taux de marges non corrigés du premier graphique ne sont pas égaux aux taux spontanés du second graphique.
Taux de marge des SNF non corrigés dans la base Eurostat en %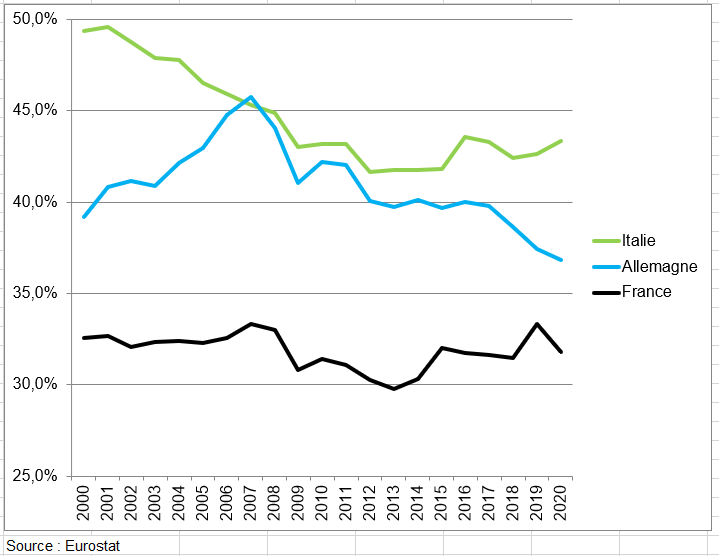
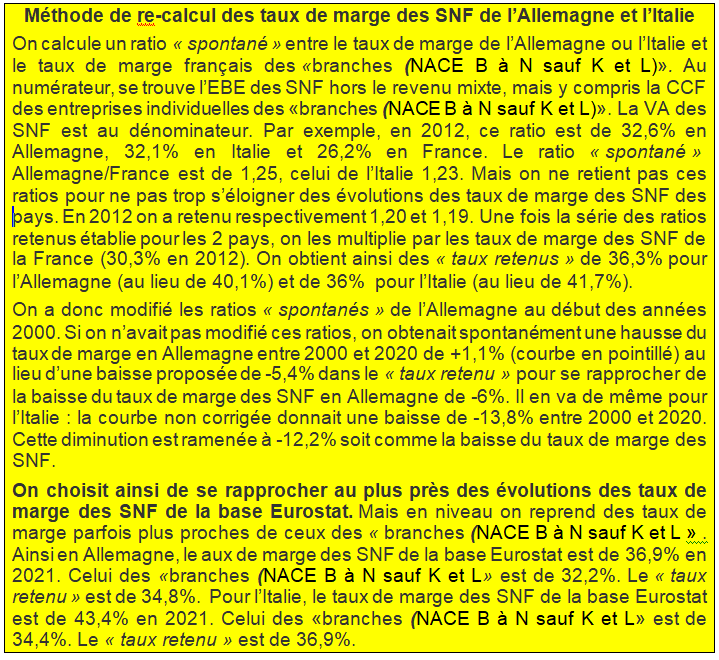
Tableau-48-taux-de-marge-SNF-France-allemagne-Italie-4
Taux de marge corrigé des SNF de l’Allemagne et l’Italie de 2000 à 2020 en %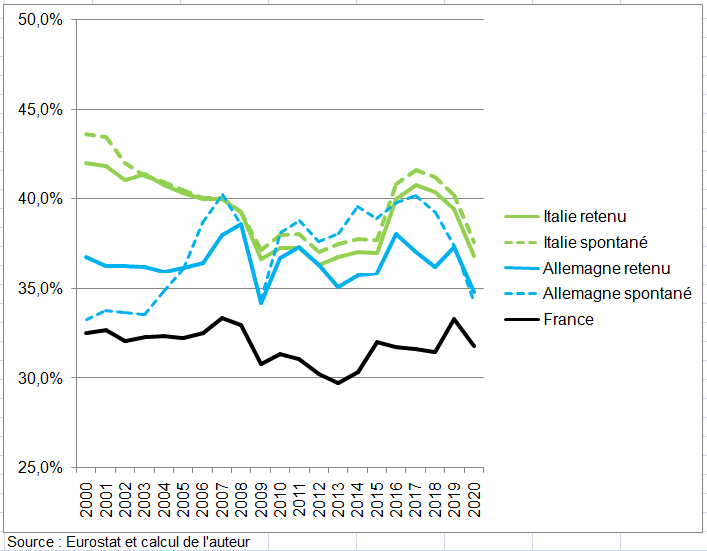
Comme déjà dit, il serait plus judicieux de comparer les données internationales des SNF-EI (S11, S14A). Mais elles ne sont pas disponibles. Eurostat publie soit les données des SNF (S11), soit celles de l’ensemble S14-S15 donc y compris les ménages purs (S14B) et les ISBLSM (S15). Outre les SNF, on s’est aussi intéressé aux sociétés financières (S12) vu l’importance des montants dans certains pays.
De même, il faudrait pouvoir établir une comptabilité de « qui à qui« . On sait que la somme des revenus distribués des sociétés versés (donc en emplois des comptes des secteurs institutionnels – SI) est égal à la somme des revenus distribués des sociétés reçus (donc en ressources des SI). On sait aussi que les APU et les ménages ne versent pas de revenus distribués des sociétés. Mais on ne sait pas vraiment de qui les sociétés non financières (SNF) reçoivent des revenus distribués entre les SNF, les sociétés financières (SF) et le Reste du Monde. Parfois, on retrouve certains circuits. C’est le cas des investissements directs à l’étranger (IDE) de la France vers le Reste du Monde : ces IDE s’accumulent et leur stock est à l’origine des revenus versés à l’investisseur, notamment sous forme de dividendes. Ces revenus sont inclus dans les 66,3 Mds de revenus distribués des sociétés en 2021 qui apparaissent en emplois du Reste du Monde et dans les 180,3 Mds et 51,1 Mds qui vont sur la même ligne des ressources des SI investisseurs à savoir les SNF et les SF (voir page chaînes de valeur mondiales pour le traitement comptable complet.
Les INS établissent en partie ces comptabilités de « qui à qui » pour les opérations D7 (autres transferts courants) et D9 (transferts en capital) pour faire les comptes mais ne les publient pas. En outre, ils ne le font pas pour les opérations D4 (revenus de la propiété) On renonce ainsi à décrire le réseau complet des relations bilatérales entre les groupes d’agents économiques. Des comptes écrans (dummy accounts) sont introduits pour chaque type d’opérations. Ils masquent les relations directes d’agent à agent et montrent pour chaque groupe d’agent son crédit et son débit au titre de l’opération considérée. Par exemple, on a le total des dividendes versés par les SNF, ou par l’étranger, etc… d’une part, et le total des dividendes reçus par les ménages, d’autre part, mais pas le montant versé par les SNF aux ménages. L’ensemble du système est synthétisé dans le tableau économique d’ensemble en France (comptes économiques intégrés dans le SCN 2008 et le SEC 2010).
Donc on ne peut pas exactement faire le solde entre les revenus distribués des sociétés versés et reçus pour un SI donné, et rapporter ce solde à la valeur ajoutée de ce SI parce qu’une partie des revenus reçus provient d’autres SI. Mais on le fait quand même en première approximation.
De même, les INS ne fournissent pas d’information sur la distribution des dividendes par branches, et en particulier dans l’industrie. Or, c’est une donnée essentielle pour mieux comprendre le comportement des entreprises de ce secteur exposé à la concurrence internationale. Pour la France, il faudrait combiner les données de l’Insee sur le taux de marge dans l’industrie avec celles de la Banque de France sur la part des actionnaires dans le revenu global. On n’a pas fait ces calculs, considérant qu’il fallait utiliser une seule source Eurostat, qui compile les données des comptes nationaux des pays européens dans un cadre comptable unifié.
Le rapport du CNIS recommande une comparabilité en flux nets : « De manière générale, dans les comparaisons internationales de la rémunération du capital mis à disposition des entreprises, il convient de raisonner plutôt sur les flux nets, que l’on considère les intérêts, les dividendes ou d’autres catégories de revenus de la propriété. En effet, dans de nombreux pays, on observe de nombreux flux de revenus de la propriété entre unités légales constitutives d’un même groupe. Raisonner sur les flux bruts tend donc à majorer artificiellement l’importance des flux de rémunération du capital. De plus, l’importance de ces flux internes aux groupes peut varier considérablement en fonction de l’organisation interne des groupes, laquelle peut différer d’un pays à l’autre en fonction de caractéristiques juridiques ou fiscales propres à chaque pays. Raisonner en termes de flux nets est donc préférable du point de vue de la pertinence des comparaisons entre pays ».
Ce même rapport met enfin en évidence les difficultés méthodologiques que posent les comparaisons internationales – et donc le fait que les résultats doivent être interprétés avec un minimum de précaution – via l’exemple précédent des comparaisons en matière de taux de marge (EBE / VA) des SNF.
Enfin, on peut aussi se demander si d’autres pays ont déjà introduit le profilage dans leur comptes, sachant qu’en France les flux enregistrés en comptabilité nationale le sont encore entre unités légales malgré le profilage des entreprises ? En effet, à l’intérieur d’une entreprise profilée, les dividendes devraient être consolidées entre unités légales de celle-ci.
1/ les revenus distribués reçus et versés des SNF et financières (SF) en niveau absolu
Le premier constat, c’est le montant faible en France des revenus distribués (en grande partie des dividendes) reçus par les ménages par rapport à ceux reçus par les SNF. En France, la financiarisation c’est d’abord celle des entreprises. Ce rapport entre les deux est de 25%, alors qu’en Allemagne les revenus distribués reçus par les ménages sont plus de 3 fois supérieurs à ceux reçus par les SNF; au Royaume Uni, ils sont 2 fois supérieurs. Mais que recouvrent ces revenus distribués aux ménages en Allemagne et en Italie ? Ces revenus distribués reçus (D42) par les ménages sont assez faibles en France par rapport à ceux des 2 pays : 27% de ceux du Royaume Uni, 14% de ceux de l’Allemagne.
Une partie des revenus distribués (D42) aux ménages inclut les « prélèvements sur les revenus des quasi-sociétés » (D.422) outre les dividendes (D.421). On a vu que les premiers seraient importants en Allemagne et en Italie. Dans les pays où l’information existe, ils ne représentent toutefois que 12% des dividendes versés aux ménages aux Pays Bas, 25% en Finlande, 1% en Suède et en Suisse.
1/ Malgré ceci, on notera d’abord que le poids des flux de dividendes internes aux sociétés non financières (SNF) est beaucoup plus fort en France que dans la plupart des pays de taille comparable. Cet aspect de la financiarisation serait presque plus puissant en France.
Les « revenus distribués des sociétés versés » (D42) par les SNF ont augmenté de 228 milliards d’euros dans l’UE des 27 pays entre 2010 et 2021 (+23,5%) , dont +37 Mds en Allemagne et un peu moins en France (respectivement +13,5% et +18%) et -16 Mds en Italie (-10%), tandis qu’ils ont encore plus progressé en Suède et surtout au Royaume-Uni (autour de +65%).
De leur coté, les « revenus distribués » (D42) reçus par les SNF » ont augmenté de 32 milliards d’euros en France entre 2010 et 2021 (+22%) contre +37,5 Mds en Allemagne (+76%) et -0,45 Mds en Italie (-2,5%) mais +155 Mds dans l’UE des 27 pays (+39%), évolution encore bien plus forte avec le Rotaume-Uni (+120% entre 2010 et 2019). En sachant que leur niveau est bien plus élevé en France que dans les autres pays.
2/ Sous réserve des remarques précédentes, les revenus distribués (D42) des sociétés reçus par les ménages sont relativement faibles en France. Ils augentent certes entre 2010 et 2021 : +19% econtre autour de +14% dans l’UE à 28 pays en tenant compte d’une estimation pour le Royaume Uni et +8% dans l’UE des 27 pays, et seulement +3% en Allemagne et -16% en Italie. On note une croissance très forte au Royaume-Uni jusqu’en 2019.
À moins d’être mal évalués, plus comparables sont les dividendes reçus par les ménages. En hausse dans les pays où ces données sont disponibles (mais pas en Allemagne, en Italie et au Royaume-Uni), ils sont en baisse en France et en Suède surtout en 2013 et 2020 (avant dernier graphique ci-dessous) alors qu’ils augmentent légèrement en Belgique, aux Pays-Bas, et surtout en Suisse.
En conclusion, on constate le montant très élevé en France des revenus distribués (D42) des sociétés, reçus par les SNF. Mais ce phénomène est antérieure à la période 2011-2020.
De leur côté, les dividendes (D421) reçus par les ménages ne progresseraient pas tant que ca en France entre 2010 et 2021 (+20%), moins que dans les autres pays où ces données sont disponibles, et probablement moins que dans les grands pays (Allemagne, Italie, Royaume-Uni), de même que les revenus distribués (D42) des sociétés reçus par les ménages, contrairement aux évolutions dans certains autres autres pays, sous réserve que les données sont comparables et bien estimées dans les différents pays. La financiarisation française était très forte avant la crise 2008, moins depuis sauf en 2022. Une explication possible vient du fait que la dette allemande étant en chute libre, les ménages n’achètent plus de la dette comme en France, mais des actions d’entreprises plus florissantes qu’en France. On a vu que les ménages français, eux, achètent moins d’actions que dans les autres pays, préférant des placements moins rémunérateurs mais plus surs (fonds en euros de l’assurance-vie, livret A,..).
Ceci ne tient pas compte toutefois de la diversité des actionnaires. Les « gros » actionnaires des grandes entreprises connaissent-t-ils la crise (voir ci-dessus) ? Cours de la Bourse et dividendes sont repartis à la hausse en 2021. La France serait un pays où les très riches s’enrichissent de manière régulière sur le long terme. Ni les crises, ni le niveau des impôts sur le patrimoine n’y feraient obstacle. Deux ans après le début d’une crise économique majeure, ils s’avèrent protégés des chocs. Les riches ont épargné pendant la crise du Covid 19 (voir page Inégalités de revenus).
Enfin, on retrouve la chute de 2020 pour les dividendes (D421) reçus par les SNF en 2020. Entre 2010 et 2021, ceux-ci progressent un peu plus vite que ceux reçus par les ménages : respectivement +23% et +20%. Dans les autres pays, les dividendes reçus par les SNF augmentent plus autour de +45%. voire +75% en Belgique. Mais cette progression est encore plus forte pour les ménages (voir ci-dessus)
Les fichiers suivants reprennent toutes les données d’Eurostat présentées sur les revenus distribués des sociétés (D42), et des dividendes (D421) quand ils sont disponibles.
Tableau 27 D42 D421 B1G eurostat 1999-2021N
Tableau 27 dividendes SNF Eurostat
Revenus distribués (D42) des sociétés versés par les SNF en milliards d’euros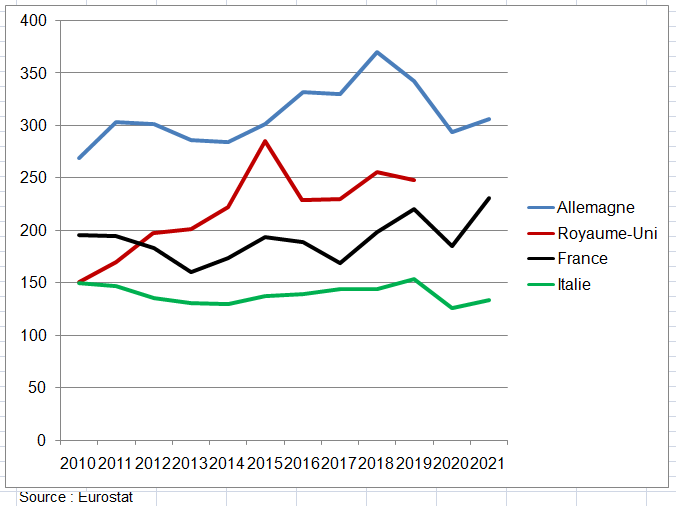
Revenus distribués (D42) des sociétés reçus par les SNF en milliards d’euros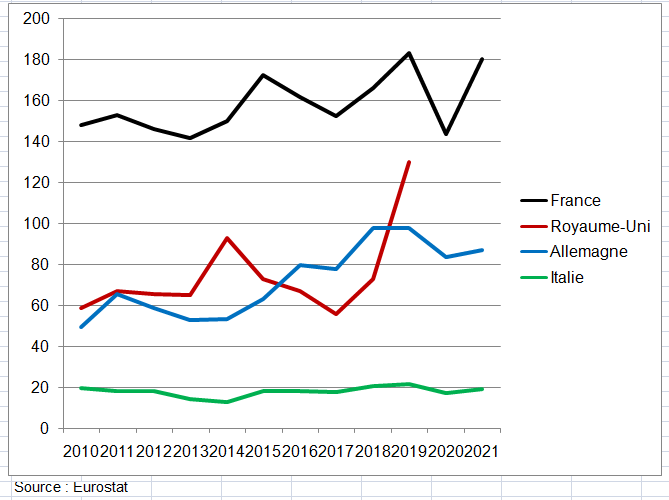
Revenus distribués (D42) des sociétés reçus par les ménages en milliards d’euros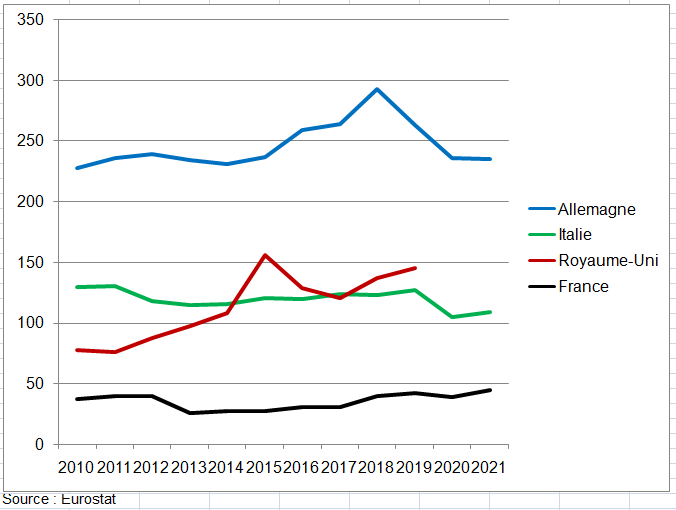
Dividendes (D421) reçus par les ménages en milliards d’euros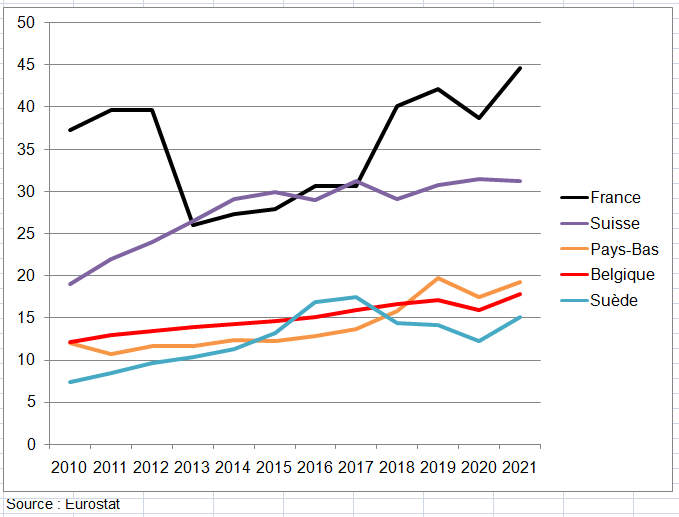
Dividendes (D421) reçus par les SNF en milliards d’euros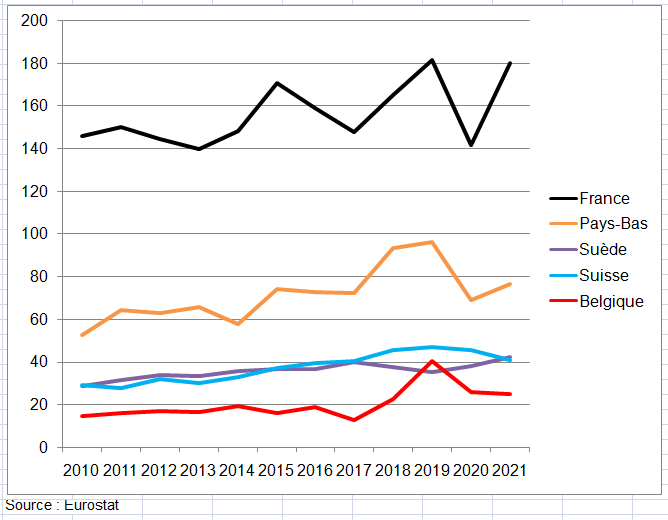
Mais au delà de la baisse en 2020, on est surpris par l’importance des revenus distribués (D42) des sociétés reçus par les SNF qu’on retrouve en part dans leur VA même si leur part diminue dans le total de ces revenus de l’UE (voir ci-dessous). Comment l’expliquer ? Ces revenus seraient-ils moins élevés dans les autres pays du fait du profilage d’entreprise (EP) non encore intégré dans les comptes français toujours élaborés à partir des unités légales (UL)? Ceci est peu probable. En revanche il n’est pas impossible que les UL soient moins importantes dans d’autres pays qu’en France, limitant les échanges de revenus distribués des sociétés entre les UL d’une même EP.
À quoi servent ces revenus distribués (D42) des sociétés reçus par les SNF ? À financer des investissements? À racheter d’autres actions? À délocaliser à l’étrangeretc, … ? On note que leur taux d’investissement n’est pas plus élevé en France que dans l’UE et qu’il n’augmente pas plus entre 2011 et 2020 (voir ci-dessous).
En revanche on observe une délocalisation importante des multinationales françaises depuis 25 ans, plus que dans les autres pays de l’UE (voir page chaînes de valeur mondiales), entraînant de nombreuses fermetures d’usines. Ces délocalisations devaient leur permettre de maintenir leur compétitivité au niveau mondial, voire d’améliorer la rentabilité.
S’agissant des ménages le rapport entre les revenus distribués des sociétés reçus par les ménages sur l’ensemble des revenus distribués reçus par les SI est il pertinent? Le niveau élevé de ce ratio en Allemagne et en Italie est lié au fait que certaines EI se retrouvent dans les SNF. Ou bien la présence au sein des SNF des quasi-sociétés dans ces 2 pays fausse les comparaisons internationales dans la mesure où ces entreprises ne pèsent pas le même poids dans tous les pays, ce qui revient à inclure dans les revenus distribués des entreprises des revenus qui s’apparentent beaucoup plus à une rémunération du travail qu’à celle du capital. On présente néanmoins ce ratio en concluant qu’il est assez faible en France (13,7%) mais qu’il l’est encore plus aux Pays-Bas ou au Danemark.
Part des revenus distribués des sociétés reçus par les ménages dans le total de ces revenus reçus par tous les secteurs institutionnels en %
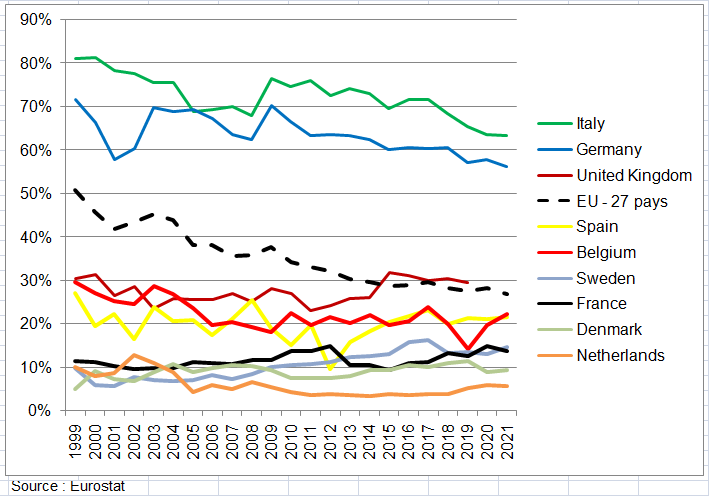
a) Les sociétés non financières (SNF)
D’autres comparaisons européennes sont intéressantes à plus long terme. D’un coté, la part française des « revenus distribués des sociétés » versés par les SNF dans le total des revenus distribués versés de l’UE des 28 pays, (en estimant et considérant fictivement le Royaume Uni comme faisant partie de l’UE jusqu’en 2021), a connu une forte progression en pourcentage depuis 1999, passant de 12,2% des revenus distribués (D42) à 16,3% en 2021 après un maximum de 17,6% en 2010 (tableau suivant).
Revenus distribués des sociétés « versés » (D42) des SNF (S11) en milliards d’euros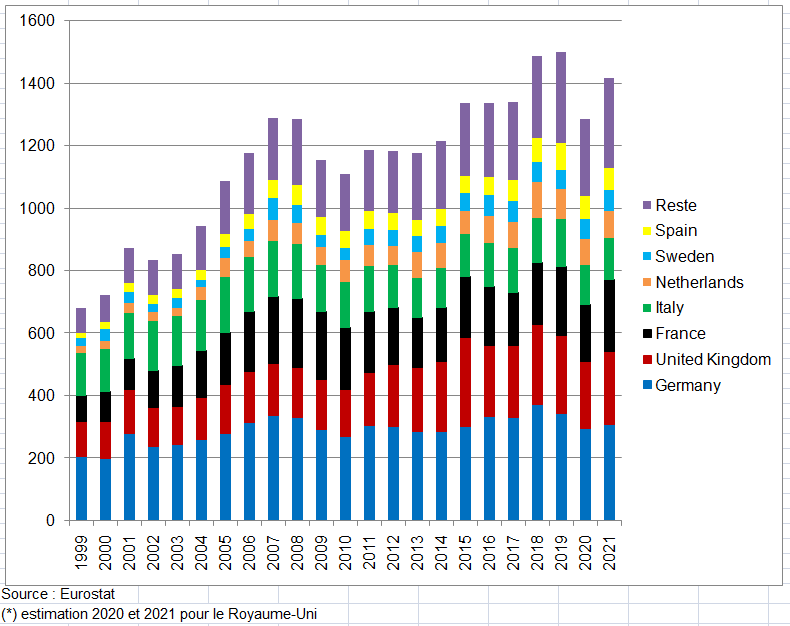
Part des des revenus distribués des sociétés « versés » (D42) des SNF (S11) en % dans le total des pays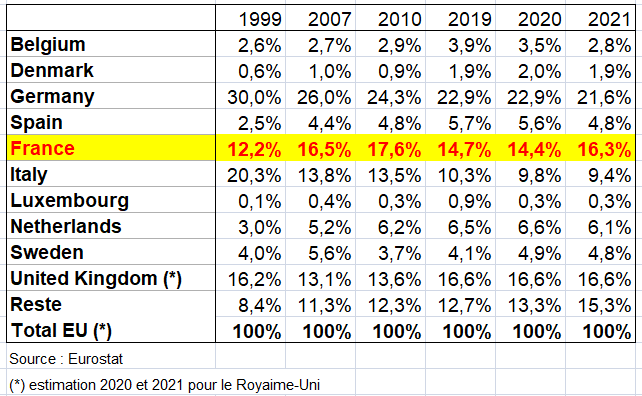
Plus significative de la financiarisation en France est l’importance des revenus distribués des sociétés « reçus » par les SNF. Elle est le pays où cette part est la plus élevée. Mais elle décroit de 38,5% en 1999 à 27,4% en 2021 dans l’ensemble des pays de l’UE (avec un minimum en 2020 : 24,4%). On note la bonne progression de la part des Pays-Bas : 5% en 1999 et 11,5% en 2021 et dans une moindre mesure de la part de l’Allemagne.
Revenus distribués des sociétés « reçus » (D42) des SNF (S11) en milliards d’euros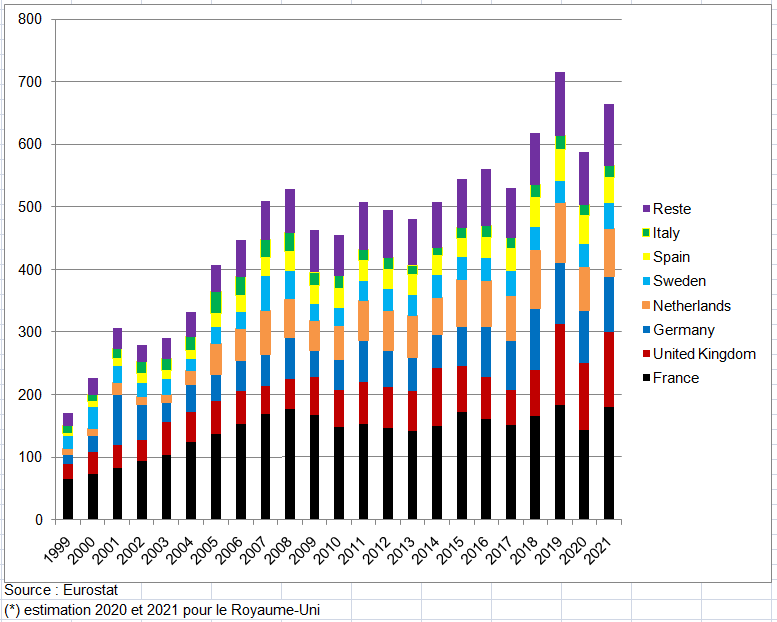
Part des des revenus distribués des sociétés « reçus » (D42) des SNF (S11) en % dans le total des pays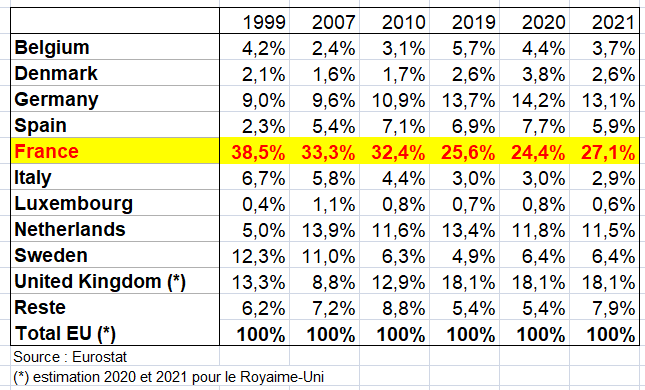
b) Les sociétés financières (SF)
Toutefois, pour le secteur S12 (sociétés financières), c’est le contraire qui se produit. La part de la France dans les « revenus distribués des sociétés » versés, passe de 10,7% en 1999 à 6,1% en 2021 avec une chute de ce ratio en 2020 (8,1% en 2019). Il est vrai que les parts du Luxembourg et surtout des Pays Bas augmentent très fortement. Les évolutions sont assez similaires pour les revenus distribués des sociétés « reçus » par les SF, avec des montants particulièrement élevés de nouveau au Luxembourg et aux Pays-Bas. Ces deux pays sont traditionnellement utilisés pour la structuration d’investissements transfrontaliers grâce notamment à leurs régimes mère-fille, à leurs vastes et avantageux réseaux de conventions fiscales ainsi que pour des raisons non fiscales tels que des traités bilatéraux d’investissements, un droit des sociétés souple, une situation centrale, un marché du travail et des services bien développés enfin un environnement politique et juridique stable. Le rôle des sociétés financières y est prédominant.
Revenus distribués des sociétés « versés » (D42) des sociétés financières (S12) en milliards d’euros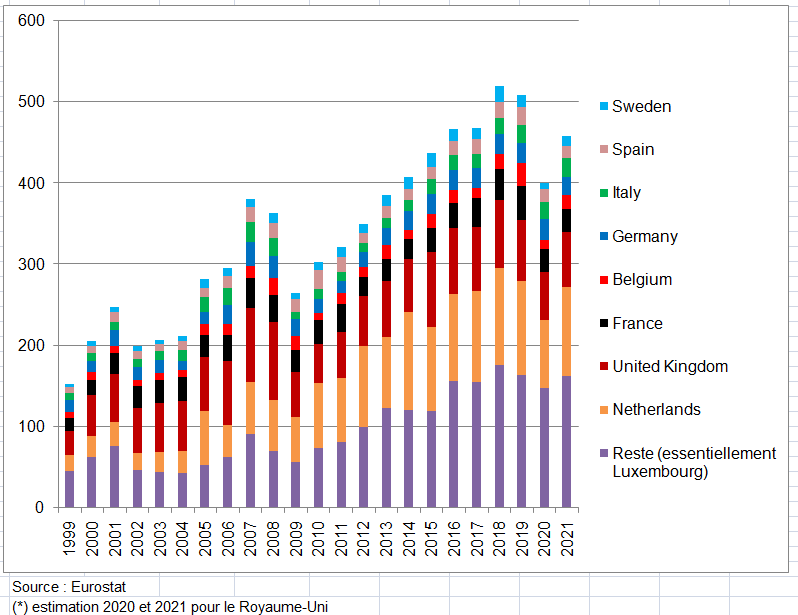
Part des des revenus distribués des sociétés « versés » (D42) des SF (S12) en % dans le total des pays de l’UE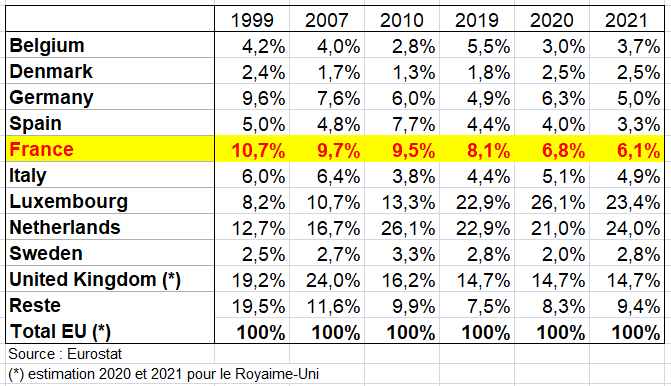
Revenus distribués des sociétés « reçus » (D42) des sociétés financières (S12) en milliards d’euros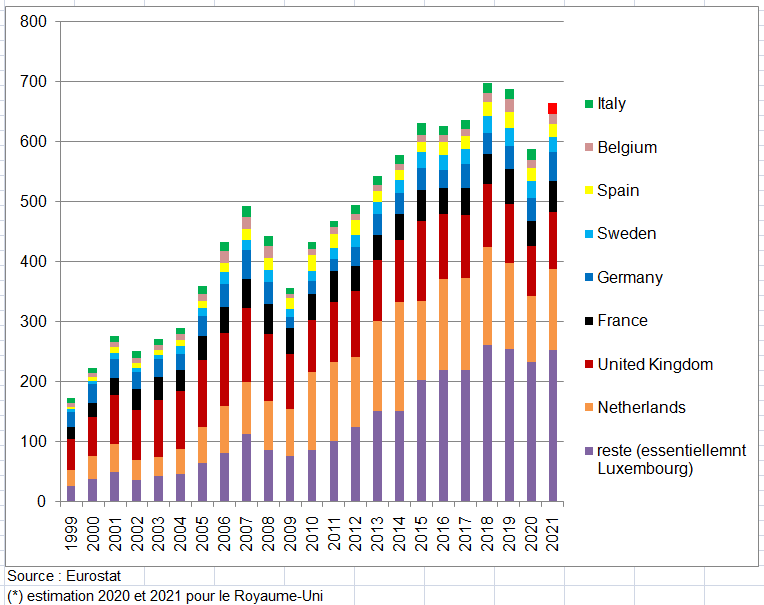
Part des des revenus distribués des sociétés « reçus » (D42) des SF (S12) en % dans le total des pays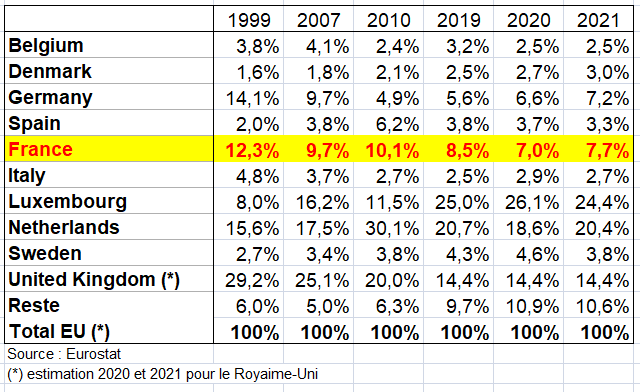
2/ les revenus distribués reçus et versés des SNF en niveau relatif (part dans la valeur ajoutée)
a) les revenus « versés »
Les « revenus distribués des sociétés » versés par les SNF ont connu une forte progression en pourcentage de leur VA depuis 1999, rattrapant en partie le pourcentage de l’Allemagne jusqu’en 2009 (qu’on n’a toutefois pas corrigé comme le taux de marge – voir ci-dessus). Puis ce pourcentage diminue en France comme dans la plupart des pays, mais plus nettement en France. Il reste que entre 1999 et 2021, la progression est plus forte en France que dans les autres pays, sauf au Pays Bas. Mais cette progression se situe avant la crise de 2009. Depuis 2010, le ratio français baisse à peu près comme comme dans l’UE mais moins qu’en Allemagne ou en Italie (tableaux suivants).
Part des revenus distribués versés (D42) des sociétés non financières (S11) dans la valeur ajoutée des sociétés non financières (en %)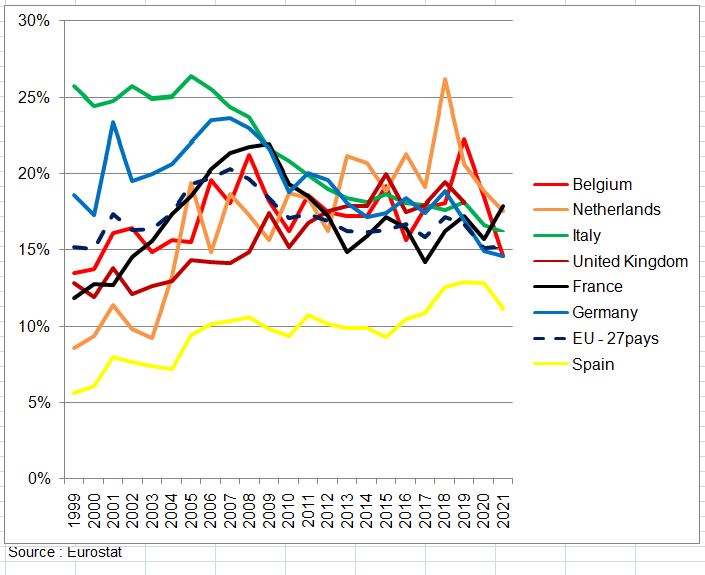
Revenus distribués des sociétés D42 (versés) en % de la VA des SNF en Europe durant la décennie 2010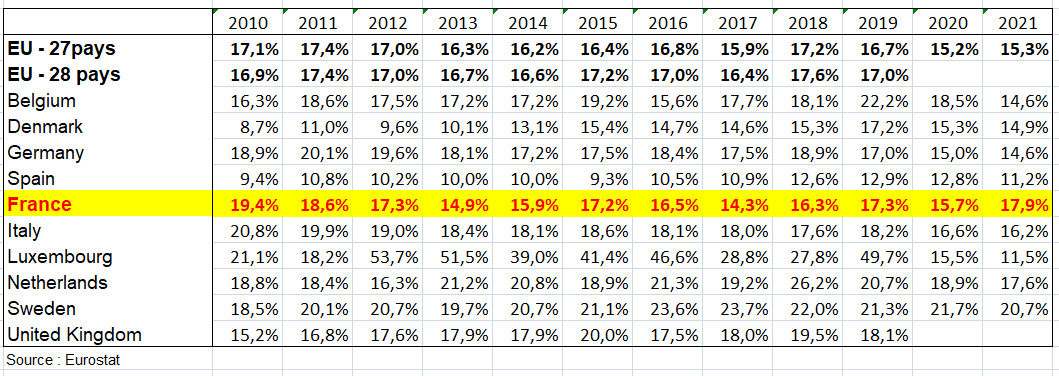
Dividendes des sociétés D421 (versés) en % de la VA des SNF en Europe durant la décennie 2010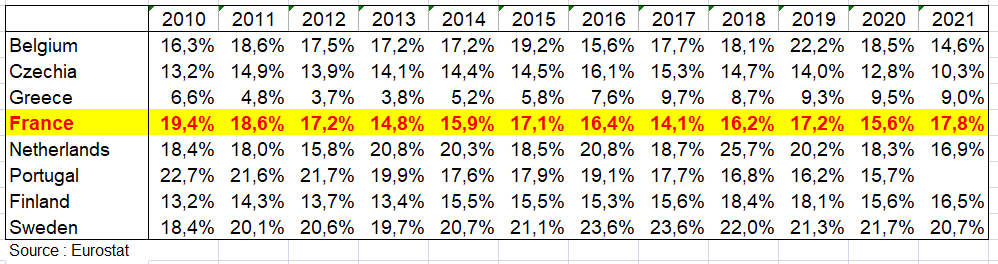
On observe aussi que la part des Revenus distribués des sociétés D42 (versés) en % de l’EBE est relativement élevée en France : 51,9% en 2019 (43,6% en 2020) contre 41,1% dans l’UE (35,7% en 2020). Mais la baisse de ce ratio est plus forte en France entre 2011 et 2020 (-27%) que dans l’UE (-16,5%), entraînant que ce ratio le plus élevé en 2011, ne l’est plus en 2019 et en 2020 malgré une moindre baisse en 2020 que dans certains pays comme le Suède ou la Belgique.
Part des Revenus distribués des sociétés D42 (versés) dans l’EBE en %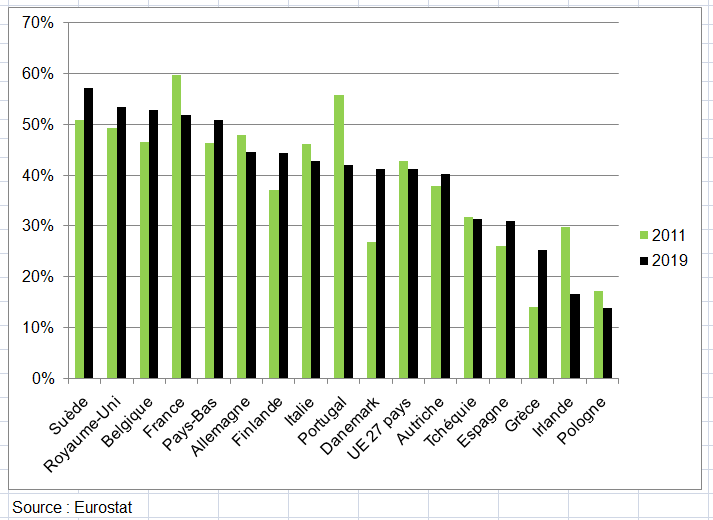
b) Les revenus « reçus »
D’autre part, la part des revenus distribués des sociétés reçus par les SNF dans leur VA gagne 8 points en France entre 1999 (9,4%) et 2008 (17,3 %), même si elle baisse ensuite (14% en 2021). Alors qu’elle progresse très faiblement dans les autres pays (sauf aux Pays Bas où elle évolue encore plus vite qu’en France et dans une moindre mesure en Belgique) : + 3 points entre 1999 et 2021 dans l’UE des 27 pays, et + 0,2 points en Italie.
Mais on note surtout l’importance de la part des dividendes reçus en % de la VA en France : 14% de la VA en 2021, pourcentage moins élevé qu’aux Pays-Bas mais plus élevé que dans les autres pays pour lesquels les données sont disponibles. N’est-ce pas un aspect de la financiarisation en France ?
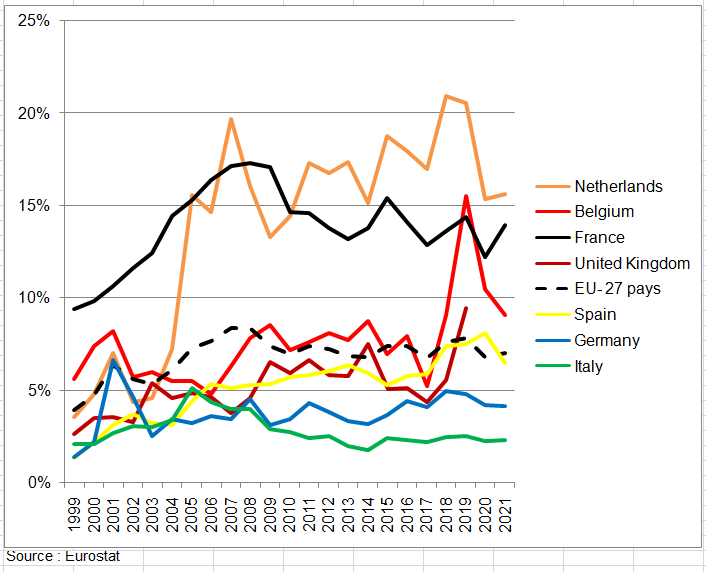
Revenus distribués des sociétés D42 (reçus) en % de la VA des SNF en Europe durant la décennie 2010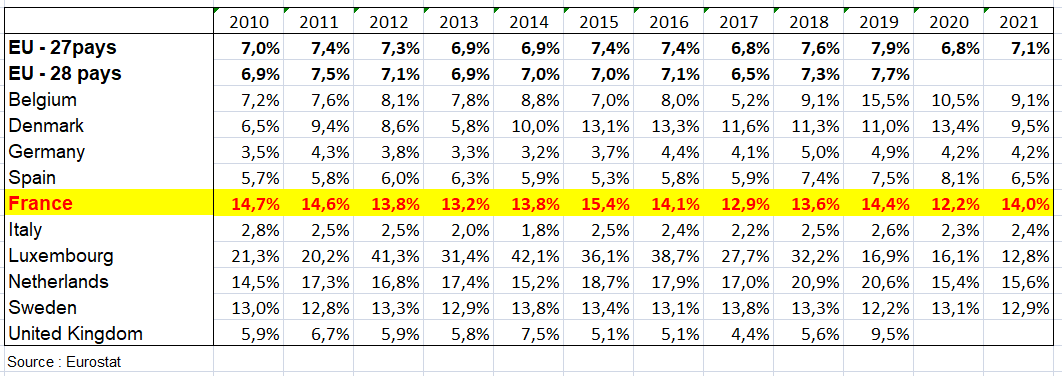
Dividendes des sociétés D421 (reçus) en % de la VA des SNF en Europe durant la décennie 2010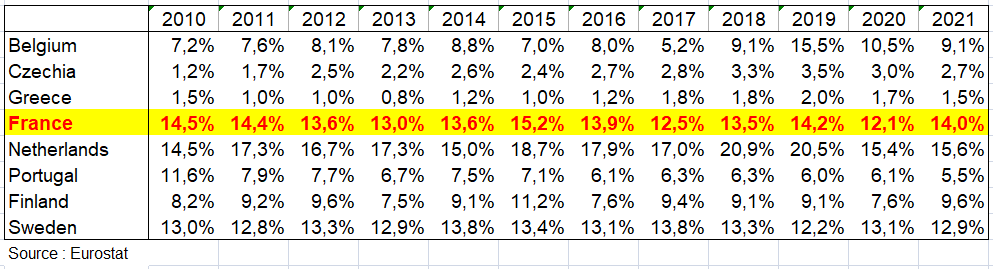
c) le solde « versés – reçus »
Il est discutable de faire la différence entre la part des revenus versés moins reçus en pourcentage de la VA des SNF car les revenus distribués reçus peuvent provenir des SF ou du Reste du monde.
Faute de mieux, on peut observer que le solde net (revenus distribués des sociétés versés moins revenus distribués des sociétés reçus) rapporté à la VA progresse à peine en France comme dans d’autres pays. De plus, il se trouve nettement inférieur à ceux de l’Allemagne et de l’Italie, voire de l’UE, sous réserve que ces derniers sont comparables (voir ci-dessus) : 3,9% en France en 2021 contre 8,2% dans l’UE. Ceci atténue en quelque sorte la faiblesse relative du taux de marge en France. Mais cette différence est à peine plus faible qu’en Espagne (4,7%) et au Danemark (5,4%) et elle est plus élevée qu’aux Pays-Bas (2%), où il arrive que les SNF reçoivent certaines années autant de dividendes qu’elles en versent.
Revenus distribués des sociétés D42 (versés-reçus) en % de la VA des SNF en Europe durant la décennie 2010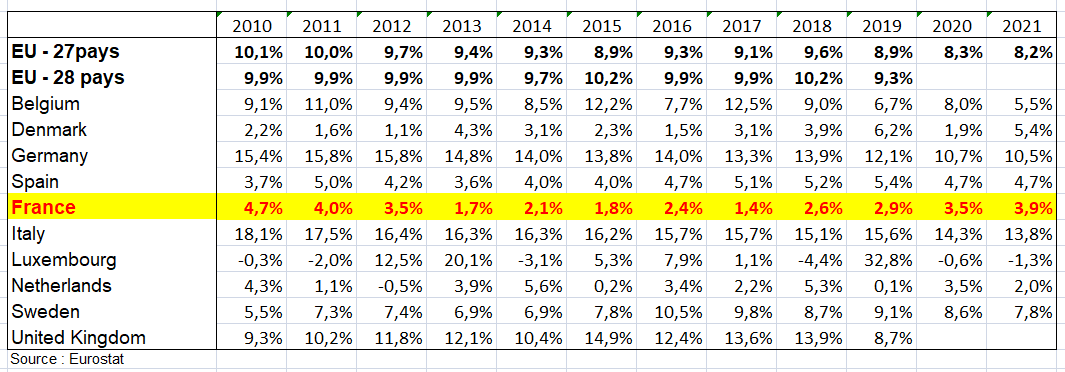
Dividendes des sociétés D421 (versés-reçus) en % de la VA des SNF en Europe durant la décennie 2010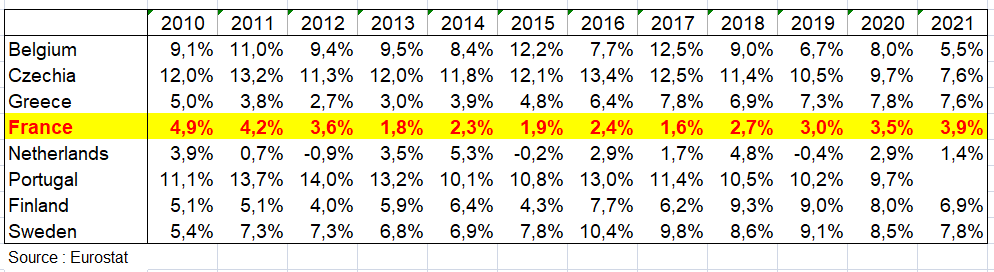
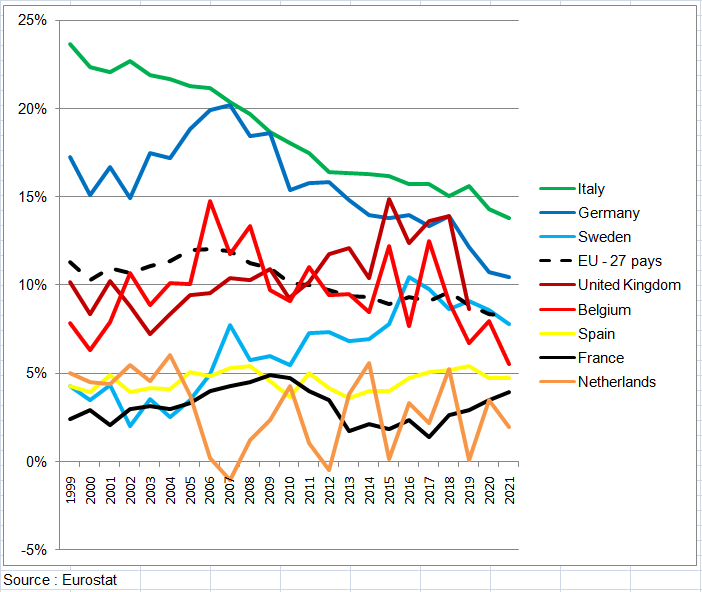
L’étude de la financiarisation commence par l’analyse des revenus distribués et particulièrement des dividendes versés et reçus des sociétés non financières. Mais la complexité du phénomène provient de l’importance des dividendes reçus. Autrement dit deux questions se posent :
Mais la financiarisation ne peut pas se mesurer seulement en terme de dividendes. C’est pourquoi on étudiera ici l’ensemble des ratios financiers.
1/ La révision des comptes en base 2020
a) D’omportantes révisions avce la base 2014
En base 2020, le compte des sociétés non financières (SNF) est révisé à plusieurs titres (Tableau suivanjt. Tout d’abord la valeur ajoutée est fortement revue à la baisse (-30,9 Md€), du fait de recalage sur les données Esane, de la révision des méthodes d’estimation de la R&D (-12,6 Md€) et de l’activité dissimulée (-6,5 Md€) ainsi que le reclassement de certaines unités vers le compte des administrations publiques, principalement SNCF-Réseau et France Télévision (-8,0 Md€). En outre, le reclassement de la contribution au service public de l’électricité (CSPE) de subvention sur les produits (base 2014) à subvention sur la production (base 2020) contribue à diminuer la valeur ajoutée (-8,1 Md€), mais n’affecte pas l’EBE des SNF.
Cette révision de la valeur ajoutée contribue à diminuer l’EBE de 22,8 Md€. D’autres révisions jouent sur l’EBE sans affecter la valeur ajoutée, il s’agit notamment de la modification du moment d’enregistrement du CICE [ Fiche 8] qui concerne en particulier l’année 2019, année de suppression du CICE : -19,0 Md€ en 2019. La révision à la hausse de la rémunération totale des salariés (+3,4 Md€) contribue également à dégrader l’EBE. D’autres révisions mineures sur les impôts et les subventions jouent en sens inverse. Au total, l’EBE est nettement revue en baisse entre les deux bases : -42,4 Md€, dont -23,4 Md€ au titre de révisions plutôt structurelles et -19,0 Md€ à titre exceptionnel en 2019 en lien avec le décalage d’une année de la chronique du CICE entre les deux bases.
La rémunération des salariés est peu révisée en base 2020 (+3,4 Md€) malgré plusieurs changements le calage sur les données de la statistique structurelle d’entreprises (dispositif Esane) contribue à une révision à la hausse des rémunérations (+3,0 Md€) ; en parallèle, le périmètre des SNF est revu avec des sorties de champs (comme SNCF Réseau et l’audiovisuel public et des entrées de champs, notamment les prestataires privés pour les services d’aide à domicile ainsi que les crèches privées.
En revanche, la composition des rémunérations des salariés est notablement modifiée : les salaires et traitements bruts sont révisés à la baisse de 15,3 Md€ tandis que les cotisations employeurs révisent à la hausse de 18,6 Md€. Cette révision est liée à une meilleure prise en compte en base 2020 des cotisations employeurs versées aux organismes d’assurance sous l’effet de la généralisation de la couverture complémentaire santé d’entreprise. Elle n’a pas d’effet sur la rémunération (totale) des salariés au sens de la comptabilité nationale, mais modifie le partage entre salaires et traitements bruts et cotisations employeurs.
Le compte des sociétés non financières – 2019 ; en euros (milliards)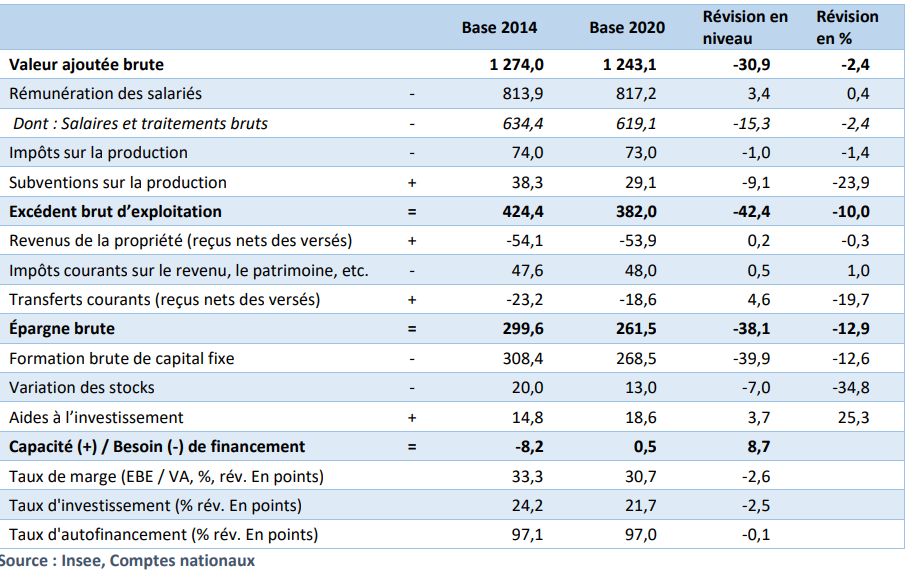
b) Le tauix de marge
Le taux de marge (EBE/VA) est révisé à la baisse en 2019 : il passe de 33,3 % à 30,7 % en 2019, soit une révision de -2,6 points dont -1,5 point au titre du CICE. Mais en fait il y a non seulement un différentiel de niveau mais aussi des évolutions très divergentes même si on observe un rehaussement du taux de marge entre 2013 et 2021 dans les deux séries.
1 – Les nouvelles évolutions du taux de marge entre 2013 et 2019
S’agissant des évolutions, les règles d’enregistrement des crédits d’impôt restituables ont été précisées avec l’actualisation du manuel européen sur le déficit et la dette des administrations en 2023 pour une implémentation dans la base 2020. Outre des compléments pour l’appréciation du caractère restituable des crédits d’impôt, le manuel précise que leur moment d’enregistrement est défini indépendamment de celui de l’impôt. Ce sont les règles d’enregistrement des dépenses d’intervention des administrations publiques qui s’appliquent, c’est-à-dire au moment où l’événement économique qui sous-tend l’intervention a lieu.
Dans les comptes français, les crédits d’impôt sur l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés étaient enregistrés au moment de la constatation par l’administration des montants d’impôt et de crédits d’impôt, à l’occasion des avis d’imposition. La nouvelle recommandation internationale sur ce point modifie le traitement : en base 2020, les dépenses de crédits d’impôt sont ainsi enregistrées, dans tous les cas où cela est possible, en s’alignant sur les principes d’enregistrement des dépenses d’intervention des administrations publiques. En revanche, l’enregistrement des recettes n’est pas modifié.
La nouvelle règle conduit à significativement modifier la chronique des recettes et des dépenses au titre du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE). C’est un dispositif de réduction du coût du travail mis en place au 1er janvier 2013 et supprimé en 2019, au profit d’allègement de cotisations. Il consiste en un crédit d’impôt égal à une fraction des rémunérations brutes des salariés rémunérés sous le seuil de 2,5 Smic. En comptabilité nationale, les dépenses des administrations publiques au titre du CICE constituent une subvention sur la production (subvention sur les salaires et la main d’œuvre). Une entreprise verse des rémunérations une année donnée (T), et déclare le montant de crédit d’impôt lors de sa déclaration de revenu l’année suivante (T+1). Dans les bases précédentes, le moment d’enregistrement de la dépense était la date de constatation par l’administration des montants d’impôt et de crédits d’impôt, donc l’année de déclaration de revenu, soit T+1. En base 2020, le fait générateur de la dépense est aligné avec la naissance du droit au crédit d’impôt. Dans le cas d’une subvention sur la production, il s’agit de l’année où a lieu la production subventionnée, c’est-à-dire l’année où ont lieu les transactions qui génèrent le droit à la subvention. Ainsi, pour le CICE, et pour la majorité des crédits d’impôt, ce changement méthodologique conduit globalement à avancer d’un an la dépense du crédit d’impôt. En revanche, l’enregistrement des recettes n’est pas modifié. our le CICE, la recette est constatée au moment où l’entreprise déduit le montant de CICE de son impôt à payer, ou bien le moment où sa créance lui est restituée en numéraire, à partir de l’année T+1. Les révisions du moment d’enregistrement du CICE explique le profil des révisions du taux de marge entre 2013 et 2019 (graphique suivant).
2 – Un niveau supérieur du taux de marge de 0,5 à 1 point en base 2014
En outre, ce taux déjà particulièrement bas par rapport aux autres pays en base 2010, l’est encore plus en base 2020 du fait de la forte baisse de la valeur ajoutée voire du rehaussement des rémunérations (voir ci-dessus). La diminution des subventions liée au nouveau traitement du CICE n’arrange rien. En 2020 et 2021, le taux de marge reste aussi plus bas en base 2020 qu’en base 2014 mais d’une moindre ampleur (un peu moins d’un point d’écart en 2021 contre 2,6 points en 2019).
Taux de marge des sociétés non financières en %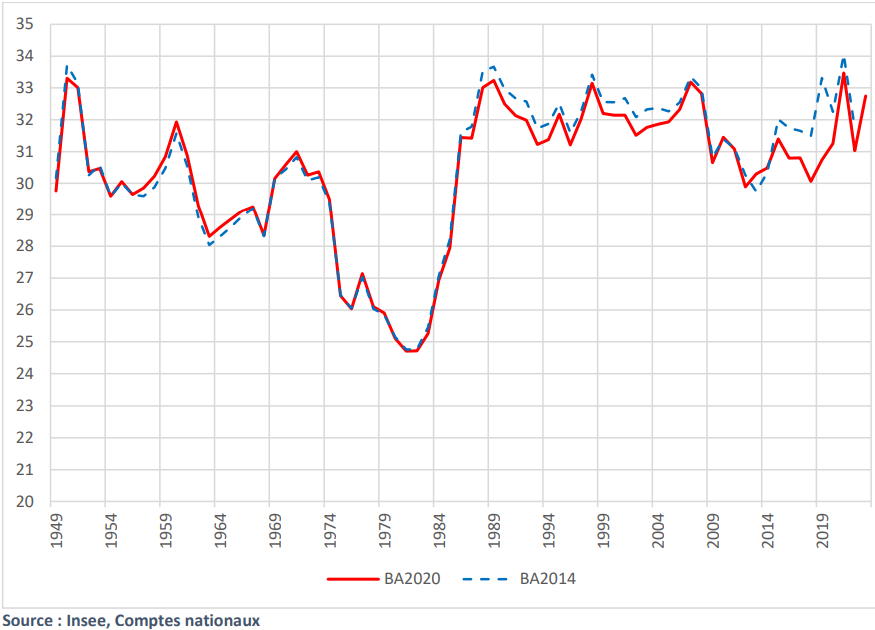
c) Le taux d’investissment et d’autofinancement
La FBCF des SNF est révisée fortement à la baisse de 39,9 Md€. En effet, le passage à la base 2020 conduit à une meilleure séparation entre les activités de R&D et celles en lien avec le développement de logiciels (-12,7 Md€ de FBCF en R&D). De plus, la révision du partage entre investissement et consommations intermédiaires dans l’utilisation des logiciels par les entreprises entraîne une baisse de l’investissement en logiciels et bases de données (-18,1 Md€ de FBCF en logiciels et bases de données). Enfin, le reclassement de SNCF Réseau et de l’audiovisuel public en administration publique contribue également à la baisse de l’investissement des SNF.
La baisse de la FBCF des SNF en base 2020 entraîne une révision à la baisse du taux d’investissement (FBCF/valeur ajoutée) : il passe de 24,2 % à 21,7 % en 2019. Cecie le rapproche des taux des autres pays de l’UE. Le changement de structure de la FBCF par produit joue sur la dynamique d’ensemble à partir des années 80, en raison notamment de la révision du poids des logiciels à la baisse, qui joue à la baisse sur les évolutions de la FBCF et du taux d’investissement.
Le taux d’autofinancement des sociétés non financières, rapport entre l’épargne brute et l’investissement, est stable en 2019 entre les deux bases, l’épargne et la FBCF révisant de manière équivalente. Cela tient au CICE qui joue exceptionnellement à la hausse sur le taux d’épargne de la base 2014. Avant 2019, le taux d’autofinancement est globalement revu à la hausse en base 2020, car l’épargne est relativement moins revue à la baisse que la FBCF
Taux d’investissement des sociétés non financières (en %)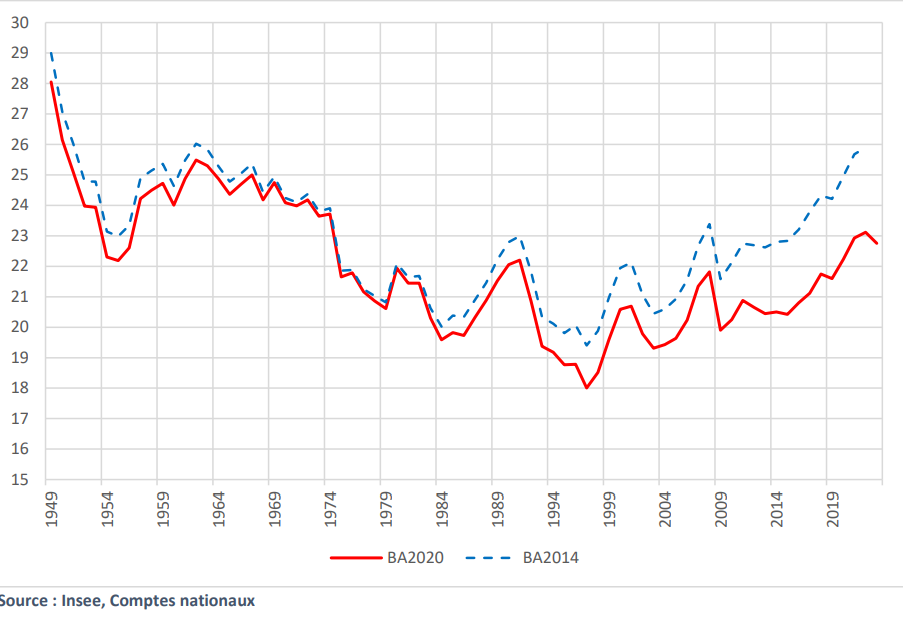
Taux d’autofinancement des sociétés non financières en %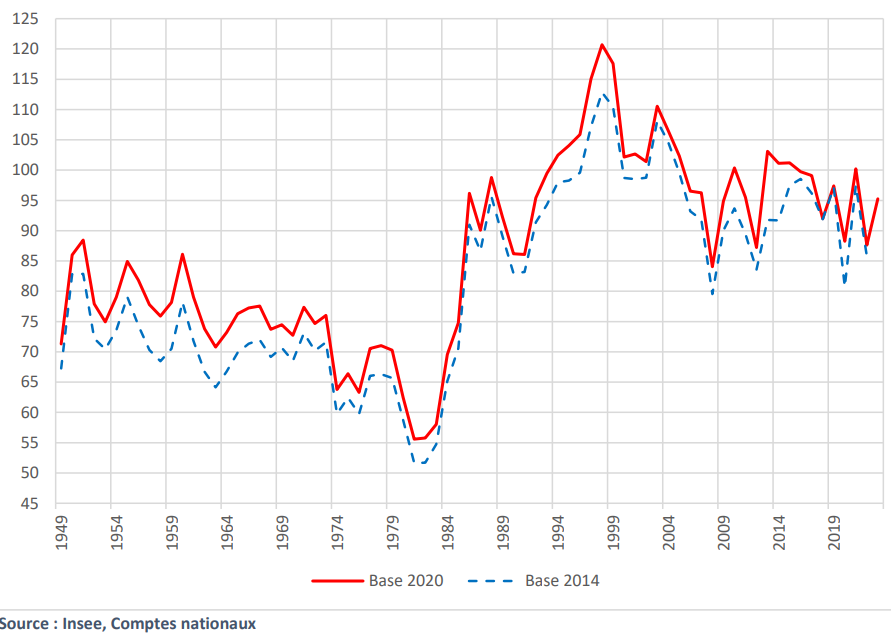
d) Les ratios des SNF en 2023
En 2023, la valeur ajoutée (VA) des sociétés non financières (SNF) progresse à un rythme proche de celui de 2022, et reste en vive augmentation (+7,9 % en valeur après +8,3 %), soit une hausse de 108,0 Md€. La rémunération des salariés ralentit tout en restant dynamique avec une hausse de 49,5 Md€ (après +69,7 Md€ en 2022), portée par la revalorisation du Smic. En outre, les impôts nets des subventions sur la production marquent le pas après la chute marquée en 2022 des aides exceptionnelles liées à la crise sanitaire (-0,4 Md€ après +33,1 Md€). Ainsi, l’EBE accélère de 58,9 Md€ (après +1,5 Md€ en 2022). Le taux de marge se redresse nettement (+1,7 point) pour atteindre 32,7 %, après la forte baisse de 2022 (-2,4 points) ; il reste supérieur à son taux moyen avant-crise (30,7 % en moyenne entre 2009 et 2019).
Les intérêts versés par les SNF progressent nettement plus que ceux qu’elles reçoivent (+110,5 Md€ contre +79,3 Md€), malgré une chute des nouveaux emprunts bancaires et une réorientation des actifs depuis les dépôts vers les organismes de placement collectif (OPC) monétaires. Le solde des bénéfices réinvestis (versés nets des reçus) se dégrade de 7,1 Md€, tandis que les revenus d’investissements reçus sont en hausse de 4,1 Md€.
Ainsi, l’épargne brute des SNF rebondit avec une hausse de 42,9 Md€, après une contraction de 13,3 Md€ en 2022. En dépit de la hausse des taux d’intérêt, l’investissement reste en hausse : +19,6 Md€ après +26,5 Md€, principalement porté par les volumes. Comme la VA et l’investissement progressent de conserve, le taux d’investissement des SNF est en légère baisse à 22,8 % après 23,1 %. Dans le même temps, les SNF stockent bien moins qu’en 2022 : la variation des stocks se contracte de 10,4 Md€ après une expansion de 13,8 Md€ en 2022. Au total, les SNF dégagent une capacité de financement positive en 2023 (+22,4 Md€, après -12,6 Md€ en 2022). Ainsi, le taux d’autofinancement des SNF gagne 7,7 points (après -12,6 points en 2022) et atteint 95,3 %.
Quelques éléments du tableau économique d’ensemble des SNF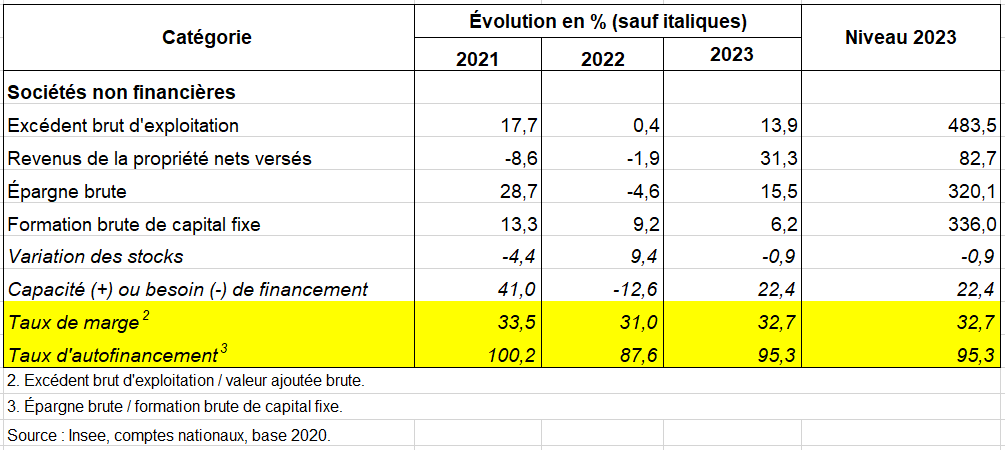
2/ L’épargne et le besoin de financement négatif en France
Au final, l’épargne se décompose entre l’EBE, les dividendes versés (nets), les intérêts versés (nets), l’impôt sur les sociétés, les bénéfices réinvestis et d’autres opérations. Hormis l’EBE, tous les autres éléments ont une contribution négative. La contribution de l’EBE de près de 14% est calculée comme la variation de l’EBE entre 2018 et 2019 rapportée à l’épargne brute en 2019. Elle est du même ordre de grandeur qu’en 2015. Les intérêts versés (nets) ont une contribution négative de -0,8%, ce qui correspond à une augmentation de près de 2 Mds sur un total de l’épargne brute de 293,5 Mds. En 2018, leur contribution était positive traduisant une diminution de 1 milliard. On a vu que ces évolutions n’empêchent pas que les SNF ont un besoin de financement de près de 7 Mds d’euros du fait d’une FBCF qui augmente de près de 15 Mds. Mais ce besoin de financement était de 27 Mds en 2018.
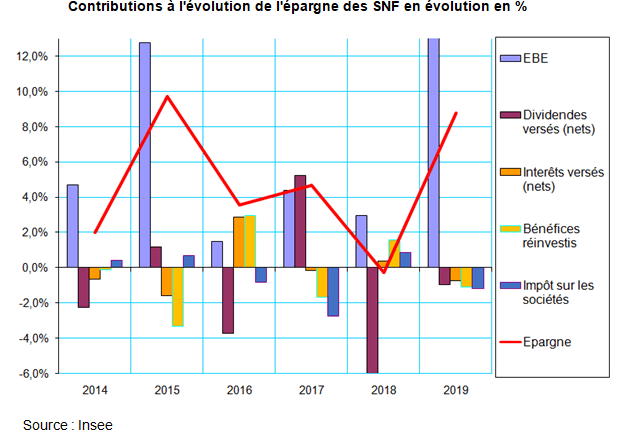
Pour mémoire; les ménages (S14) et les sociétés financières (S12) ont habituellement une capacité de financement, sauf en 2019 pour les secondes (SF). Les sociétés non financières (S11) et les administrations publiques (S13) ont habituellement un besoin de financement (S13). Mais c’est loin d’être le cas dans les autres pays, à commencer par l’Allemagne. C’est le Royaume Uni qui dégage un besoin de financement de l’économie nationale le plus élevé. L’Allemagne est dans la situation inverse. En France on est frappé par le contraste entre des ménages « excédentaires » et des SNF mais surtout des APU « déficitaires ». Par ailleurs, en 2019, la capacité financière, rapportée au PIB, des SNF et des SF est la même.
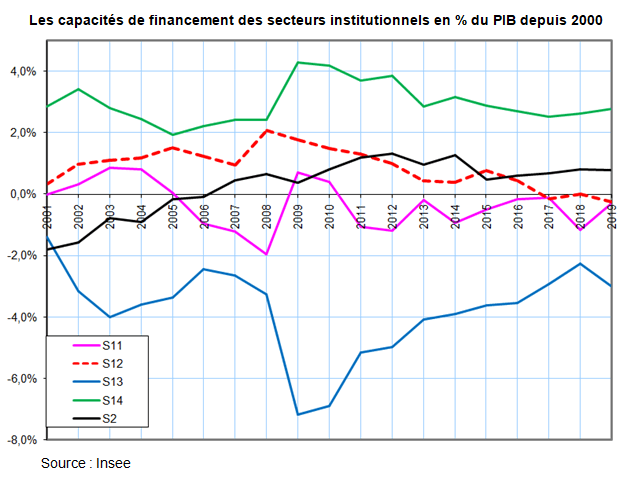
3/ Principales évolutions des taux de marge depuis la crise de 2020 en France et en Europe
a) En France
Selon l’Insee, après avoir atteint en 2021 un niveau historiquement élevé, le taux de marge des sociétés non financières s’est replié en 2022, en raison essentiellement de la fin des mesures de soutien liées à a crise sanitaire. Il s’est établi ainsi à 31,7 % de la valeur ajoutée, soit un niveau proche de sa valeur moyenne en 2018 (31,5 %). Dans un contexte de stagnation de la productivité par tête et en dépit de la relative modération des salaires par tête, les coûts salariaux unitaires (CSU, ratio des coûts de la main-d’œuvre sur la productivité du travail) ont nettement augmenté, d’environ 5 % en 2022 dans le secteur marchand. De plus, les entreprises ont subi une augmentation du coût de leurs consommations intermédiaires en raison des tensions sur les prix de l’énergie et des autres matières premières. Cependant, elles ont en partie répercuté ces hausses de coûts dans leurs prix de vente (et donc dans le prix de la valeur ajoutée), ce qui a permis de limiter la baisse agrégée du taux de marge des sociétés non financières en 2022 par rapport à son niveau record de 2021 : il est revenu l’an dernier au voisinage de ses niveaux pré-Covid. Cette évolution au niveau agrégé des sociétés non financières peut toutefois masquer des hétérogénéités sectorielles sensibles.
Au premier semestre 2023, l’amélioration de la profitabilité des entreprises résulterait principalement de la baisse des salaires réels – avec notamment le contrecoup des fortes primes de partage de la valeur (PPV) versées fin 2022 – mais aussi de la nouvelle réduction des impôts de production (baisse de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises). En revanche, les prix des consommations intermédiaires – notamment les prix des intrants énergétiques issus des renégociations récentes des contrats de gaz et d’électricité – augmenteraient un peu plus rapidement que les prix de production : le prix de la valeur ajoutée se dégraderait donc légèrement relativement au prix de la consommation, ce qui pèserait sur le taux de marge des entreprises. Au total, à la fin du deuxième trimestre 2023, le taux de marge s’établirait à 33,5 %, soit deux points au dessus de son niveau moyen de 2018. Un taux de marge qui n’a pas varié entre 2000 et 2022 signifie bien que le revenu des entreprises et celui distribué en salaires ont progressé au même rythme.
Décomposition du taux de marge des sociétés non financières (SNF) (taux de marge en %, variation et contributions en points)
https://www.insee.fr/fr/statistiques/6967914?sommaire=6966784
Taux de marge des sociétés non financières (SNF) (en % de la valeur ajoutée)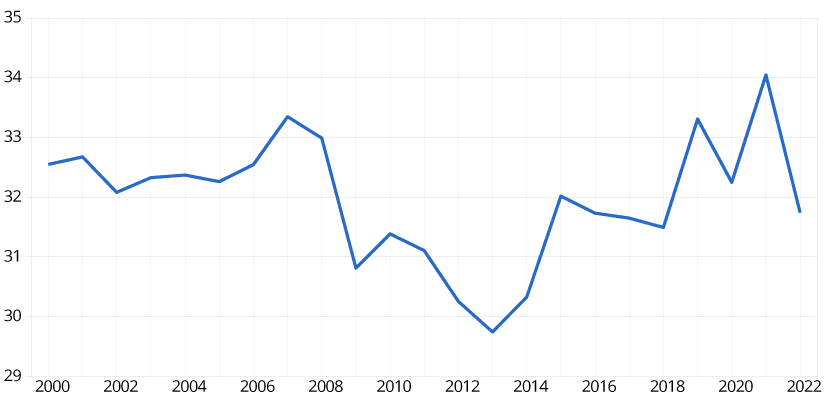
Source : Insee, comptes nationaux
Mais cette évolution est une moyenne. Il y a en effet eu une forte hétérogénéité selon les branches. Les comptes d’exploitation par branche le montrent (graphique suivant). Les taux de marge de l’énergie ne cessent de progresser depuis 2018. Le taux des services marchands régresse en 2022 mais il reste nettement supérieur au taux de marge de l’industrie qui baisse depuis 2019 (voir page Désindustrialisation par pays) de même que celui de la construction (voir page Comptes bâtiment travaux publics).
Taux de marge par branche (en % de la valeur ajoutée)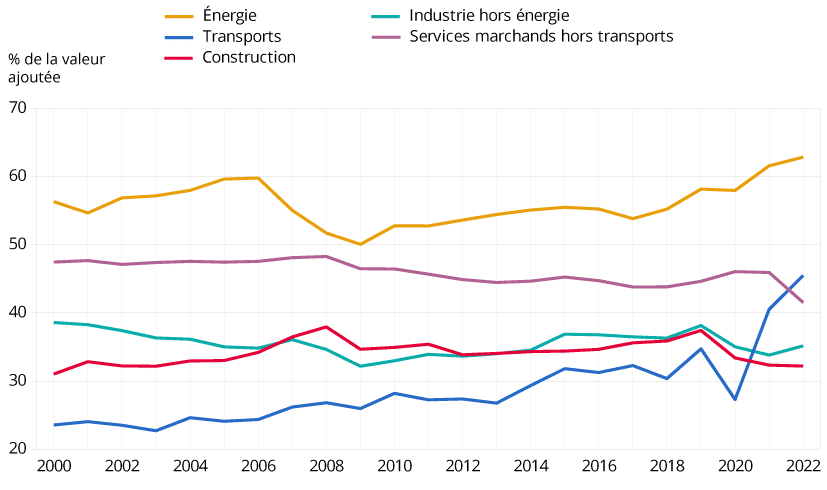
Source : Insee, comptes nationaux
S’agissant des industries agro-alimentaires, le prix de production a été particulièrement dynamique en 2021 et plus encore en 2022, Jusqu’à la mi-2022, ce dynamisme a principalement résulté du renchérissement des intrants – essentiellement composés, dans cette branche, de produits agricoles et agro-alimentaires. En 2021, dans le contexte de hausses des cours des matières premières agricoles consécutif à la sortie de la crise sanitaire, le renchérissement des intrants des industries agro-alimentaires n’a été que partiellement répercuté dans son prix de production. Il en a résulté une compression des marges : l’excédent brut d’exploitation (EBE) unitaire, a diminué chaque trimestre de l’année 2021. Le taux de marge s’est donc continûment dégradé dans les industries agro-alimentaires au cours de l’année 2021.
Au cours de l’année 2022, le coût unitaire des intrants a continué de progresser sensiblement, bien qu’en ralentissement sur la seconde moitié de l’année, et l’EBE unitaire s’est redressé progressivement. Au total, le dynamisme du prix de production des industries agro-alimentaires en 2022 a été porté tant par le renchérissement des intrants que par le redressement des marges après leur compression l’année précédente. Ces mouvements se retrouvent, certes dans une moindre mesure, au niveau des branches marchandes non agricoles dans leur ensemble. En 2021, la forte montée du coût unitaire des intrants n’a été que partiellement répercutée dans le prix de production et s’est accompagnée, à partir du deuxième trimestre, d’une baisse de l’EBE unitaire de ces branches. En 2022 en revanche, l’EBE unitaire s’est redressé : le coût unitaire des intrants a continué de constituer la contribution principale à l’évolution du prix de production des branches marchandes non agricoles, mais l’EBE unitaire a aussi contribué sensiblement à sa dynamique, notamment fin 2022.
ll y a eu ainsi une contribution des marges des entreprises agroalimentaires à l’augmentation des prix de production et donc à l’inflation. Pour autant, pour évaluer correctement l’impact des marges des entreprises sur l’inflation, il faut tenir compte de qui s’est passé les années précédentes. « En 2021, les entreprises ont plutôt comprimé leurs marges pour réduire l’effet de la hausse du coût des matières premières ». « Le taux de marge dans l’agroalimentaire a ainsi baissé tout au long de l’année 2021 et se situait encore début 2022 en deçà de son niveau d’avant la crise. Ce qui a atténué l’inflation et son choc auprès des consommateurs », souligne l’expert de l’Insee. « Ce n’est que récemment, au second semestre 2022, que le taux de marge a atteint un niveau supérieur [par rapport à la moyenne de l’année 2018]« . « Il est difficile à ce stade de déterminer si les entreprises ont augmenté leurs marges au-delà d’un effet de rattrapage, car les années récentes ont été très chahutées d’un point de vue économique.Le point de vigilance est de savoir si cette hausse des marges va se cantonner à un effet de rattrapage ou si un processus plus inflationniste est en train d’être amorcé ».
Certains économistes y voient cependant plus qu’un effet de rattrapage (https://www.marianne.net/economie/consommation/de-plus-en-plus-liee-aux-profits-la-hausse-des-prix-risque-detre-durable-et-generalisee), Le taux de marge des industries agroalimentaires serait en effet, au quatrième trimestre 2022, supérieur de 5,8 points au niveau du premier trimeste 2018 (graphique suivant). Ces économistes observent aussi un ralentissement tendanciel des gains de productivité. « Pour maintenir leurs marges, les entreprises augmentent les prix. Si les gains de productivité baissent depuis la crise de 2008, ce facteur inflationniste ne se manifestait pas parce que des mesures très fortes ont été adoptées pour doper les marges des entreprises, comme le CICE par exemple ».
Taux de marge dans l’ensemble des branches marchandes non agricoles et dans les industries agro-alimentaires (écart en points au niveau moyen du taux de marge en 2018)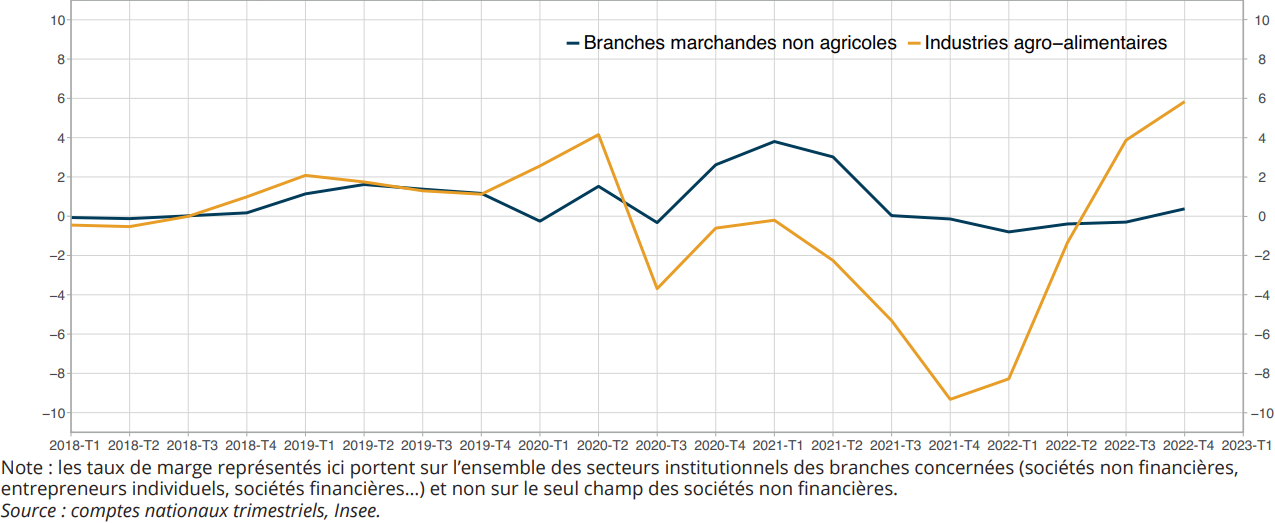
Au niveau des branches marchandes non agricoles dans leur ensemble, la forte montée du coût unitaire des intrants en 2021 n’a été que partiellement répercutée dans le prix de production et s’est accompagnée, à partir du deuxième trimestre, d’une baisse de l’EBE unitaire de ces branches. En 2022 en revanche, l’EBE unitaire s’est redressé : le coût unitaire des intrants a continué de constituer la contribution principale à l’évolution du prix de production des branches marchandes non agricoles, mais l’EBE unitaire a aussi contribué sensiblement à sa dynamique, notamment fin 2022.
Évolution du prix de production des branches marchandes non agricoles selon les contributions de ses composantes (variations trimestrielles en % du prix de production, contributions en points)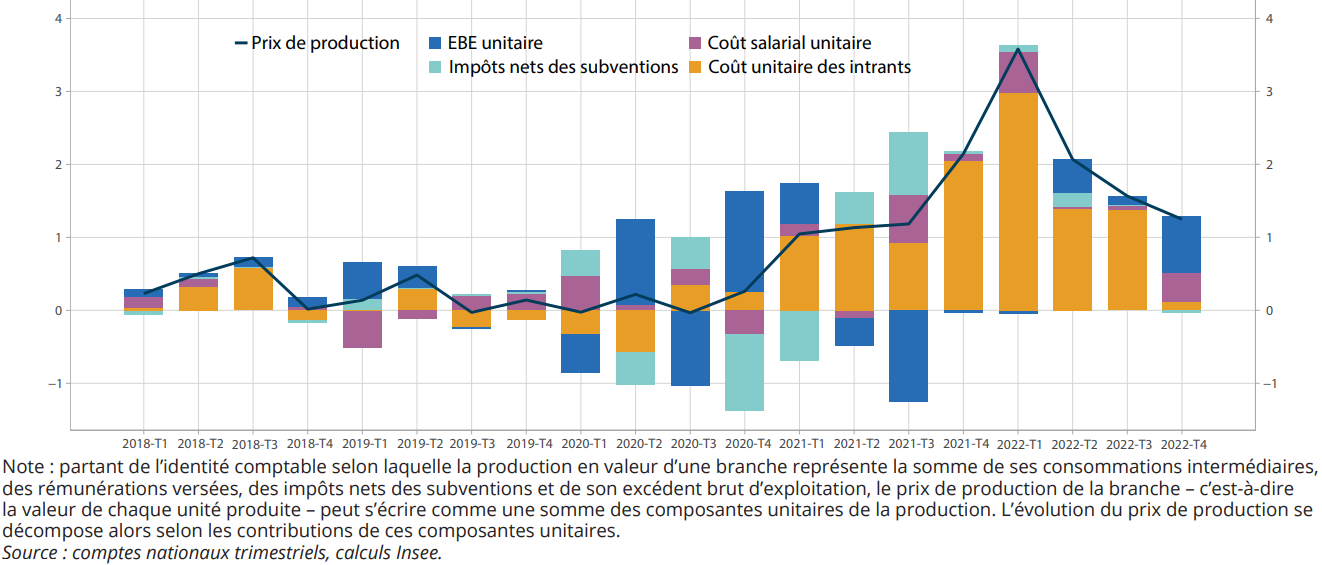
Ainsi la productivité horaire du travail de l’industrie en France a diminué de – 1,5% en moyenne en 2021 et 2022 (voir page Partage Volume Prix). Il semble que cette évolution explique en grande partie la hausse des prix des produits industriels, probablement celle des produits agro-alimentaires. Dans les autre pays, la productivité horaire du travail de l’industrie augmente sensiblement (+3% en moyenne annuelle en 2021 et 2022)
b) En Europe
Mais les comparaisons européennes amènent de nouveau à relativiser les conclusions précédentes. S’agissant des IAA, avec un taux proche de la moyenne en 2019, le taux en France est bien en dessous de la moyenne en 2021 pour les pays où ces données sont disponibles. Certes les ratios de l’Allemagne et de l’Espagne manquent, l’Allemagne ayant un taux bien plus faible qu’en France, mais l’Espagne ayant un taux élevé. Le taux français est plus bas que dans le total des pays étudiés : 39,5% en 2020 contre 44,4%; 33,6% en 2021 contre une estimation à 44,5%, soit autour de 10 points d’écart.
Taux de marge (EBE/VA) des Industries-agro-alimentaires en Europe en %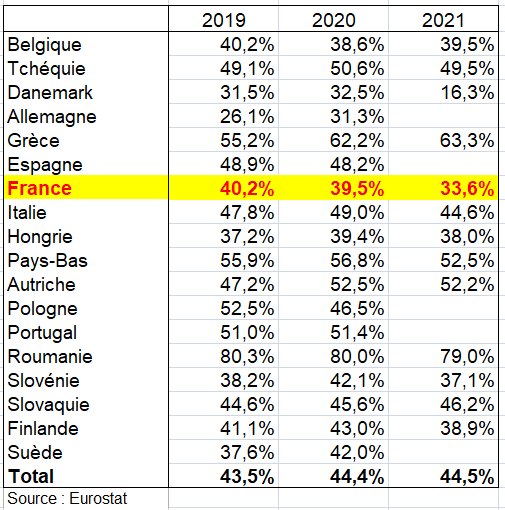
De même, le taux de marge des SNF en France, le plus faible de tous les pays, est presque 5 points inférieur au total des pays sélectionnés en 2021, et ce en corrigeant à juste raison les taux de l’Allemagne de l’Italie (voir ci-dessus). L’écart n’est que de 5 points du fait des services car l’écart est aussi de 10 points pour l’industrie manufacturière (voir page Désindustrialisation par pays).
Taux de marge (EBE/VA) des sociétés non financières en Europe en %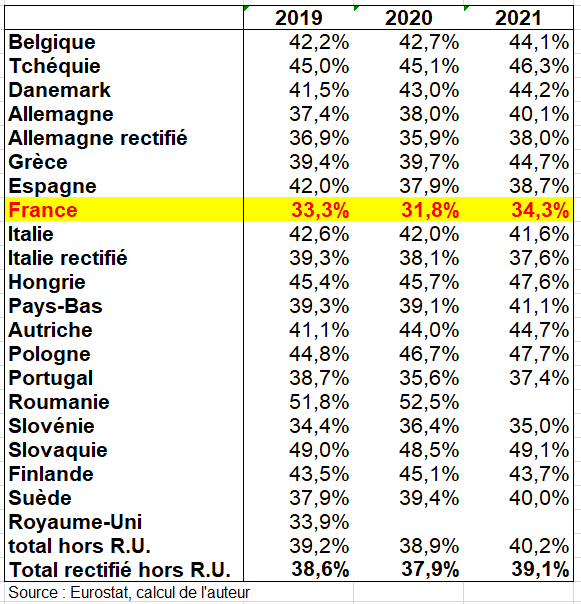
1/ Le taux de marge
On présente dans la page Comptabilité nationale et comparaisons internationales le partage de la VA entre les trois composantes, en reprenant les taux corrigés ci-dessus assez fragiles de l’Allemagne et de l’Italie (mais mieux que si ils n’étaient pas corrigés), pour qu’elles soient comparables aux autres pays, notamment la France.
On a vu que l’EBE est une mesure du bénéfice (avant impôts sur le revenu et le patrimoine) des SNF mais peut inclure la rémunération des travailleurs indépendants dans les pays où une partie d’entre eux sont inclus dans le secteur des SNF (plutôt que dans le secteur des ménages) comme c’est le cas en Allemagne ou en Italie : le revenu mixte brut ne est d’autant diminué. Dans certains tableaux et graphique suivants, on a corrigé les ratios de ces deux pays selon la méthode définie au chapitre 2. On estime ainsi que le taux de marge de l’Allemagne comparé à celui de la France (en supposant un classement à peu près analogue des SNF et des des EI dans ces 2 pays) serait de 36,6% (au lieu de 39,9% dans la base Eurostat). Celui de l’Italie serait aussi de 40% au lieu de 45%. Le taux de marge de la France est, lui, de 31,7% en 2022.
La part élevée en Irlande est principalement due aux grandes entreprises multinationales détenues à l’étranger qui paient une proportion relativement faible de leurs coûts de main-d’œuvre en Irlande. Ce ratio n’est donc pas très dignificatif.
Composantes de la valeur ajoutée des sociétés non financières, 2022, (% de la valeur ajoutée brute)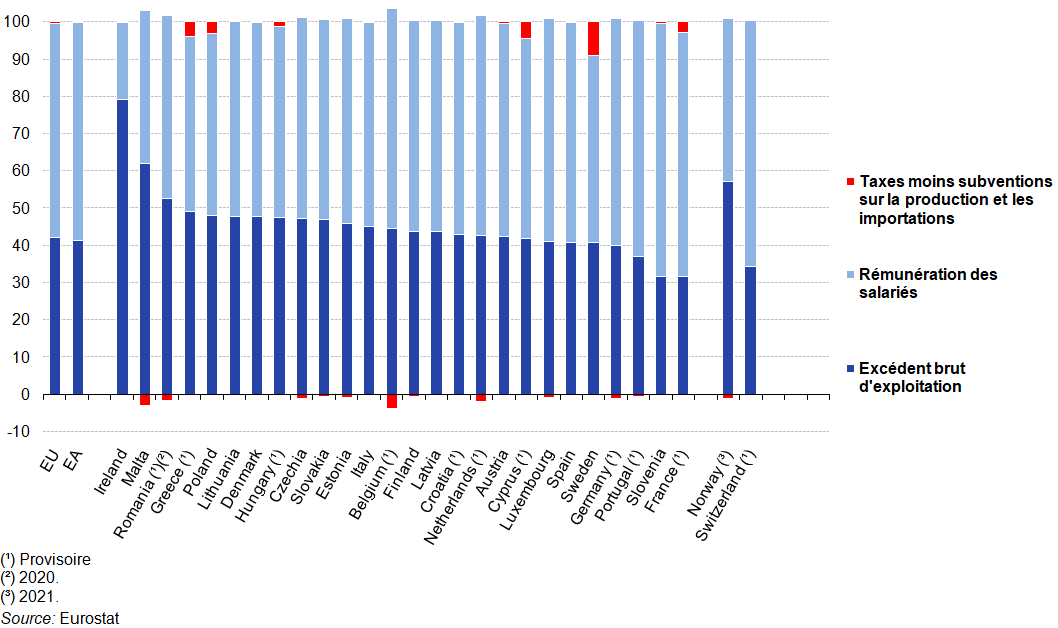
Parmi tous les pays de l’UE, le taux de marge (EBE / VA) serait le plus faible en France. En revanche, ce taux est nettement plus élevé dans les autres pays et donc dans l’UE des 27 pays (à peu près 41,5% en tenant compte des corrections des taux de l’Allemagne et l’Italie).
Le taux de marge augmente en France depuis 2012 de 30,3% à 31,7% mais moins que que dans l’UE « corrigé » (41,5% contre 40,2% en 2012). Mais il baisse de 1 point en France en 2020 par rapport à 2019 alors qu’il est quasi stable dans l’UE du fait de subventions en fortes hausses (voir ci-dessous).
On notait un redressement du taux de marge en France en 2019 du fait du CICE : les entreprises avaient vu leurs cotisations baisser cette année de 20 milliards d’euros environ et elles bénéficiaient d’un crédit d’impôt sur les sociétés de 20 milliards d’euros au titre de l’exercice 2018. La double année de CICE représentait presque 2 point de marge supplémentaire pour les entreprises. Le taux de marge des SNF atteignait 33,3% en 2019 contre 31,5% en 2018 [9]. Mais il s’agit d’une hausse transitoire, qui ne s’est pas répété en 2020 du fait des effets de la crise du covid 19 (voir Reprise économique fragile).
Taux de marge (EBE/VA) des SNF en Europe entre 2012 et 2022 en %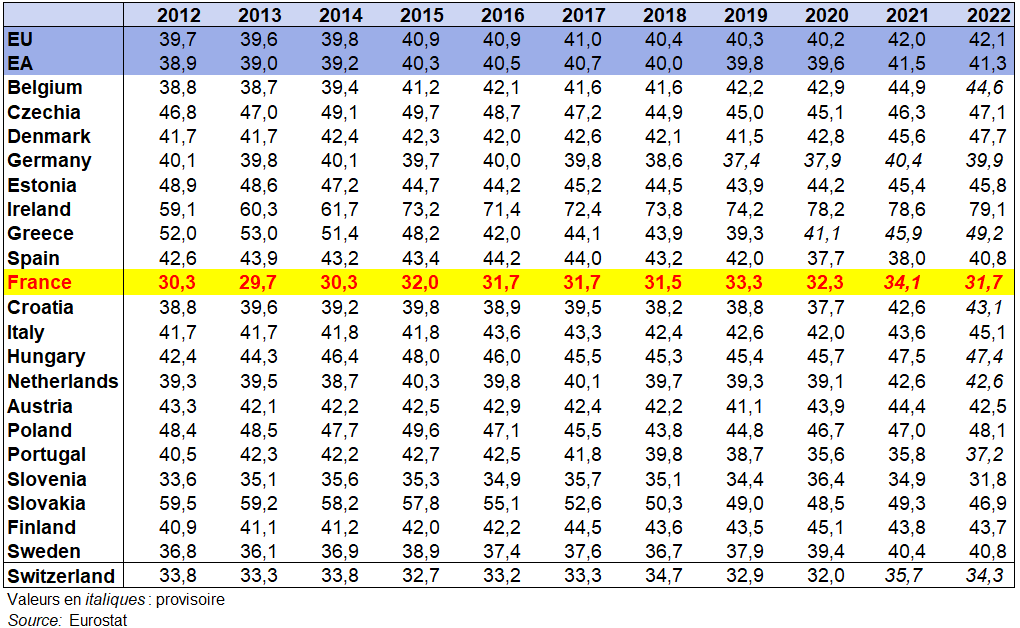
Le graphique suivant montre l’évolution absolue entre 2012 et 2022 de la part des bénéfices des sociétés non financières. Cette période commence pendant la reprise après la crise financière et économique mondiale et s’étend jusqu’à la troisième année de la crise du COVID-19 ainsi qu’au début de la période actuelle de hausses de prix relativement élevées (crise du coût de la vie).
Parmi les quatre plus grandes économies de l’UE, la part des bénéfices des sociétés non financières a augmenté entre 2012 et 2022 en Italie (en hausse de 3,4 pp) et en France (en hausse de 1,5 pp), tandis qu’elle a diminué en Allemagne (en baisse de 0,2 pp) et en Espagne ( en baisse de 1,8 pp). Dans tous les États membres de l’UE, la hausse la plus importante de la part des bénéfices a été observée en Irlande (en hausse de 20,1 points de pourcentage). Les baisses les plus importantes ont été enregistrées en Lettonie (-8,2 pp), en Lituanie (-10,5 pp) et en Slovaquie (-12,6 pp).
Variation globale de la part des bénéfices des sociétés non financières, 2011-2021 (points de pourcentage)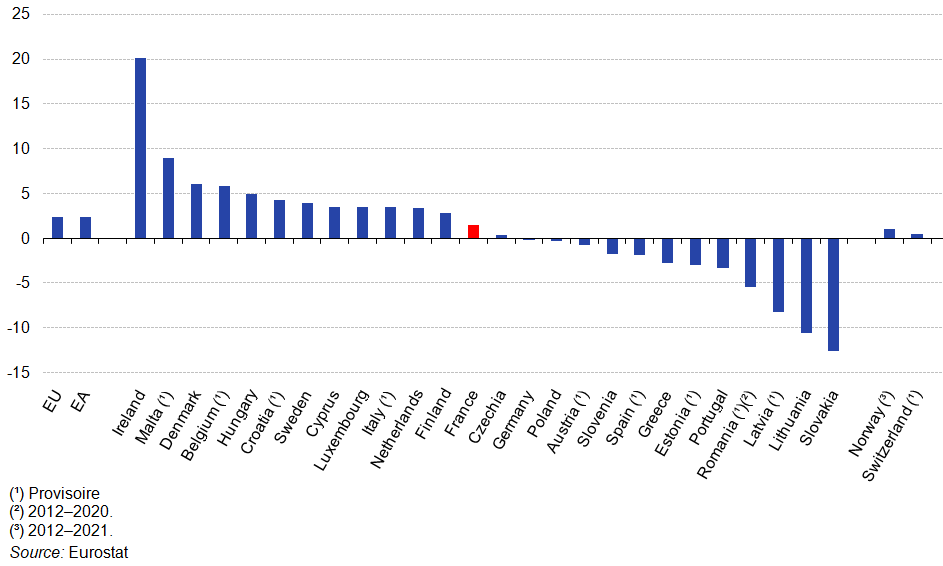
Au niveau mondial, on ne trouve aucun pays où le taux de marge soit plus bas qu’en France, même en tenant compte des reclassements en Allemagne et en Italie (voir ci-dessus). Quelques pays ont des taux à peine plus élevés qu’en France comme le Royaume-Uni, voire les États-Unis et la Suisse. Dans les BRICS, les taux de marge sont élevés (Chine, Brésil, Russie, Afrique du Sud), donc plus que dans la zone Euro (40,8% en 2022).
Il faut toutefois relativiser la faiblesse en France par le fait que les impôts liés à la production y sont relativement élevés. Comme vu au chapitre 2, le « vrai ratio » est celui du partage entre l’EBE et la somme « EBE + rémunérations ». Celui-ci est présenté dans le second tableau suivant, montrant que le ratio français n’est plus le plus faible du fait de la Slovénie, et de nouveau à peine moins que celui du Royaume-Uni, voire des États-Uni et la Suisse.
Taux de marge (EBE/VA) des SNF dans le monde depuis 2000 en %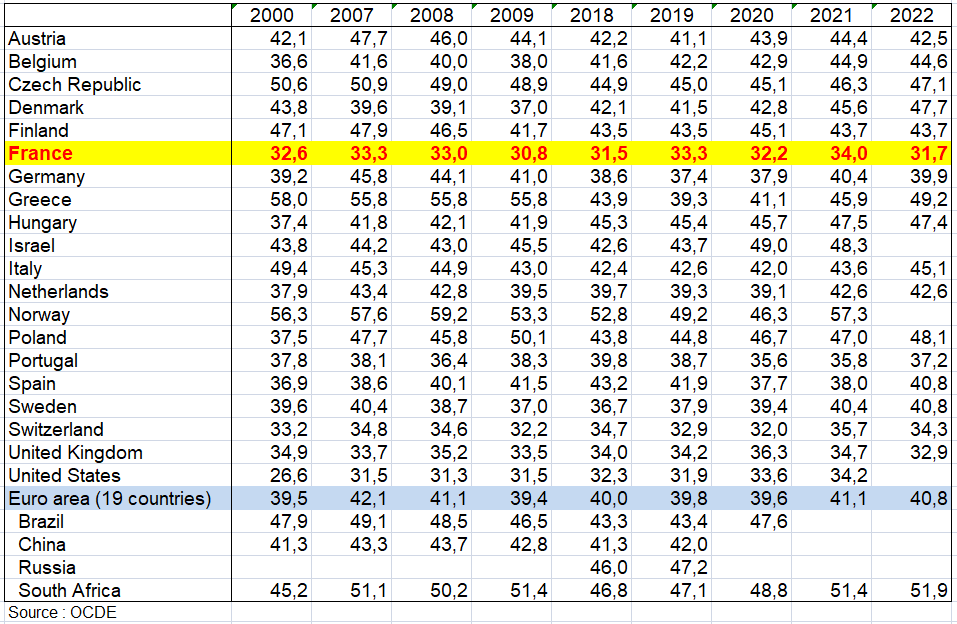
Ratio (EBE/rémunérations salariales + EBE) des SNF depuis 2000 en %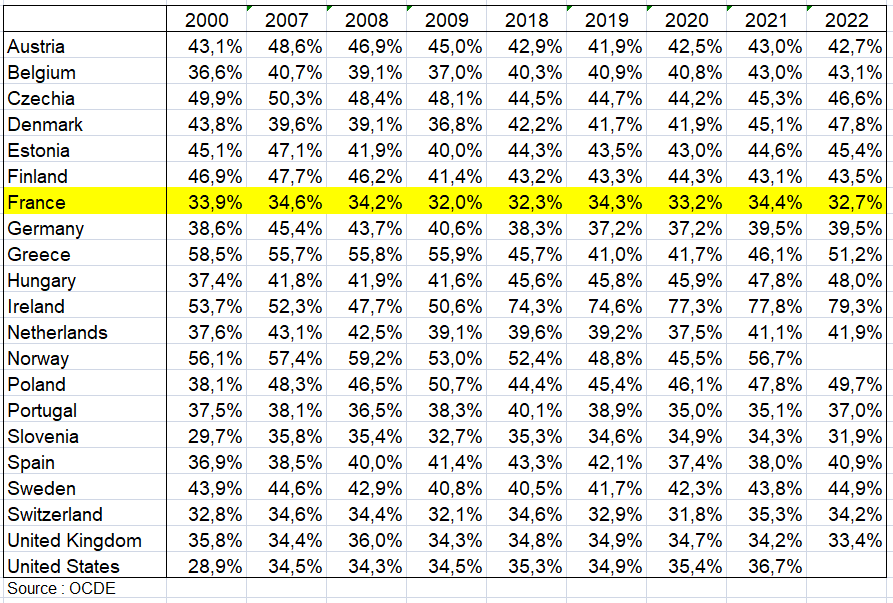
Il faut aussi savoir que les revenus du travail comprennent les cotisations sociales salariales et employeurs. Qui paient ces dernières ? Selon certains économistes, ce ne seraient pas les employeurs. Il s’appuient sur le fait que la répartition rémunérations salariales/ EBE n’a pas augmenté en longue période. De même, les cotisations patronales sont plus faibles aux États-Unis et au Royaume-Uni qu’en France mais la part des revenus du travail dans la valeur ajoutée n’y est pas plus élevée que dans ces 2 pays. En 1995, les cotisations salariales et employeurs représentaient 7% du PIB de ces 2 pays contre 20% en France. Si les cotisations patronales étaient payées par les patrons, on devait donc s’attendre à ce que la part du travail dans la valeur ajouté en France eut été au moins de 10% du PIB supérieure à ce qu’elle était en 1995 dans les pays Anglos-saxons; mais ce n’atait pas le cas. Ca ne l’est toujours pas en 2020. Mais la part des revenus du travail y est quand même supérieure en France de l’ordre de 2%. En fait ce sont bien les employeurs qui paient les cotisations sociales employeurs (qui sont en ressources des salariés mais qui les reversent aux Administrations Publiques selon le traitement de la comptabilité nationale (voir page Dépenses publiques en Europe)
En outre c’est en grande partie le cas avec les pays de l’UE : en France, la part des cotisations sociales employeurs dans le total « Rémunérations + EBE », y est de 14,6% en 2022 contre moins de 10% dans de nombreux pays de l’UE et la part des rémunérations dans ce même rotal est de 67,3% contre moins de 60% dans la plupart des pays (tableaux suivants) sauf au Royaume Uni et aux États-Unis, voire en Allemagne (en tenant compte des nombreuses entreprises individuelles classées abusivement en SNF). Aux Royaume Uni et États-Unis, la part des revenus du travail est élevée du fait de la forte augmentation d’emplois salariés depuis des décennies. On a vu que le ratio est encore plus élevé en Slovénie qu’en France.
Tableau 30 rémunérations et EBE OCDE
Ratio (rémunérations salariales/rémunérations salariales + EBE) des SNF depuis 2000 en %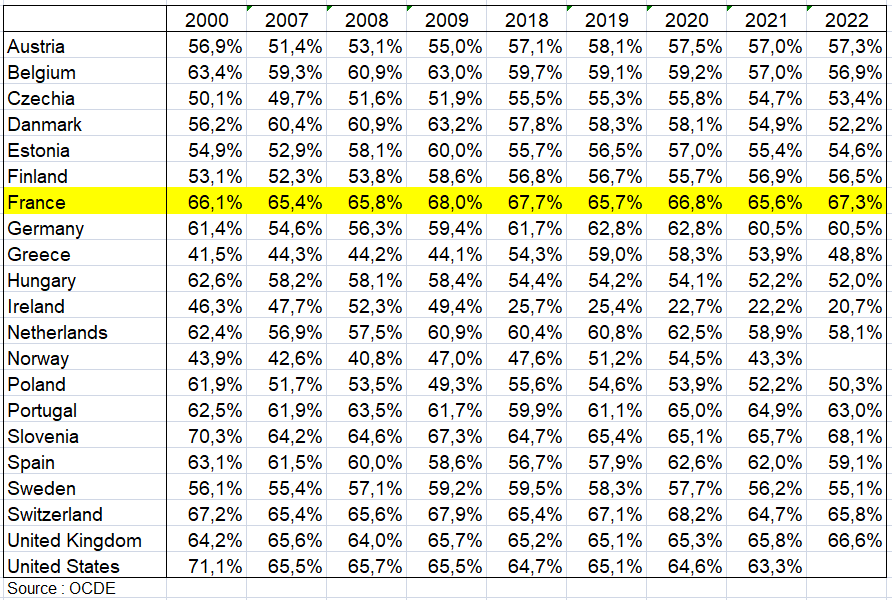
Ratio (cotisations sociales employeurs/rémunérations salariales + EBE) des SNF depuis 2000 en %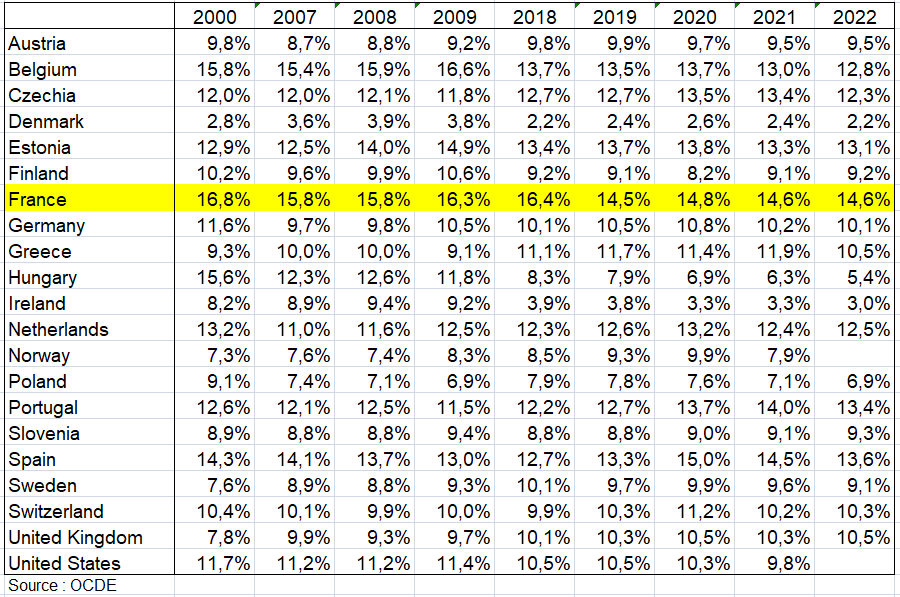
2/ Le taux d’épargne
L’EBE des SNF est principalement utilisé pour payer les impôts sur le revenu et la fortune et pour rémunérer le capital, par exemple sous la forme d’intérêts et de dividendes versés aux actionnaires. Comme déjà dit, les SNF perçoivent également des intérêts et d’autres revenus de la propriété sur leurs placements financiers, par exemple également sous forme de dividendes ou de bénéfices réinvestis. Après comptabilisation de ces paiements et revenus ainsi que d’autres transferts courants divers, le reste de l’excédent brut d’exploitation est disponible comme épargne des sociétés non financières. Celle-ci peut être utilisée par exemple pour des investissements, pour d’autres opérations en capital ou pour être prêté ; si l’investissement et les autres transactions en capital dépassent l’épargne, alors il faut recourir à l’emprunt.
Le graphique suivant montre l’EBE des SNF, la manière dont il est réparti et les prêts nets (s’ils sont positifs) ou leurs emprunts nets (s’ils sont négatifs) qui en résultent qu’on appelle aussi besoin de financement. Les distributions nettes totales (impôts, intérêts, autres revenus/dépenses de propriété, autres transactions courantes et transactions en capital) correspondent généralement à la barre pleine sous l’axe horizontal. En 2022, les distributions nettes totales dans l’UE représentaient -40,6 % de la valeur ajoutée. Elle se déduisaient ainsi de l’EBE pour connaître la capacité de financement (ou le besoin de financement).
En 2022, sept États membres de l’UE affichaient un solde net positif pour certains types de distributions. C’est le cas des autres transactions courantes, notamment en Pologne, en Hongrie et au Luxembourg. Les Pays-Bas étaient le seul État membre à avoir un solde positif pour les transactions en capital.
En dehors des opérations en capital (voir ci-dessous) et en examinant les différents types de distributions courantes, la part la plus importante des sociétés non financières en 2022 concernait généralement les revenus nets de la propriété. Dans l’UE, les revenus nets de la propriété équivalaient à -10,5 % de la valeur ajoutée, représentant ainsi plus des trois cinquièmes de toutes les distributions nettes courantes (impôts sur le revenu et la fortune, revenus nets de la propriété et autres transactions courantes).
Dans l’UE, la grande majorité des revenus nets de la propriété autres que les intérêts en 2022 étaient des revenus distribués des sociétés : cette rubrique représentait 89,9 % des paiements et 79,2 % des recettes de tous les revenus de la propriété autres que les intérêts. En revanche, les revenus réinvestis des investissements directs étrangers représentaient 8,2 % des paiements et 18,4 % des recettes, tandis que les revenus de la propriété attribués aux assurés et les loyers représentaient chacun au plus 1,9 % des paiements et au plus 2,2 % des recettes immobilières. revenus autres que les intérêts.
Les impôts sur le revenu et la fortune équivalaient à -4,9 % de la valeur ajoutée des sociétés non financières dans l’UE. Ces impôts constituaient donc la deuxième composante la plus importante des distributions nettes courantes, derrière les revenus nets de la propriété autres que les intérêts. Trois États membres de l’UE – Chypre, le Danemark et la France – ont indiqué que les impôts sur le revenu et le patrimoine représentaient une part (négative) plus importante des distributions courantes nettes que les revenus de la propriété autres que les intérêts.
De l’excédent brut d’exploitation aux prêts/emprunts nets, 2022, (part en % de la valeur ajoutée brute)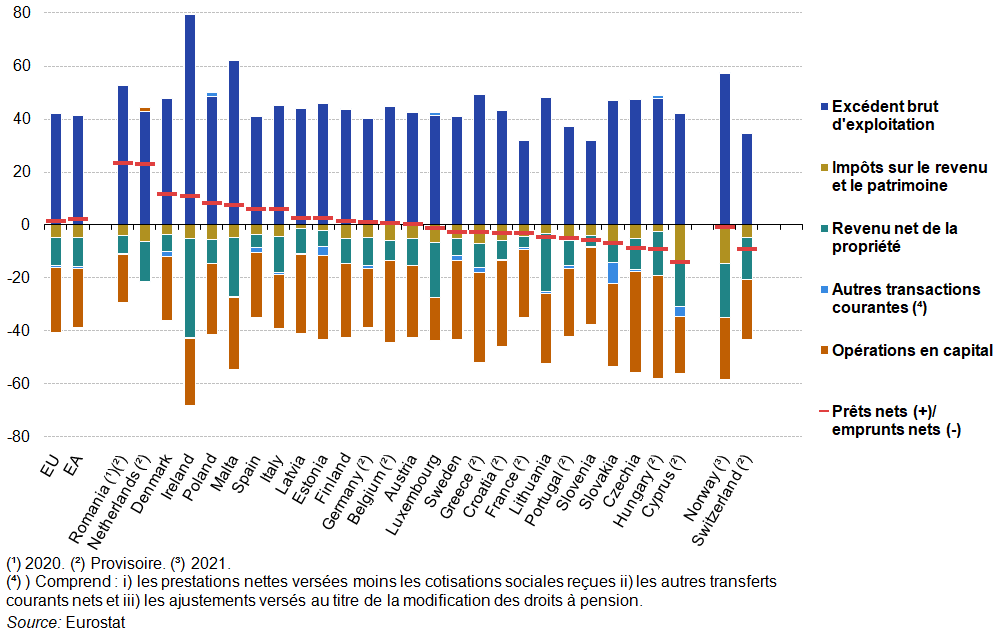
L’épargne et les prêts nets des SNF servent à financer la formation brute de capital, d’autres transferts de capitaux et les acquisitions, moins les cessions d’actifs non financiers non produits. La formation brute de capital comprend la FBCF , les variations des stocks et les acquisitions moins les cessions d’objets de valeur.
La différence entre l’épargne et toutes les transactions en capital est appelée capacité nette de financement ou emprunt net , selon qu’elle est positive ou négative. Si les sociétés non financières sont des prêteurs nets, cela signifie qu’elles disposent d’un excédent d’épargne par rapport aux investissements et autres transactions en capital qu’elles peuvent prêter à d’autres secteurs de l’économie nationale ou à des non-résidents. À l’inverse, ils sont emprunteurs nets lorsqu’ils ont besoin d’emprunter de l’argent auprès d’autres secteurs pour compléter leur épargne afin de financer leurs investissements et autres opérations en capital.
En 2022, les sociétés non financières de l’UE et de la zone euro étaient des prêteurs nets, leurs prêts nets étant évalués respectivement à 1,5 % et 2,3 % de la valeur ajoutée ; voir la figure 8.
Les sociétés non financières de trois des quatre plus grandes économies de l’UE étaient également prêteuses nettes en 2022, à l’exception de la France (emprunt net de 3,3 % de la valeur ajoutée). Le ratio prêts nets/valeur ajoutée était le plus élevé en Espagne et en Italie (5,8 % chacun de la valeur ajoutée), tandis qu’il était inférieur à la moyenne de l’UE en Allemagne (1,1 %).
Il faut quand même relativiser ce résultat de la France par le fait que la FBCF des SNF en base 2014 serait fortement majorée (voir page La FBCF).
Prêts/emprunts nets des sociétés non financières dans l’UE, 2012-2022, (rapport en % des prêts/emprunts nets à la valeur ajoutée brute)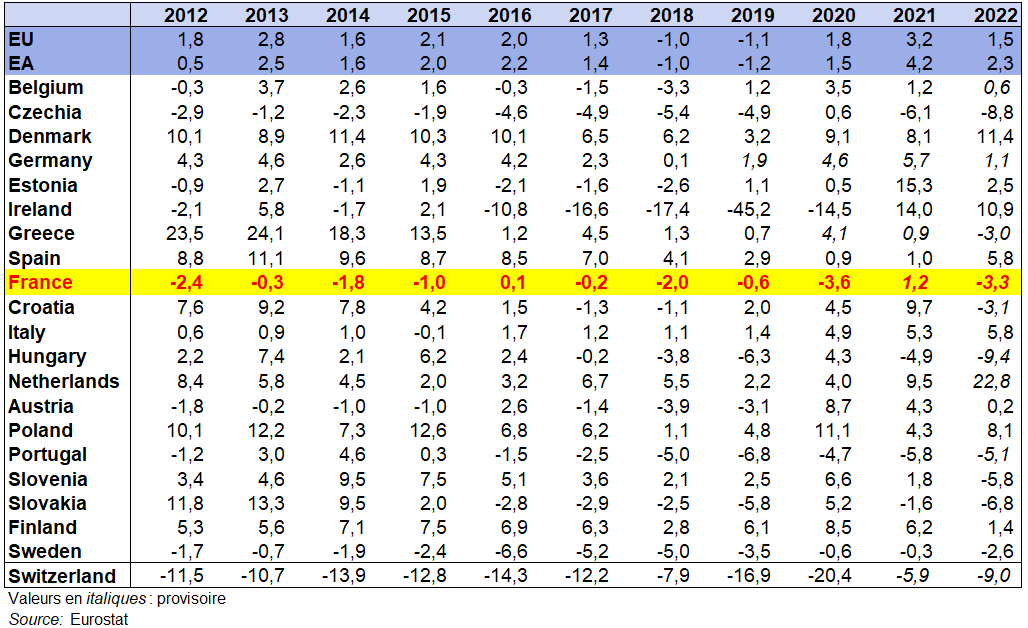
3/ Le taux d’investissement et le taux d’autofinancement
Parmi les quatre plus grandes économies de l’UE, le taux d’investissement des sociétés non financières en 2022 était supérieur à la moyenne de l’UE (23,8 %) en France (25,9 %), tandis qu’il était inférieur à la moyenne de l’UE en Espagne (23,6 %), en Italie ( 22,9 %) et l’Allemagne (20,6 %). Six États membres de l’UE ont signalé des taux inférieurs à 20,0 %, le taux le plus bas étant au Luxembourg (15,4 %). La Hongrie a enregistré le taux le plus élevé (33,9 %), suivie par la Tchéquie (29,3 %) et la Suède (28,4 %). La disparité des taux d’investissement entre les différentes économies peut s’expliquer en partie par des différences structurelles, par exemple l’importance relative des activités à forte intensité de capital.
Même si les investissements annuels peuvent être volatils pour les entreprises individuelles, des tendances cycliques peuvent être observées à l’échelle nationale. Le graphique suivant montre les taux d’investissement des quatre plus grandes économies de l’UE ainsi que les moyennes de l’UE et de la zone euro.
L’autofinancement (différence entre l’épargne brute et la FBCF) est négatif dans quelques pays dont la France sous réserve encore une fois que la FBCF des SNF semblait surestimée en base 2014.
Taux d’investissement brut des sociétés non financières, entre 2012 et 2022, (rapport en % de la formation brute de capital fixe sur la valeur ajoutée brute)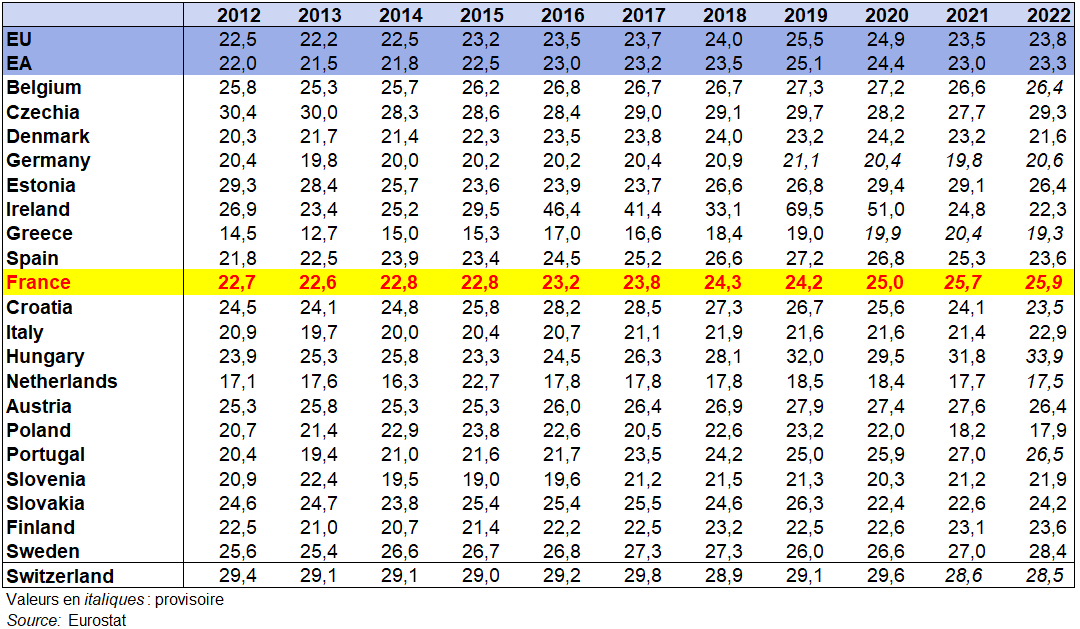
Taux d’investissement (FBCF/VA) des SNF Dans l’UE et les grands pays entre 2012 et 2022 en %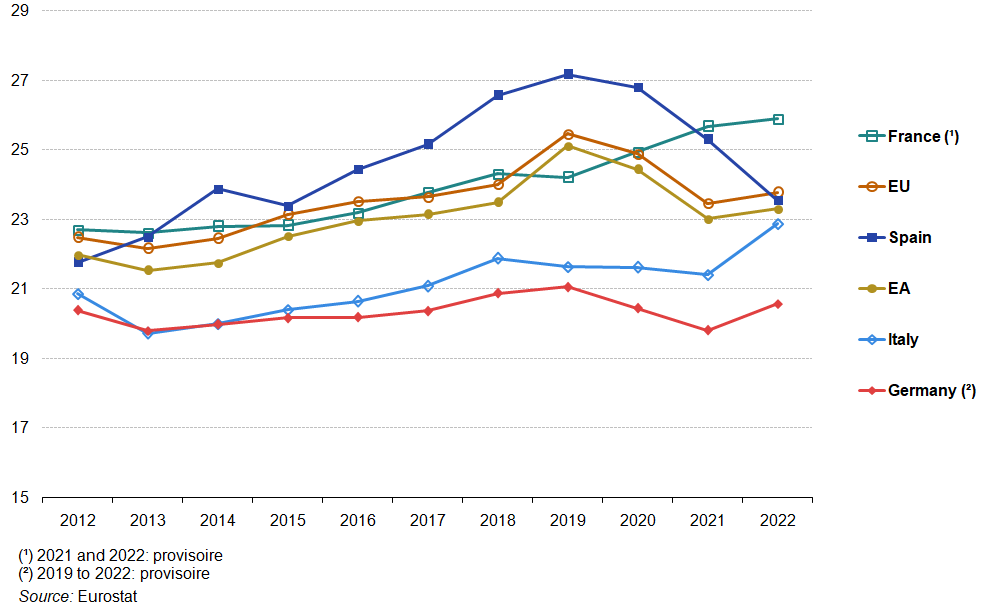
Taux d’épargne brute, de FBCF, et différence entre les 2 (autofinancement) en % de la valeur ajoutée (2022)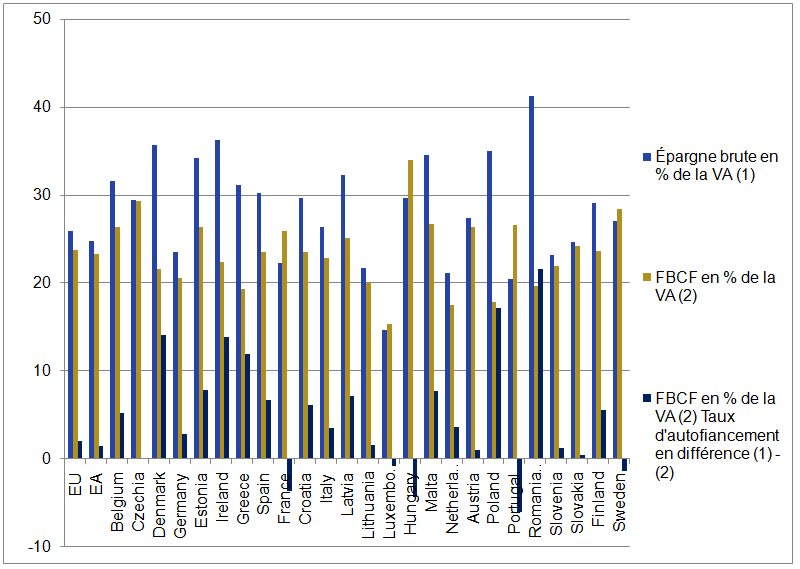
4/ Les actifs et passifs financiers des SNF
a) L’importance relative des actifs et apssifs financiers en France
Le total des actifs financiers des SNF de l’UE était évalué à 22 059 milliards d’euros en 2022. Ce chiffre est bien inférieur à la valeur de leurs passifs financiers, qui s’élevait à 37 245 milliards d’euros. Ensemble,Il s’en suit une position d’actif net négatif de 15 187 milliards d’euros.
La France détenait entre un quart et un cinquième (22,5 %) des actifs financiers des SNFde l’UE ainsi qu’un cinquième (20,0 %) de leurs passifs. L’Allemagne détenait plus d’un cinquième des actifs (21,6 %) et une part légèrement inférieure (17,7 %) des passifs. Les Pays-Bas détenaient un peu plus d’un dixième des actifs (11,9 %) et un peu moins d’un dixième des passifs (9,8 %), tandis que l’Italie avait une part plus faible des actifs (7,7 %), mais une part plus élevée des passifs (10,3 %). Hormis l’Irlande et l’Espagne, tous les autres États membres détenaient chacun une part inférieure à 6,0 %. La France, l’Allemagne, les Pays-Bas et l’Italie représentaient collectivement 63,7 % des actifs financiers et 57,8 % des passifs des sociétés non financières de l’UE.
Les actions représentent presque la moitié des actifs financiers en France comme dans l’UE et on retrouve en partie cette relative importance des dividendes versés en France à des SNF, évoquée ci-dessus.
Part du total des actifs et passifs financiers des SNF de l’UE, 2022, (%)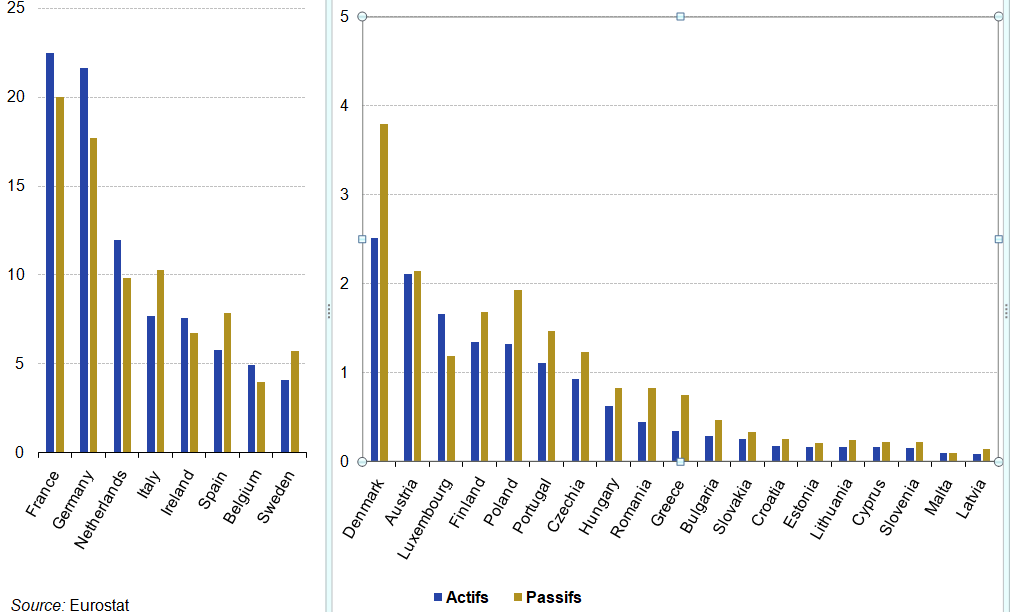
Dans tous les États membres de l’UE, la valeur des passifs financiers des sociétés non financières en pourcentage du PIB était supérieure à 100,0 % en 2022 ; en d’autres termes, les dettes étaient supérieures au PIB. Le ratio était le plus élevé au Luxembourg et en Irlande, où les engagements financiers des sociétés non financières étaient évalués respectivement à 5,7 et 4,9 fois leur PIB. Ainsi, la valeur de leurs engagements financiers en pourcentage du PIB représentait plus du double de la moyenne de l’UE pour ce ratio.
En revanche, la valeur des actifs financiers des sociétés non financières était inférieure à 100,0 % du PIB dans 14 États membres de l’UE. Le Luxembourg et l’Irlande ont à nouveau enregistré les ratios les plus élevés, les actifs financiers des sociétés non financières étant évalués respectivement à 4,7 et 3,3 fois leur PIB.
Actifs et passifs financiers des SNF en pourcentage du PIB, 2022, (%)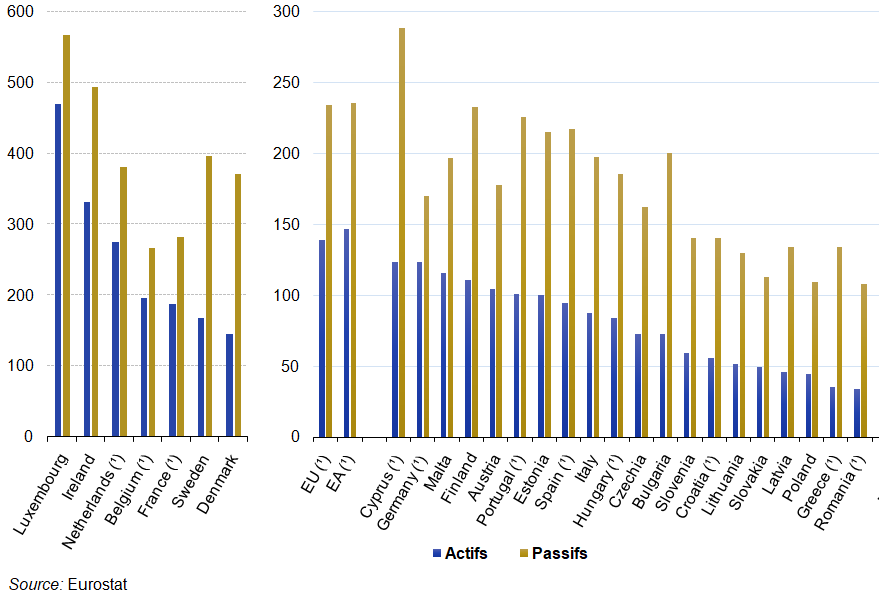
b) Structure de l’actif et du passif
La catégorie des actions et des parts de fonds d’investissement représentait la plus grande part (48,3 %) des actifs financiers des SNF de l’UE en 2022. Ce type d’instrument était suivi par le numéraire et les dépôts (19,8 %), les autres comptes à recevoir/à payer ( 15,4 %) et les prêts (13,5 %). Les autres instruments représentaient une part de 3,0 %.
Le type d’actifs le plus important détenu par les SNF en 2022 variait quelque peu selon les États membres de l’UE.
Part du type d’actifs des SNF, 2022, (part en % du total des actifs financiers des SNF)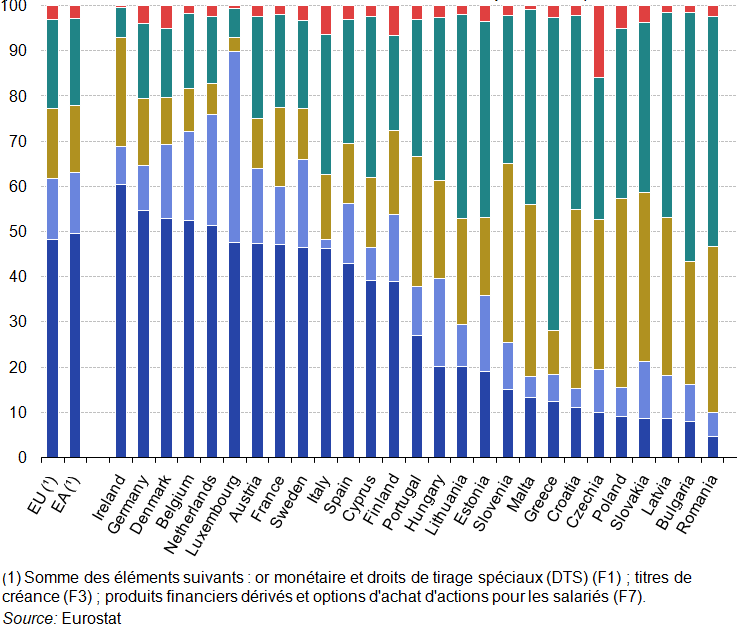
Les parts les plus importantes du total des passifs financiers des SNF de l’UE en 2022 étaient les actions et les parts de fonds d’investissement (56,6 %) et les prêts (28,8 %). Les autres comptes à recevoir/à payer représentaient une part de 8,2 %, suivis par les autres instruments (6,3 %) ; ces dernières ont pris principalement la forme de titres de créance (4,7 % du total). La part du numéraire et des dépôts était de 0,2 %.
Une comparaison de la structure des actifs financiers avec celle des passifs financiers des SNF de l’UE en 2022 fait apparaître quatre différences principales.
Part du type de passif desSNF, 2022, (part en % du total des passifs financiers des SNF)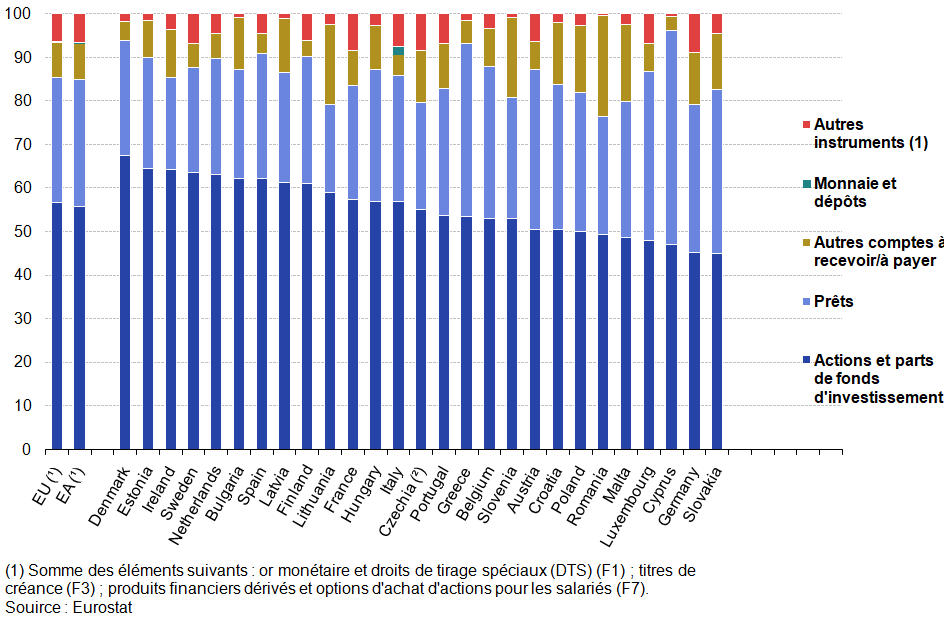
c) Comparaison entre secteurs institutionnels
Dans l’UE, le secteur des sociétés financières détenait la plus grande part des actifs (59,3 %) et des passifs financiers (63,4 %) en 2022. Les SNF détenaient la deuxième plus grande part des passifs (29,3 %), mais la plus petite part des actifs ( 16,1 %) (avec un ratio parmi les plus élevés en France : 21%), tandis que les ménages et les ISBLSM détenaient la deuxième plus grande part d’actifs (24,5 %), mais la plus petite part de passif (7,4 %).
Dans l’UE, la valeur des actifs financiers détenus par les sociétés financières en 2022 était 3,7 fois supérieure à celle détenue par les SNF. Dans la plupart des États membres de l’UE, la valeur des actifs financiers des sociétés financières était entre 1,9 et 4,2 fois supérieure à celle des SNF, avec des ratios plus élevés en Grèce (6,3 fois plus élevé), et au Luxembourg (31,2 fois).
Parts sectorielles des actifs autres que ceux des administrations publiques, 2022, (%) 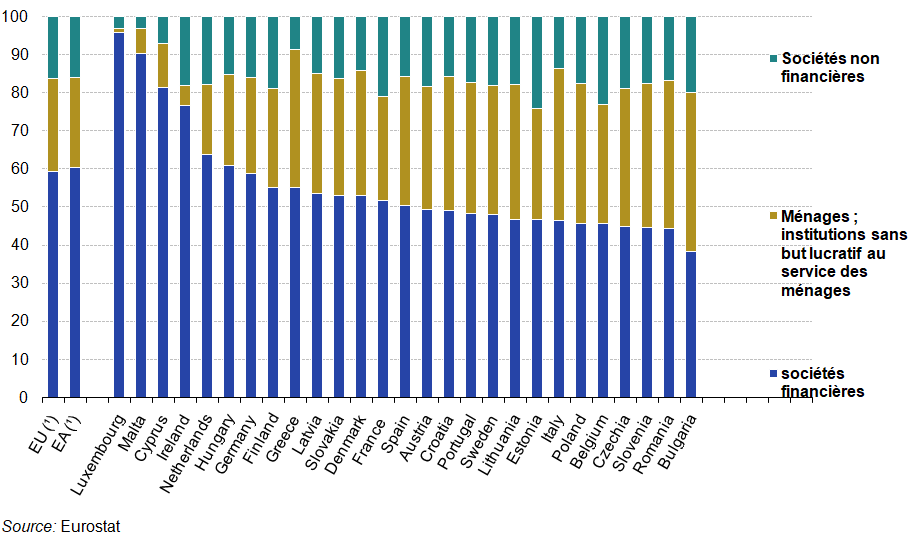
Parts sectorielles des passifs autres que ceux des administrations publiques, 2022 en %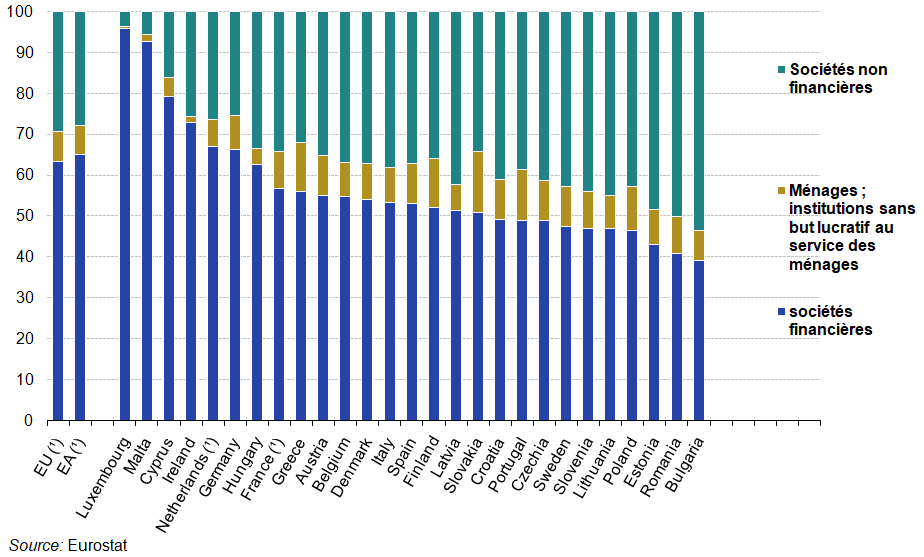
Jusqu’à présent les ratios étaient calculés à partir des comptes courants. Ils concernaient des flux. Ici on met au dénominateur des éléments des comptes de patrimoine (équivalent du bilan d’une entreprise) pour calculer des taux de rentabilité au lieu des taux de marge. C’est aussi une manière d’étudier la financiarisation.
1/ Les taux de rentabilité des SNF
La rentabilité des entreprises, en rapportant une mesure de résultats à des moyens engagés pour les obtenir, est une mesure de leur efficacité. Pour les apporteurs de capitaux, c’est un critère de placement et, pour les entreprises, un indicateur qui leur permet de se situer par rapport à leurs concurrents. Les comparaisons internationales en la matière sont délicates à réaliser mais elles peuvent être tentées à partir des données de la comptabilité nationale, celles-ci étant, au moins partiellement, harmonisées. La rentabilité fournit une mesure de l’efficacité du système productif national et de son attrait pour les investisseurs internationaux. De même qu’en comptabilité d’entreprise, on peut distinguer :
Les rentabilités économiques et financières sont données par les formules suivantes :
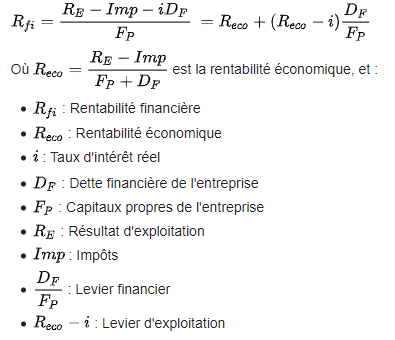
Le profit en comptabilité nationale diffère du profit en comptabilité d’entreprise parce qu’il exclut les plus et moins-values, latentes ou réalisées, lesquelles ne sont pas considérées comme un revenu. En revanche, les impôts sur les plus-values ou, inversement, la diminution de l’impôt, liée à la réalisation de moins-values, sont bien pris en compte. Peu importe à ce stade que le profit soit distribué sous forme de dividendes ou réinvesti au sein de l’entreprise, augmentant de ce fait la valeur de la firme. Les capitaux propres sont mesurés de manière très classique comme la différence entre les actifs et les dettes, mais cette mesure est affectée par le mode de valorisation retenu en comptabilité nationale, à savoir la valorisation des actifs et des passifs en valeur de marché, à l’exception des dépôts et crédits comptabilisés en valeur nominale. La « valeur de marché » est parfois obtenue de manière très conventionnelle, ce qui n’est pas sans influence sur les résultats.
a) Une première approche des ratios de rentabilité
L’examen de la rentabilité calculée pour plusieurs pays à partir des données de la comptabilité nationale permet, plus spécifiquement, de comparer les éléments du contexte macroéconomique déterminants pour la rentabilité (niveau de l’inflation, des taux d’intérêt et des taux d’imposition) et les variables sur lesquelles les entreprises peuvent agir pour s’adapter à ce contexte (répartition entre salaires et profits, taux d’endettement). Les données de comptabilité nationale se prêtent tout particulièrement aux comparaisons internationales puisqu’elles sont en principe harmonisées sous l’égide de règlements communs (Système des comptes nationaux 2008 au plan mondial et Système européen de comptes 2010 au plan européen). Il est toutefois recommandé de rester prudent pour les comparaisons en niveau, car la mise en œuvre des mêmes normes peut se faire sur la base de conventions différentes entre les pays.
Eurostat publie sur son site deux taux de rentabilité qui ne sont pas exactement ceux ainsi définis. Seuls, les comptes de patrimoine financier sont disponibles sur ce site. On ne dispose donc pas du total des actifs, et notamment les actifs fixes non financiers.
Taux de rendement net, après impôt, des fonds propres des entreprises non-financières: (B4N-D5PAY)/(AF5, passifs – actifs)*100
Le rendement brut avant impôt des capitaux employés par les sociétés non financières est défini comme l’excédent brut d’exploitation (code SEC 2010 : B2G_B3G) divisé par les principaux passifs financiers. Ces derniers comprennent les liquidités et les dépôts (AF2), les titres de créance (AF3), les prêts (AF4) et les actions/actions/parts de fonds d’investissement (AF5)
Taux de rendement net, après impôt, des fonds propres des entreprises non-financières: (B4N-D5PAY)/(AF5, passifs – actifs) *100
Le taux de rendement net, après impôt, des fonds propres des entreprises non-financières est défini comme le revenu d’entreprise net (code SEC 2010: B4N) moins les impôts courants sur le revenu et le patrimoine (D5PAY) divisé par les actions et parts de fonds d’investissement (AF5) au passif.
S’agissant du ratio de rentabilité financière (Rendement net des capitaux propres, après impôts), il est aussi l’un des plus faibles en France (10% en 2020). Mais il est plus faible dans les pays déjà cités et même au Royaume-Uni. En revanche, contrairement au taux de marge, il est beaucoup plus élevé en Allemagne (ré-estimé) : 47,1%. En Italie, le Rendement net des capitaux propres, après impôts est assez proche du ratio français (10,4%) alors que le taux de marge est plus élevé. Entre 2011 et 2020, ce ratio diminue de -43% en France, de nouveau plus que dans la zone Euro (-31%) ou dans l’UE (-35%).
Rendement net des capitaux propres, après impôts, des sociétés non financières (SNF) en %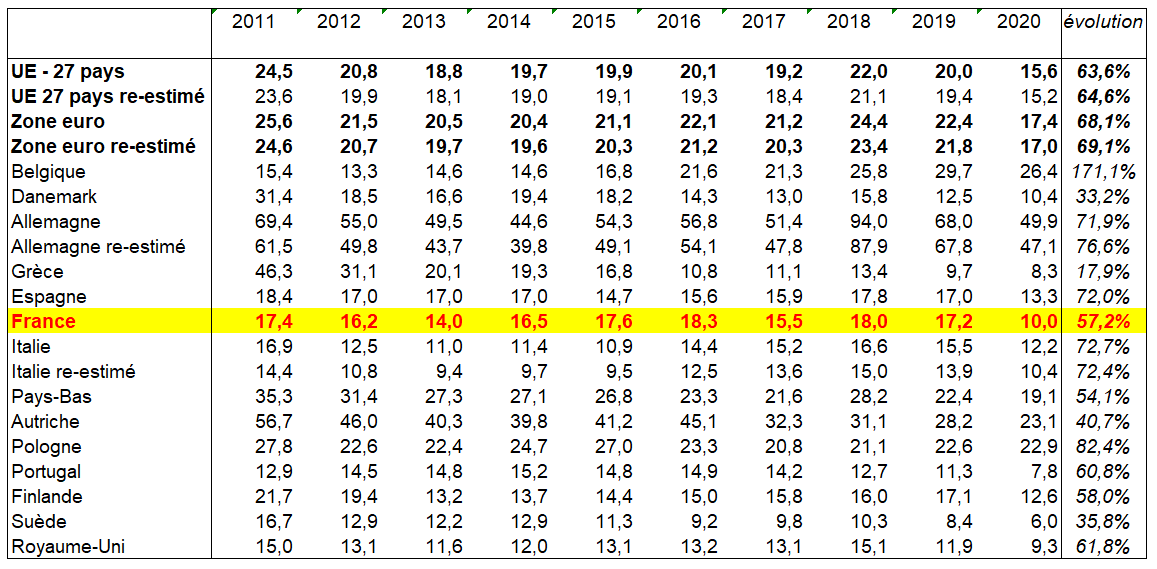
Rendement net des capitaux propres, après impôts, des sociétés non financières (SNF) en %
b) Endettement et rentabilité
Tableau 36 SNF ratio financier et levier EurostatN
On définit d’abord le taux de rentabilité financière nette comme le rapport du revenu net d’exploitation (B4N) à la disposition des actionnaires après paiement des impôts et des intérêts nets rapporté au fonds propres nets (Actions et parts de fonds d’investissement; passifs – actifs). On retrouve l’écart du taux de marge entre la France et l’UE (respectivement 9,4% contre 14;8% en 2020). En revanche, à taux de marge assez proche, le taux de rentabilité serait ici aussi plus élevé en Allemagne qu’en France à moins d’un nouveau souci de comparabilité entre les deux pays.
Taux de rentabilité net des sociétés non financières (SNF) en %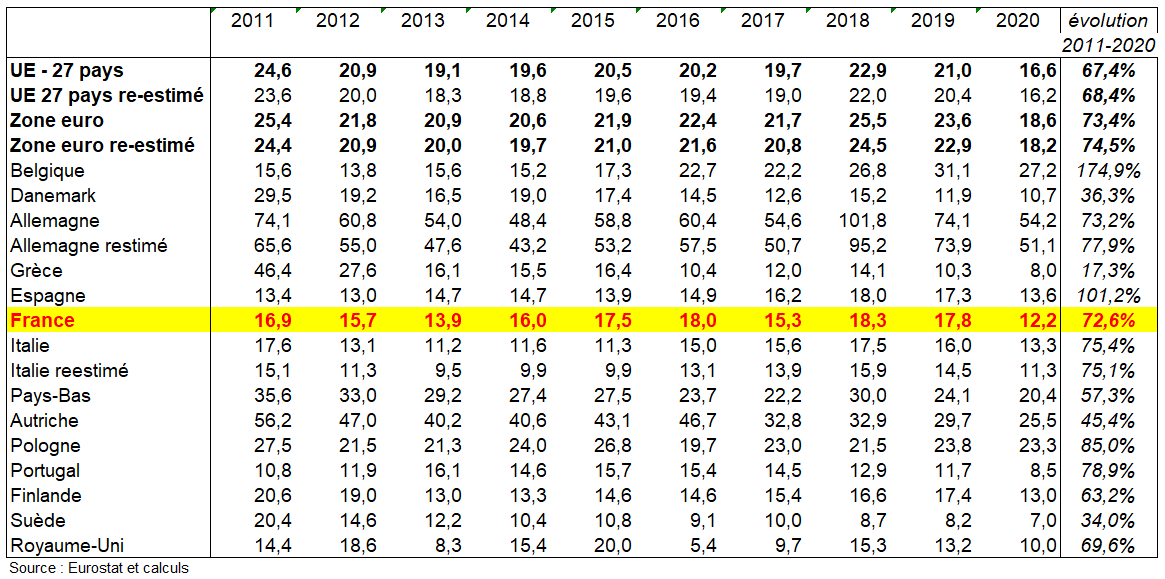
À partir des données d’Eurostat, on calcule ici la rentabilité économique nette: elle rapporte le résultat d’entreprise net (B4N dan le SEC 2010) , moins les impôts courants sur le revenu et le patrimoine, au capital financier nette. Celui-ci est la somme des titres de créance, crédits et actions et parts de fonds d’investissement; (passifs – actifs).
Ce ratio varie selon les pays. Il est très élevé en Allemagne et dans une moindre mesure en Pologne, aux Pays-Bas et en Belgique. Il est faible en France, Italie (re-estimé), Portugal, Grèce, Suède, Royaume-Uni.
Rentabilité économique nette des capitaux employés des sociétés non financières (SNF) en %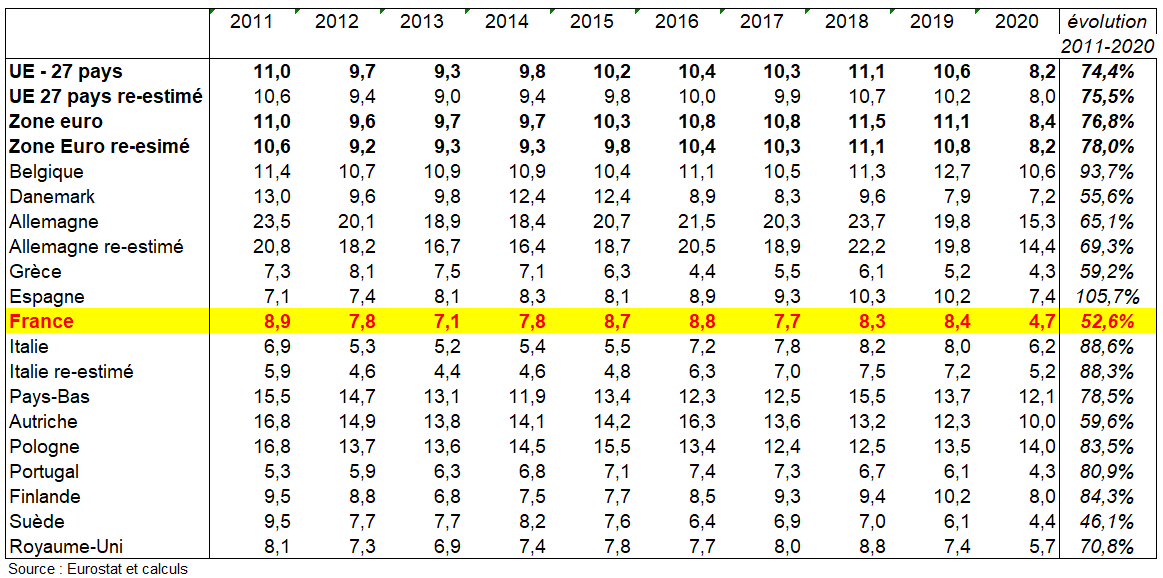
Puis on calcule le taux d’intérêt nominaux versés net des intérêts reçus sur les crédits et titres de créance nettes des SNF. Il rapporte les intérêts versés moins reçus aux stocks (engagements) de titres de créances et de crédit (au passif – actif) du compte de patrimoine financier. Ce taux devient inférieur à 1% en 2020 dans la plupart des pays. Il est même négatif en Allemagne (où les intérêts reçus sont supérieurs aux intérêts versés), et proche de 0 aux Pays-Bas. Dans la zone Euro, il est de 0,5% et de 0,5% en France. Il a beaucoup diminué depuis 2011 du fait de la baisse des taux d’intérêt sur les marchés financiers et monétaires : -62% dans la zone Euro, -68% en France.
Mais il convient ensuite de calculer le taux d’intérêt réel en retranchant au taux nominal le taux d’inflation. Compte tenu de celle-ci, les taux d’intérêt nominaux sont négatifs dans la plupart des pays durant la seconde partie de la décennie 2010.
Taux d’intérêt nets nominaux sur les crédits et titres de créance des sociétés non financières (SNF) en %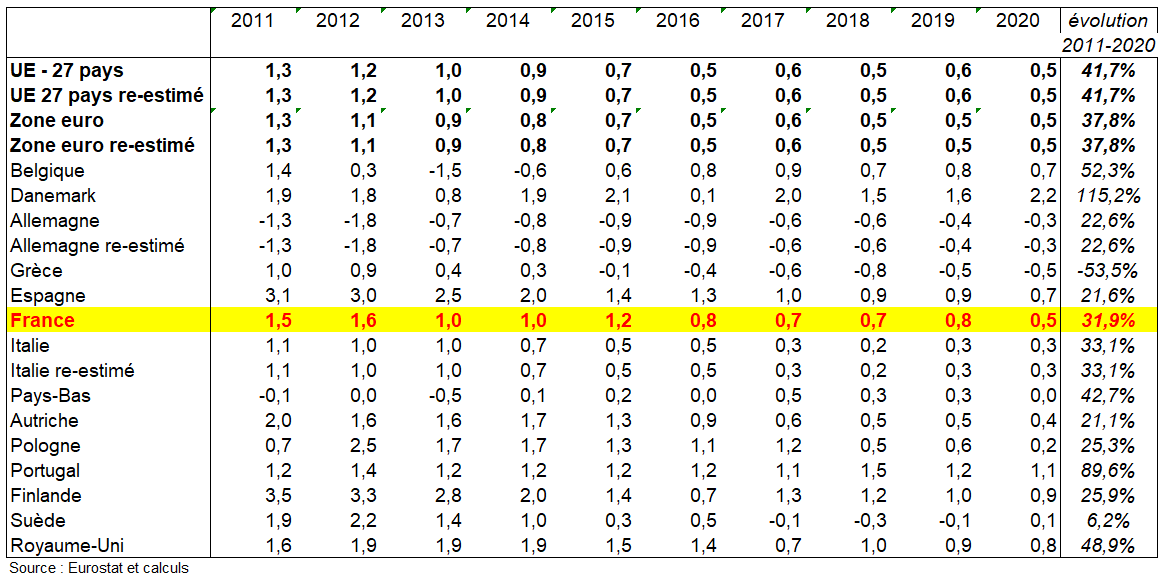
Taux d’inflation du PIB en %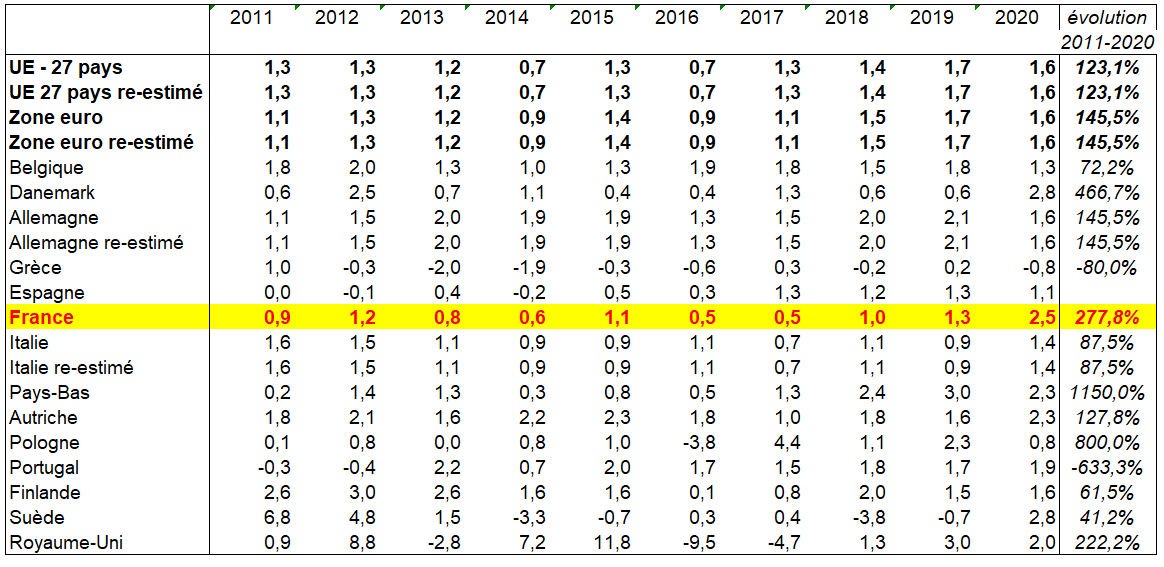
Taux d’intérêt nets réels sur les crédits et titres de créance des sociétés non financières (SNF) en %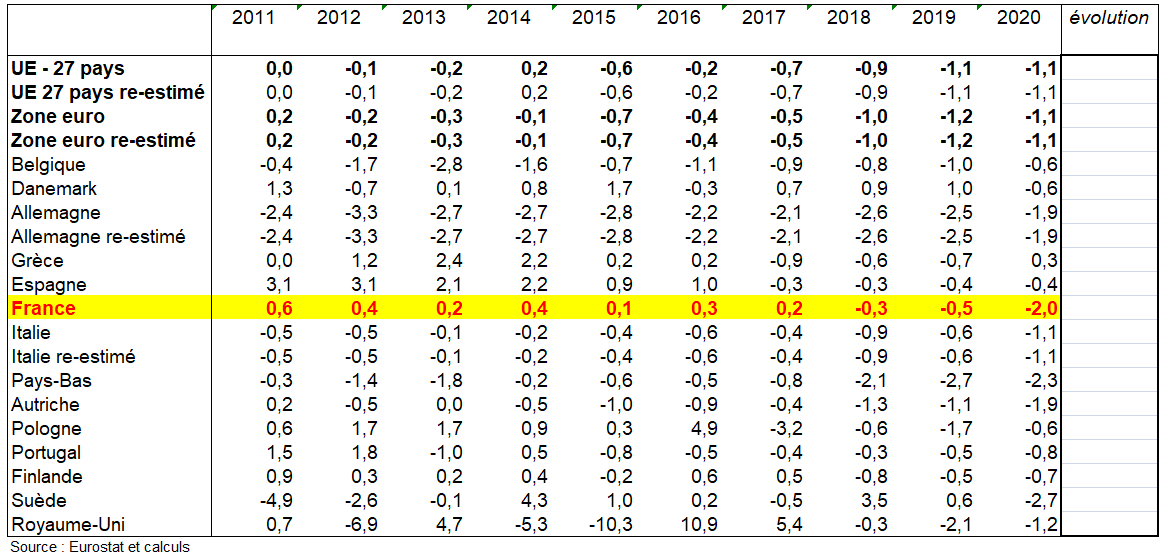
1/ L’effet de levier est mesuré ici par la différence entre le taux de rentabilité financière net et le taux de rentabilité économique net. Si la rentabilité économique nette est supérieure au coût net de la dette, ceci induit un effet de levier positif d’intensité variable et donc un taux de rentabilité financière supérieur au taux de rentabilité économique. Pour le calcul de l’effet de levier, on a tenu compte de l’inflation (taux d intérêt réel). Ce taux est la différence entre le taux d’intérêt nominal net (rapport des intérêts versés moins les intérêts reçus aux dettes nettes) et le taux d’inflation.
L’effet de levier est le produit de deux facteurs :
L’effet de levier est positif si la rentabilité économique nette est supérieure au coût réel apparent de la dette. Dans ce cas, les entreprises ont intérêt à financer leurs investissements en s’endettant.
L’effet de levier désigne l’utilisation de l’endettement pour augmenter la capacité d’investissement d’une entreprise, d’un organisme financier ou d’un particulier et l’impact de cette utilisation sur la rentabilité des capitaux propres investis. L’effet de levier augmente la rentabilité des capitaux propres tant que le coût de l’endettement est inférieur à l’augmentation des bénéfices obtenus grâce à l’endettement. Dans le cas inverse il devient négatif.
2/ Le levier financier est défini comme le rapport de la dette nette aux fonds propres nets. Son évolution conditionne celle de la rentabilité financière. En France, le levier financier n’est pas vraiment plus élevé que dans les autres pays : les dettes nettes représentent 112,7% des fonds propres en France en 2020 contre 106,5% dans la zone Euro (226,2% en Allemagne et 148,3% en Belgique mais moins de 65% dans certains pays scandinaves et au Royaume-Uni). Mais il augmente en France entre 2011 et 2020 (+17,6%) contre -20% dans la zone Euro.
L’endettement procure un effet démultiplicateur pour les actionnaires lié au fait qu’ils n’apportent qu’une partie des sommes sur lesquelles porte un investissement. Cet effet est d’autant plus important que le taux d’intérêt auquel est souscrit l’emprunt est faible et que la rentabilité économique de l’investissement est importante.
Effet de levier des sociétés non financières (SNF) en %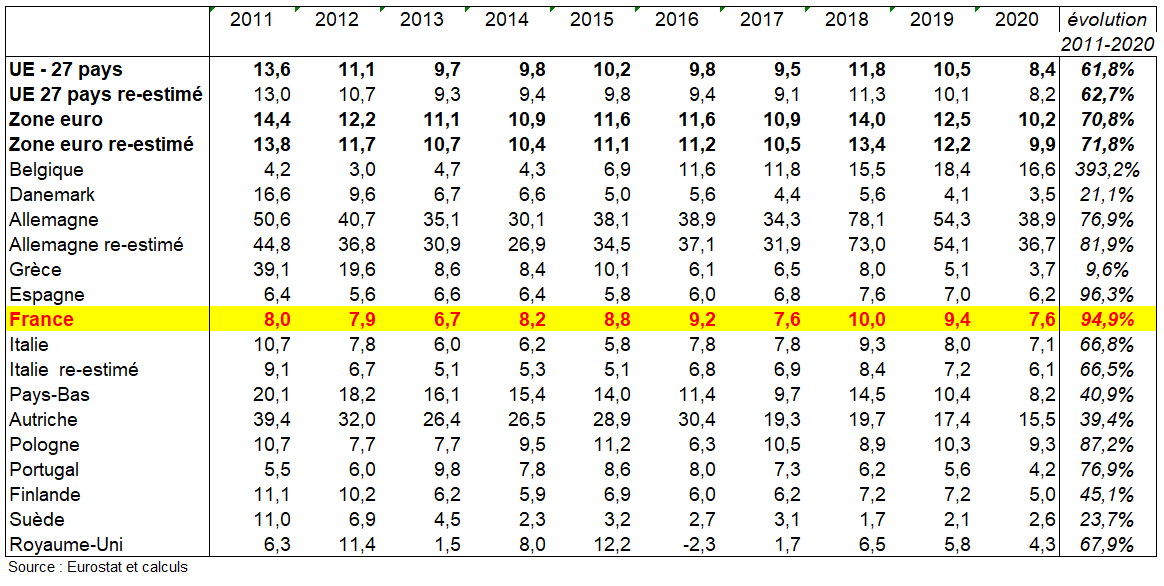
Levier d’exploitation (rentabilité économique – taux d’intérêt réel) des sociétés non financières (SNF) en %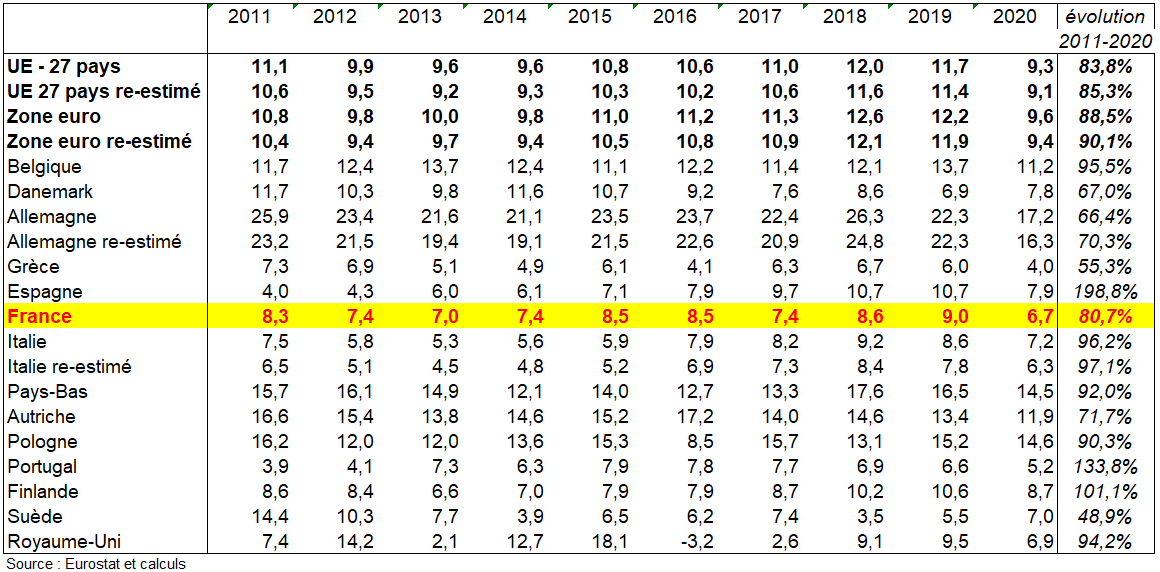
Levier financier : rapport des dettes aux fonds propres des sociétés non financières (SNF) (en %)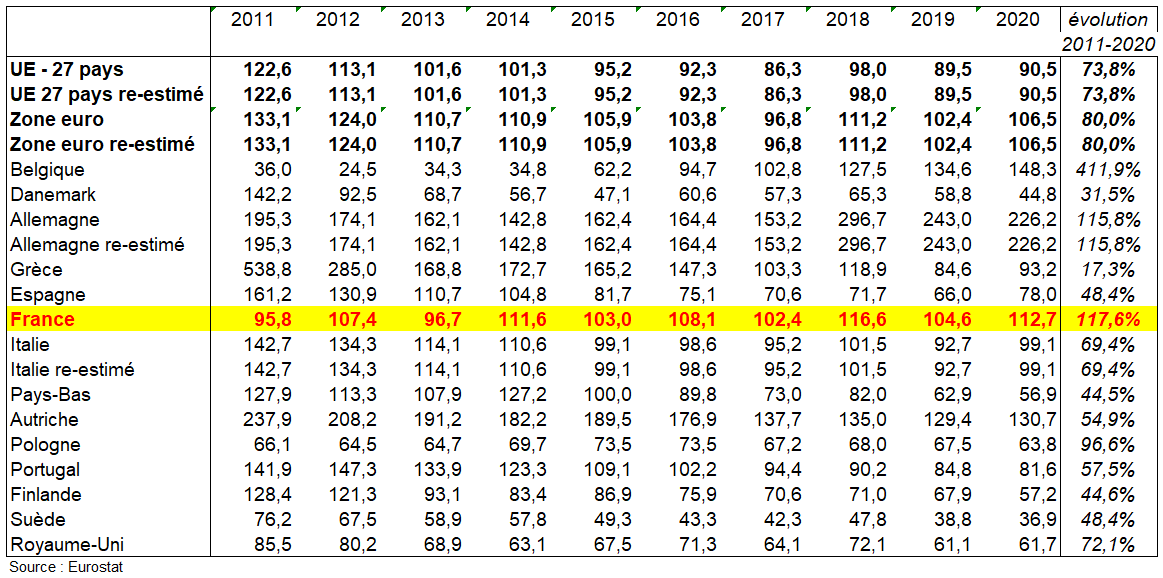
L’effet de levier devrait être d’autant plus élevé que les entreprises sont endettées par rapport à leur fonds propres. C’est le cas de l’Allemagne, l’Autriche et la Belgique en 2020. En revanche, le Danemark, la Suède, la Finlande et le Royaume-Uni, ont des niveaux d’endettement faible et des effets de leviers faibles. Mais on trouve des pays qui ne rentrent pas dans ces deux catégories. En France, Italie, Grèce et au Portugal, le niveau d’endettement est assez élevé malgré un effet de levier faible. À l’inverse, les SNF de la Pologne, voire des Pays-Bas, ont un niveau d’endettement faible malgré un effet de levier important.
Plus les entreprises s’endettent, plus elles sont vulnérables à une baisse inattendue de la rentabilité économique. Lorsque celle-ci devient inférieure au coût réel de la dette nette, l’effet de levier devient négatif et la rentabilité financière inférieure à la rentabilité économique.
En 2020, les prêts garantis par l’État en France et leur équivalent dans les autres pays d’Europe échappent un peu au mécanisme décrit ici de l’effet de levier. Il fallait d’abord maintenir à flot la trésorerie des entreprises. Dans plusieurs pays (France, Espagne, Belgique, Italie), les taux d’endettement ont augmenté sans que l’effet de levier progresse du fait de la baisse du taux de rentabilité économique.
Effet de levier, levier d’exploitation et taux d’endettement des sociétés non financières (SNF) en 2020 en %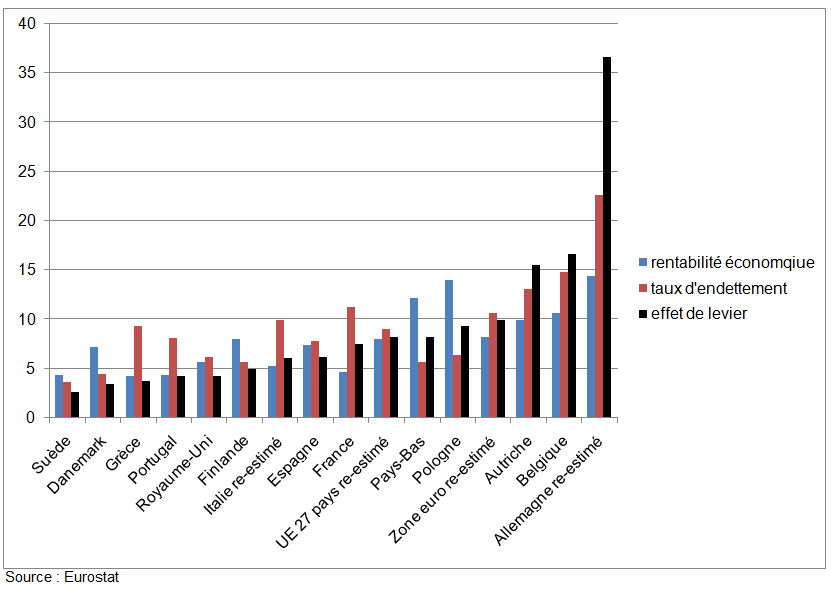
2/ Hausse du ratio d’endettement « brute » des SNF en France en 2020
L’endettement comprend, pour chacun des secteurs considérés, les crédits obtenus des intermédiaires financiers résidents et non-résidents (donc à l’exception des crédits intra-groupes et inter-entreprises ainsi que des crédits commerciaux) et les encours de titres émis en valeur nominale. Pour les autres pays, dont les données sont moins détaillées, l’endettement des SNF sous forme de crédits est calculé en retirant du total des crédits reçus le montant des financements apportés sous forme d’opérations de prêts, essentiellement à des entreprises affiliées résidentes et non-résidentes.
En France, les prêts garantis par l’État (PGE) et la politique monétaire très accommodante de l’Eurosystème ont permis d’assurer que le besoin de nouveaux financements soit satisfait sans difficulté. Les prêts garantis par l’État ont ainsi permis d’apporter un soutien en trésorerie à hauteur de 135 milliards d’euros (à mi-mars 2021) au bénéfice de plus de 645 000 entreprises. Le PGE a surtout bénéficié aux TPE/PME, tant en nombre (95%) qu’en encours (75%). Entre le premier et le deuxième trimestre 2020, ces évolutions du crédit associées à des émissions de titres de dettes également importantes, ont provoqué une hausse de plus de 8 points du taux d’endettement des SNF. Si l’on considère l’endettement brut des SNF, la comparaison avec les autres pays de la zone euro montre que le ratio d’endettement des SNF françaises fin 2022 est le plus élevé, sauf le Japon, avec des écarts de 15 points à 30 points selon les pays (81 % en France contre 65% % en Italie, 61 % en Espagne, 52 % en Allemagne) et seulement 50% aux États-Unis (tableau suivant).
On retrouve ce concept dans les comptes de patrimoine de l’Insee comme « Endettement des agents non financiers » soit la somme des titres de créance et des Crédits au passif moins les titres de créance et les Crédits à l’actif. En 2020 ce montant est de 1994,7 Mds d’euros pour les SNF, soit 86,6% du PIB.
Taux d’endettement brut des sociétés non financières (en % du PIB)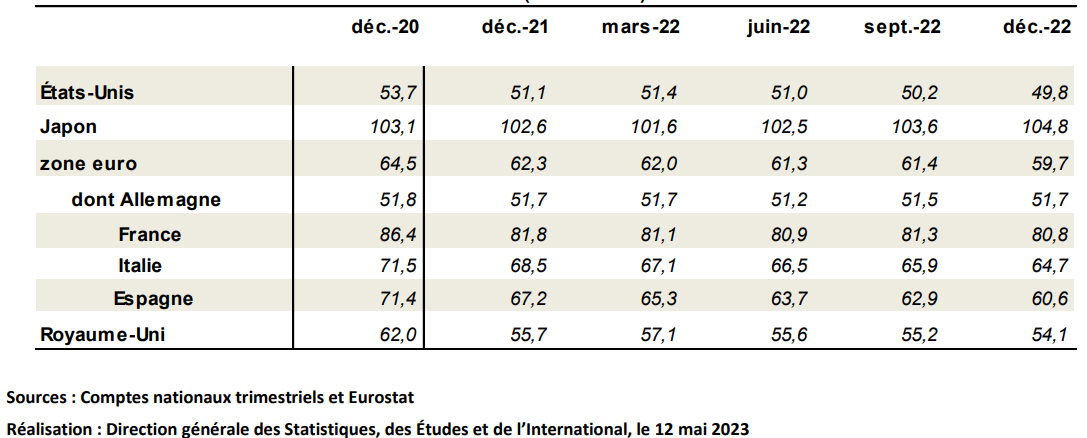
Cette constatation d’un endettement brut assez élevé en France doit donc être nuancée : au total, en 2020 la dette brute des SNF a certes augmenté de 215 milliards d’euros en France en 2020 (soit + 12% par rapport à son encours de fin 2019), sous l’effet de la progression des crédits bancaires (+ 135 milliards d’euros) et du dynamisme des émissions de titres de créances (+ 80 milliards d’euros). En parallèle, la trésorerie des SNF a augmenté de 185 milliards d’euros (soit + 29 % par rapport à son encours de fin 2019), essentiellement sur les dépôts à vue (+ 159 milliards d’euros).
Le flux de dette nette des SNF n’est donc plus que de 30 milliards d’euros sur un encours de dette nette de 1035 milliards environ : c’est donc au total une hausse peu marquée de l’endettement net des SNF dans leur ensemble. Ce constat global masque toutefois des différences marquées entre secteurs d’activité et, au sein de ces secteurs, entre entreprises.
Cet impact différencié serait préoccupant du point de vue macroéconomique, quand des entreprises initialement performantes et saines font face à un endettement important, dont on peut craindre que la persistance ne contraigne le développement futur, et reporte les projets d’investissement et les embauches. Un cercle vicieux peut s’instaurer lorsque le ralentissement de l’investissement vient réduire l’activité des fournisseurs, etc.
Par ailleurs, les entreprises qui ont accumulé de la trésorerie ne sont pas nécessairement les mêmes que celles qui ont accumulé des dettes. Certaines, compte tenu de la structure de leur BFR, ont enregistré une baisse de leur endettement net. D’autres en bonne santé ont, dans un contexte de très forte incertitude, augmenté leur dette mais également leur niveau de trésorerie disponible à titre de précaution ; la réduction de l’incertitude devrait conduire ces entreprises à réduire ce surcroît de trésorerie et, parallèlement, à se désendetter pour un montant équivalent. C’est ainsi qu’en février dernier, 37% des PME ayant souscrit un PGE indiquaient ne pas l’avoir utilisé. A contrario, pour une autre partie des entreprises ayant dû s’endetter pour faire face au choc de liquidité, on constate également une baisse de la trésorerie.
Cette hétérogénéité sectorielle et individuelle (les motifs des dettes des multinationales ne sont pas les mêmes que celles des petites entreprises) persiste aujourd’hui aussi en termes d’activité (voir page Reprise économique fragile). Elle pouvait peser davantage en terme de déformations de la structure d’endettement, pour les entreprises qui continuent d’enregistrer des niveaux d’activité nettement inférieurs à ceux d’avant‑crise.
1/ Entreprises actives dans l’économie marchande de l’UE
a) Entreprises par secteur de l’UE
On donne ici un aperçu de la population des entreprises commerciales. Il est basé sur des données agrégées pour l’industrie (sections B à E), la construction (section F) et les services (sections G à N, à l’exclusion des activités des sociétés holding – K64.2), selon la NACE Rév. 2. En 2020, en regardant au niveau de l’UE, près des trois quarts (66 %) de toutes les entreprises actives dans l’économie marchande (NACE Rév. 2 sections B à N, à l’exclusion de K64.2) appartenaient au secteur des services, fournissant du travail à environ deux tiers du nombre total de personnes employées (voir les deux graphiques suivants). Les services représentaient entre 63,2 % du nombre de toutes les entreprises de l’économie marchande en Slovaquie et 85,3 % du total au Luxembourg. En termes de contribution à l’emploi, le secteur des services représentait 53,2 % de la main-d’œuvre en Tchéquie,
En revanche, seuls 9,9 % des entreprises actives dans l’UE appartenaient à l’industrie, même si ces entreprises fournissaient du travail à plus de 32 millions de personnes. La taille moyenne des entreprises industrielles (mesurée en termes de nombre de personnes occupées) était considérablement plus élevée dans l’industrie que dans les services. En effet, les entreprises industrielles employaient en moyenne 13 personnes dans les 27 États membres, contre une moyenne de quatre personnes pour les services. Le nombre moyen de personnes employées dans la construction était le plus bas, avec trois personnes par entreprise.
Structure des entreprises actives par secteur, économie marchande, 2020 (%)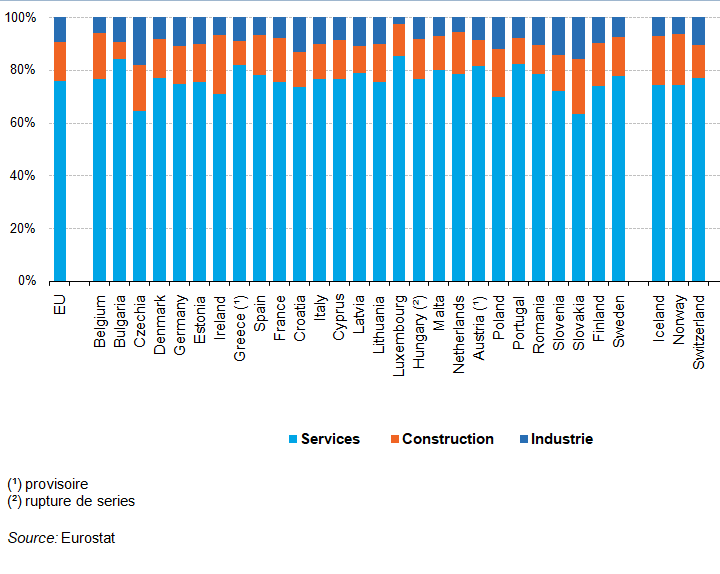
Structure de l’emploi par secteur, économie marchande, 2020 (%)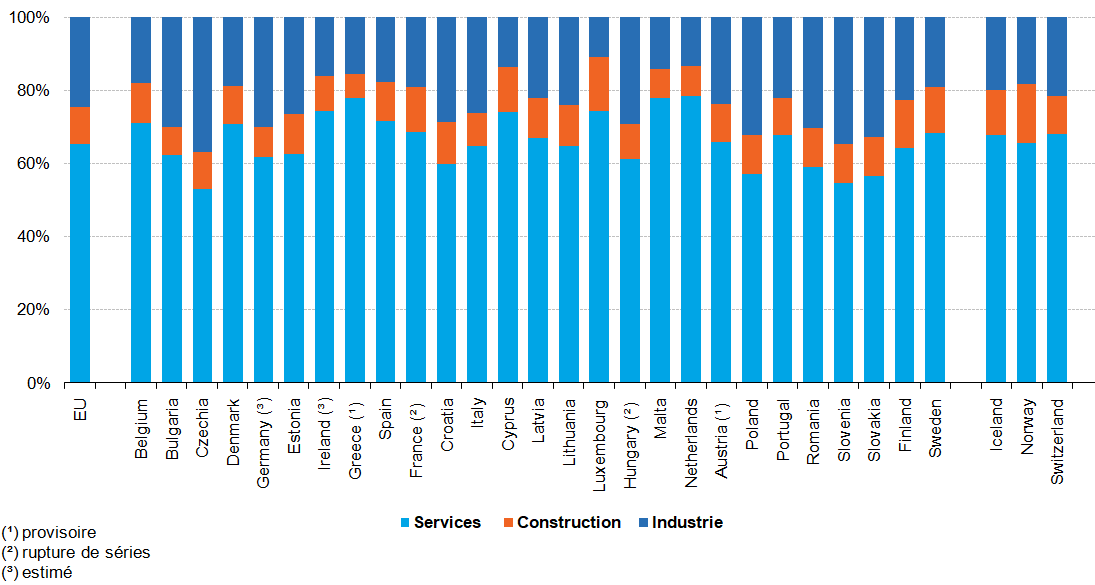
b) Les effectifs et la valeur ajoutée par taille d’entreprises
Dans les tableaux d’Eurostat, les ETI et les GE définissent les grandes entreprises. On a considéré que les entreprises de moins de 49 peronnes représentent les petites entreprises.
En 2019, il y avait au total 23,2 millions d’entreprises non financières dans l’UE. Les petites entreprises (PE) sont définies comme ayant moins de 50 personnes occupées. À l’intérieur de ce groupe, on distingue les micro-entreprises (moins de 10 salariés). Le graphique suivant montre qu’en 2018, les PE constituaient la grande majorité des entreprises de l’UE soit 95 % en Allemagne et au Luxembourg, et plus encore dans les autres États membres de l’UE. Parmi les PE, les micro-entreprises représentaient 93 % du nombre total d’entreprises. En revanche, les grandes entreprises (GE) avec 250 personnes occupées ou plus représentent 0,5 % de l’ensemble des entreprises dans tous les États membres de l’UE. Les entreprises de tailles moyennes (PME) emploient entre 50 et 249 personnes. Elles sont généralement plus prédominantes dans les pays où la proportion de grandes entreprises est plus élevée : Allemagne, Autriche, Luxembourg, Danemark.
Toutefois, en ce qui concerne le nombre de personnes occupées dans l’UE, les parts varient considérablement, avec environ la moitié d’entre elles travaillant dans les PE en 2019, 16 % dans les PME et plus d’un tiers dans les GE. Parmi les États membres pour lesquels des données sont disponibles, la proportion la plus importante de personnes occupées dans les petites entreprises a été observée en Grèce (69 %) et en Italie (63 %), et pour les entreprises de taille moyenne au Luxembourg (24 %) ainsi qu’en Estonie (23 %). Pour les grandes entreprises, les proportions les plus élevées ont été observées en France (49 %) et en Suède (45 %).
En ce qui concerne la valeur ajoutée, 35 % de la valeur ajoutée provenaient de petites entreprises, 17 % de moyennes et 48 % de grandes entreprises. Ces parts varient d’un État membre à l’autre. En 2019, la plus grande part de la valeur ajoutée générée par les petites entreprises a été constatée à Malte (56 %) et à Chypre (53 %), tandis que les moyennes entreprises ont généré la plus grande part de la valeur ajoutée en Estonie (26 %), en Lettonie et en Lituanie (tous deux 25 %). Les proportions les plus élevées pour les grandes entreprises ont été observées en Irlande (64 %), en France (57 %) et en Allemagne (53 %).
Ainsi la France se caractériserait en 2019 par une part prédominante des grandes entreprises aussi bien en terme d’effectifs mais surtout de valeur ajoutée sous réserve d’une même définition des entreprises dans tous les pays : unités légales ou entreprises profilées.
En terme de valeur ajoutée, ce sont les PME qui ont un poids faible en France : 12% de la VA totale contre 17% dans l’UE et en Allemagne, 18% en Italie ou Suède. Alors que la part des petites entreprises est la même en France et en Allemagne : 30% mais 35% dans l’UE.
Le rapport du ratio « part de la VA en France /part de la VA dans l’UE » est ainsi de 86% pour les PE, contre seulement 73% pour les PME et 120% pour les GE.
Tableau 41 effectifs par taille entreprises eurostat 2019
Tableau42 VA par taille entreprises eurostat 2019
Répartition du nombre de personnes occupées dans l’UE par taille d’entreprises en 2019 en %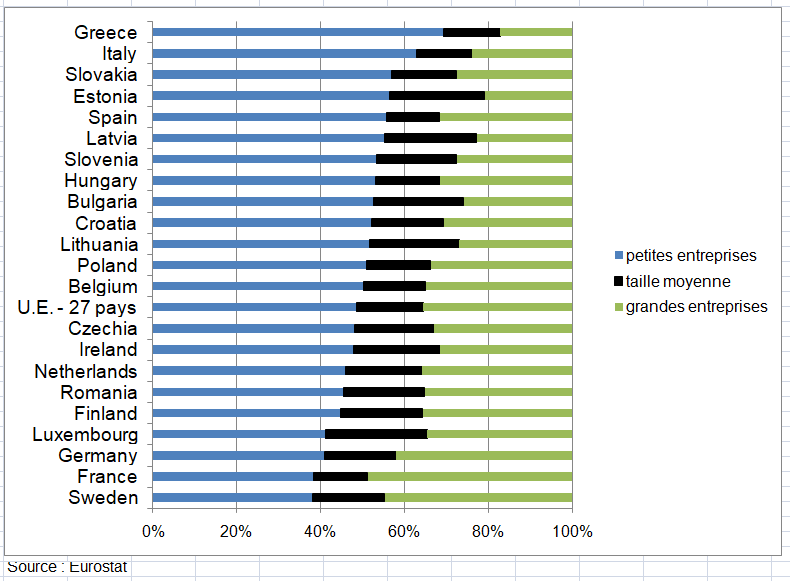
Répartition de la valeur ajoutée dans l’UE par taille d’entreprises en 2019 en %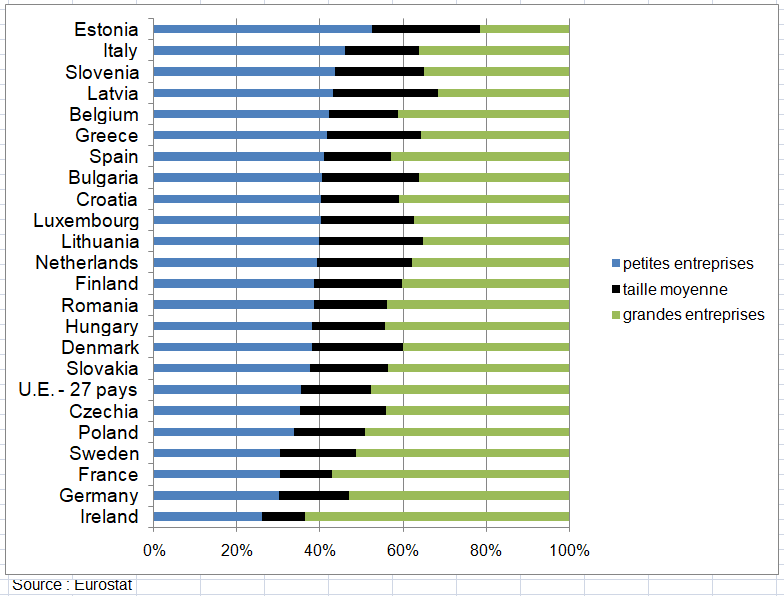
c) Démographie des entreprises dans l’UE
La démographie des entreprises est un terme utilisé pour étudier les caractéristiques de la population des entreprises. La création (ou la naissance) de nouvelles entreprises et la fermeture (ou la mort) d’entreprises sont des indicateurs importants ladynamique des entreprises. Si l’on examine les taux de création dans l’UE, le nombre d’entreprises nouvellement créées en proportion du nombre total d’entreprises actives a diminué en 2020 par rapport à 2019. Les taux de création variaient de 4,6 % en Grèce à 18,1 % en Lituanie. En France, ce taux était assez élevé : 11,3%. Pour les deux années, 2019 et 2020, le taux de natalité était faible en Grèce, en Autriche, en Italie, en Suède et en Belgique. À l’autre extrémité de l’échelle, des taux de natalité élevés pour les deux années ont été enregistrés en Lituanie, à Malte et au Portugal. La comparaison des deux années révèle que le taux de natalité n’a augmenté que dans 6 des États membres et a diminué dans 20 États membres.
Taux de création d’entreprises, économie marchande, 2019 – 2020 (%)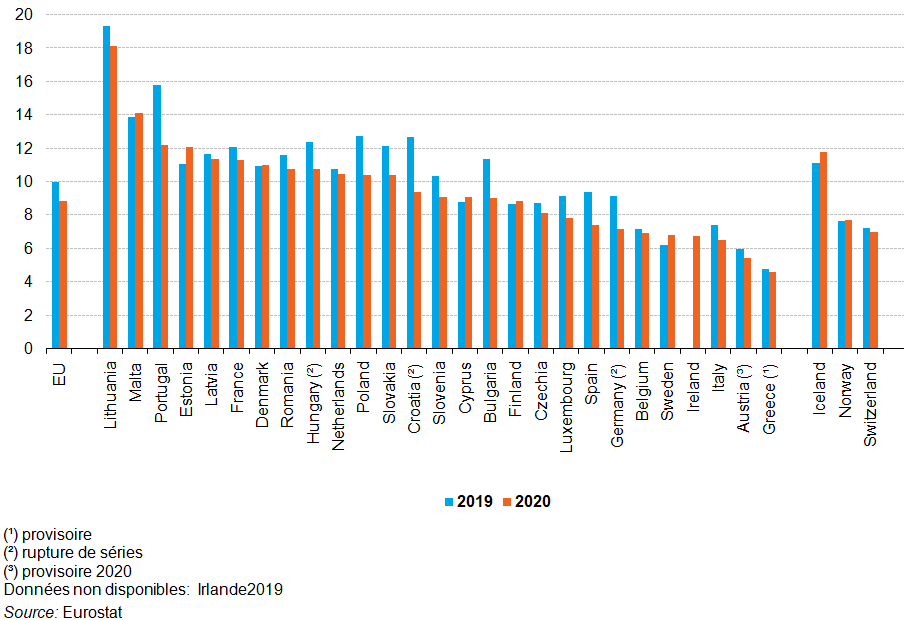
d) Taux de survie des entreprises
L’objectif ici est de présenter des informations sur le cycle de vie des entreprises naissantes et leur capacité à survivre jusqu’à cinq ans après leur création. La collecte de données sur la démographie des entreprises de 2012 a permis de suivre les entreprises nouvellement créées sur une période de cinq ans, en retraçant combien d’entre elles ont survécu pendant cette période. Le graphique suivant montre les taux de survie à un, trois et cinq ans des entreprises en 2020.
Entreprises survivant sur une période de cinq ans, économie marchande, 2020 (%)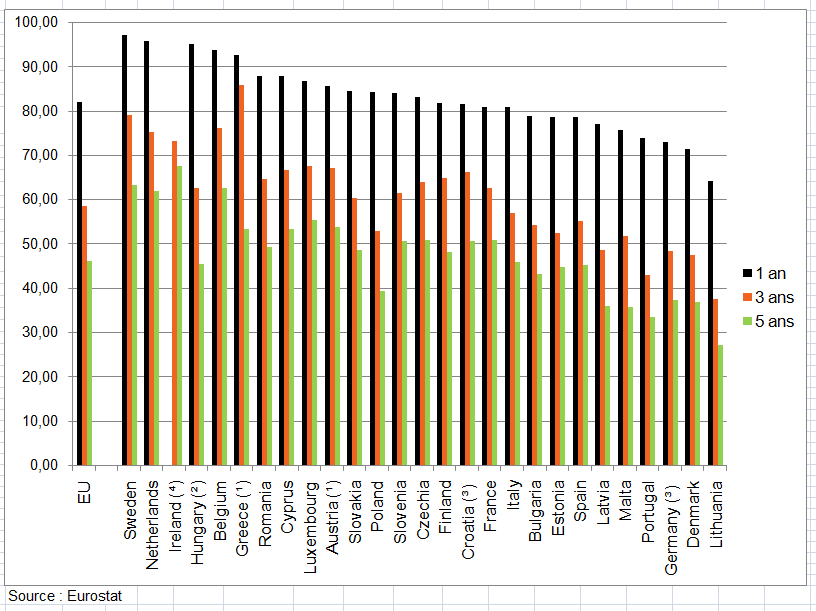
Si l’on examine le taux de survie à un an, il apparaît que, pour l’économie marchande, environ 82 % des entreprises nées en 2019 avaient survécu en 2020. Les taux de survie à un an les plus élevés ont été enregistrés pour l’économie marchande en Suède (97,1 % ) et aux Pays-Bas (95,7 %), avec des taux également supérieurs à 90 % en Hongrie, en Belgique et en Grèce. Les taux les plus bas ont été signalés en Lituanie (63,2 %) et au Danemark (71,3 %).
Par la suite, les taux de survie d’une année sur l’autre ont affiché une baisse progressive dans tous les pays disposant de données. Le taux de survie à cinq ans des entreprises nées en 2015 et toujours actives en 2020 montre que généralement moins de la moitié d’entre elles survivent pendant une période de cinq ans. Les entreprises créées en 2015 en Irlande, en Suède, en Belgique et aux Pays-Bas étaient les plus susceptibles de survivre jusqu’à la cinquième année après leur naissance, tandis que celles de Lituanie couraient le plus grand risque de non-survie. En principe, les non-survies peuvent être dues à des décès réels, indiquant la détérioration de l’environnement des affaires, mais aussi à des à des fusions.
Sachant que les taux de survie décroissent logiquement sur 5 ans dans tous les pays pour lesquels des données sont disponibles, il reste intéressant de regarder l’évolution de l’emploi sur une période de 5 ans. Pour chaque pays du graphique 6, la deuxième barre montre l’évolution de l’emploi. Dans seulement neuf États membres de l’UE (Finlande, Chypre, Danemark, Pays-Bas, Italie, Bulgarie, Malte, Lettonie, Luxembourg), ainsi qu’en Islande et en Norvège, l’emploi a augmenté dans les entreprises qui ont survécu pendant cinq ans. Les baisses les plus importantes ont été observées en Suède, en Belgique et en France.
e) Les faillites
1 -Dans l’UE
Les données annuelles de faillites ont été publiées pour la première fois par Eurostat. Les données annuelles sont calculées par Eurostat, comme la somme des quatre trimestres, transmises par les pays conformément aux exigences du règlement européen sur les statistiques d’entreprises. Seul le nombre total de faillites est publié par pays, sans ventilation NACE.
En France, les faillites, déjà relativement nombreuses, ont augmenté sensiblement en 2022 (+50%), sans atteindre leur niveau d’avant 2020, mais bien plus que dans les autres pays étudiés ( à peine +14%) sauf l’Autriche.
Déclarations de faillite des entreprises dans les pricipaux pays de l’Europe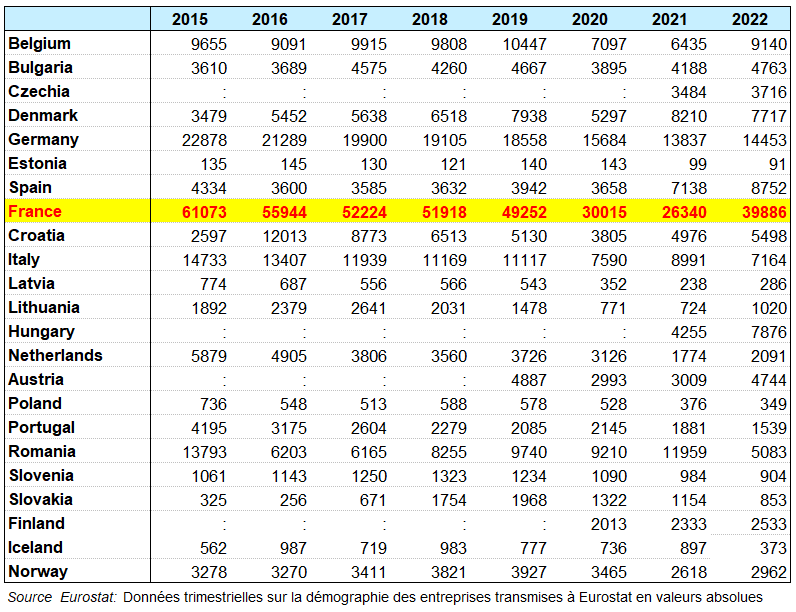
Au troisième trimestre 2022, le nombre corrigé des variations saisonnières d’immatriculations d’entreprises a augmenté de 2,6 % dans l’UE et de 1,4 % dans la zone euro, par rapport au deuxième trimestre 2022. Au deuxième trimestre 2022, le nombre de les immatriculations d’entreprises ont diminué de 0,7 % dans l’UE et de 1,6 % dans la zone euro, par rapport au premier trimestre 2022
Pour l’ensemble de l’économie (industrie, construction, services marchands), le nombre de déclarations de faillites a affiché une tendance à la baisse en 2015 et 2016, puis s’est principalement orienté à la hausse du premier trimestre 2017 jusqu’au troisième trimestre 2019. Au troisième trimestre 2022, le nombre corrigé des variations saisonnières de déclarations de faillite a augmenté de 16,3 % dans l’UE et de 19,2 % dans la zone euro, par rapport au deuxième trimestre 2022. Au deuxième trimestre 2022, les déclarations de faillite ont augmenté de 2,9 % dans l’UE et de 2,8 % dans la zone euro par rapport au premier trimestre 2022
Créations d’entreprises (en bleu) et déclarations de faillites (en rouge) dans l’UEQ1 2015 – Q1 2023, données corrigées des variations saisonnières (2015=100)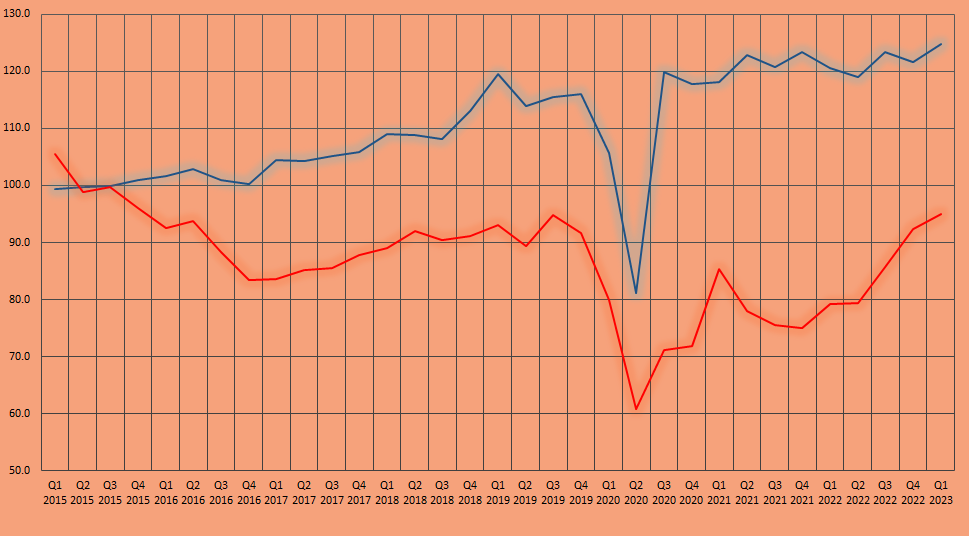
Source : Eurostat
Pour l’ensemble de l’économie (industrie, construction, services marchands), le nombre de déclarations de faillite s’est orienté à la baisse en 2015 et 2016, puis s’est principalement orienté à la hausse du premier trimestre 2017 jusqu’au troisième trimestre de 2019. Dans tous les secteurs de l’économie, il y a eu une diminution des déclarations de faillite au cours des deux premiers trimestres de 2020 (liée au soutien financier extraordinaire apporté par les gouvernements dans les premiers mois de la pandémie). Puis, au cours des deux derniers trimestres 2020, les déclarations de faillite ont augmenté de manière continue dans tous les secteurs de l’économie à l’exception de l’industrie, et du commerce (qui a diminué au quatrième trimestre 2020).
Au cours de l’année 2022, les déclarations de faillite ont été principalement orientées à la hausse pour tous les secteurs de l’économie.
Au premier trimestre 2023, les faillites ont augmenté dans la construction, et dans une moindre mesure dans l’information et la communication, les activités financières et d’assurance, l’industrie et l’éducation/santé, tandis qu’elles ont diminué dans l’hébergement et la restauration, les transports et le commerce (graphique suivant).
Déclarations de faillites d’entreprises par activité (données désaisonnalisées), T1 2015 à T3 2022 (2015=100)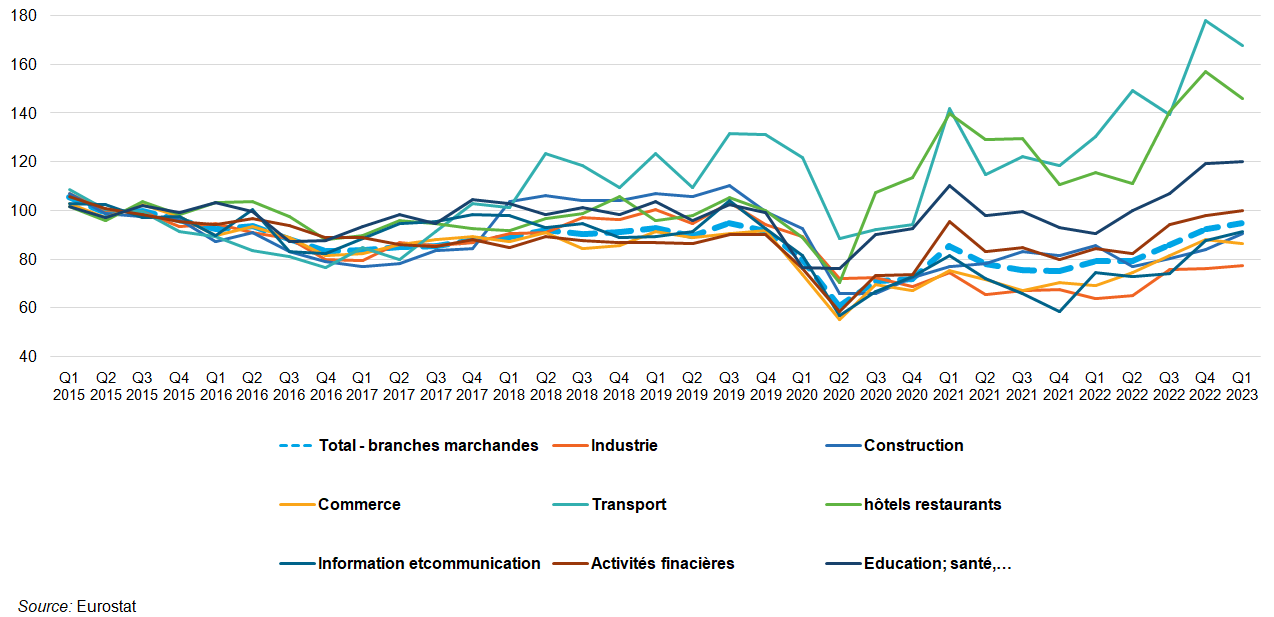
2 – En France
En juillet près de 50000 entreprises ont fait faillite (+43,6% par rapport à juillet 2022) (tableau suivant). Dans un contexte marqué par une inflation galopante qui asphyxie le pouvoir d’achat des Français, cette spirale de faillites massives, risque vraisemblablement de se poursuivre et de s’accélérer au cours des mois à venir. Plus que jamais, il est donc temps de réfléchir aux vraies réformes qui pourront réanimer notre économie.
Le nombre de défaillances annuel reste toutefois bien inférieur au niveau moyen enregistré sur la période 2010-2019 (59 342), avant la pandémie de COVID-19. Les défaillances ont, en effet, fortement reculé à compter du début de la crise sanitaire, à la suite de la modification temporaire des dates de caractérisation et de déclaration de l’état de cessation de paiements, puis des mesures publiques de soutien en trésorerie permettant d’éviter cet état de cessation des paiements.
Dans le détail, ce phénomène affecterait avant tout (à 90 %) les patrons de petites structures de moins de cinq salariés. Toutefois, il est à noter que les pertes d’emplois chez les chefs d’entreprises de plus de 20 salariés, qui avaient diminué pendant la crise liée au covid, ont doublé au premier semestre par rapport à l’année dernière, et que les dirigeants de grandes structures ne sont, eux aussi, plus épargnés par la menace du chômage.
Les secteurs les plus durement touchés par les faillites sont ceux du commerce et de la construction, avec respectivement 10987 et 10181 défaillances en juillet 2023 (autour de +40% sur un an) : exigences des nouvelles normes environnementales, augmentation des taux d’intérêts d’emprunt, pénurie de matériaux, flambée des prix et donc des coûts de construction, mais aussi baisse du nombre de commandes…, les raisons pour expliquer ce désastre ne manquent pas. Mais le secteur de l’hôtellerie-restauration connaît la plus forte hausse sur un an : +70% et 7000 défailllances d’entreprises.
Défaillances d’entreprises par secteur d’activité (Défaillances en nombre d’unités légales), glissement en %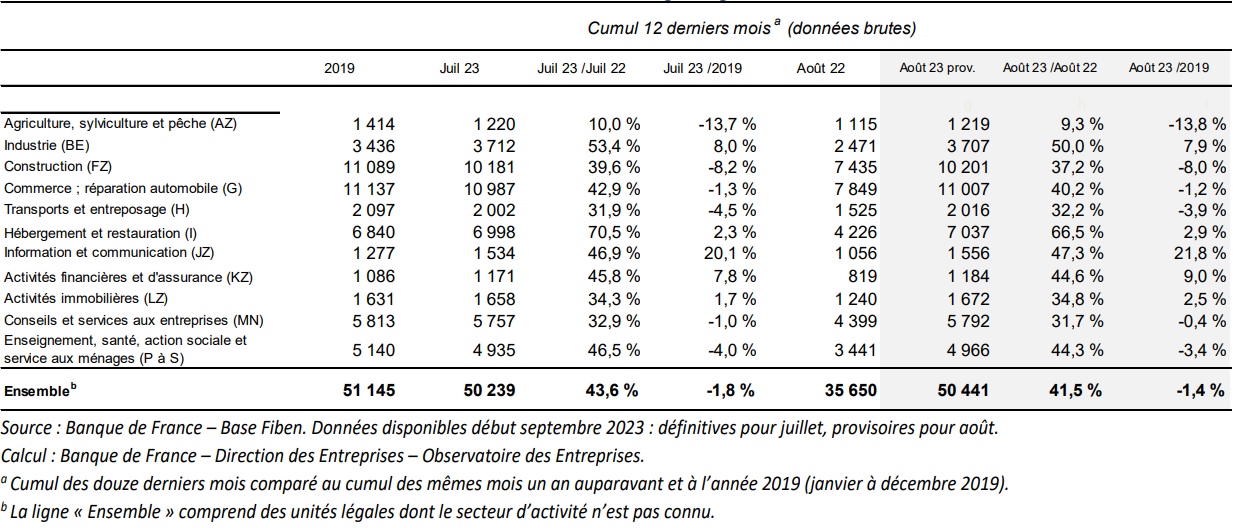
e) Entreprises à forte croissance
Les entreprises à forte croissance (croissance de l’emploi de 10 % ou plus) jouent un rôle important dans la contribution à la croissance économique et à la création d’emplois. En 2020, environ 135 000 entreprises, soit près d’un dixième (9,4 %) de toutes les entreprises actives comptant au moins dix salariés dans l’ économie marchande de l’UE étaient reconnues comme des entreprises à forte croissance.
En 2020, des variations considérables ont été observées entre les États membres de l’UE dans la répartition des entreprises à forte croissance (graphique suivant). Les parts allaient de plus de 15,7 % en Suède à moins de 2 % en Roumanie.
Bien que les graphiques précédents ne les fassent pas vraiment apparaître, plus d’un million d’entreprises françaises ont moins de 8 ans en 2018. 95 % de ces jeunes entreprises sont de très petites entreprises (TPE) et elles sont en moyenne très jeunes (moins de 3 ans). Ces starts-up seraient souvent des entreprises innovantes, ayant bénéficié d’au moins une aide à la R&D ou à l’innovation (crédit d’impôt recherche ‑ CIR, crédit d’impôt innovation ‑ CII, dispositifs jeune entreprise innovante ‑ JEI ‑ et jeune entreprise universitaire ‑ JEU, concours d’innovation i‑Lab et aides à l’innovation de Bpifrance).
Part des entreprises à forte croissance dans les États membres de l’UE, 2020 (%)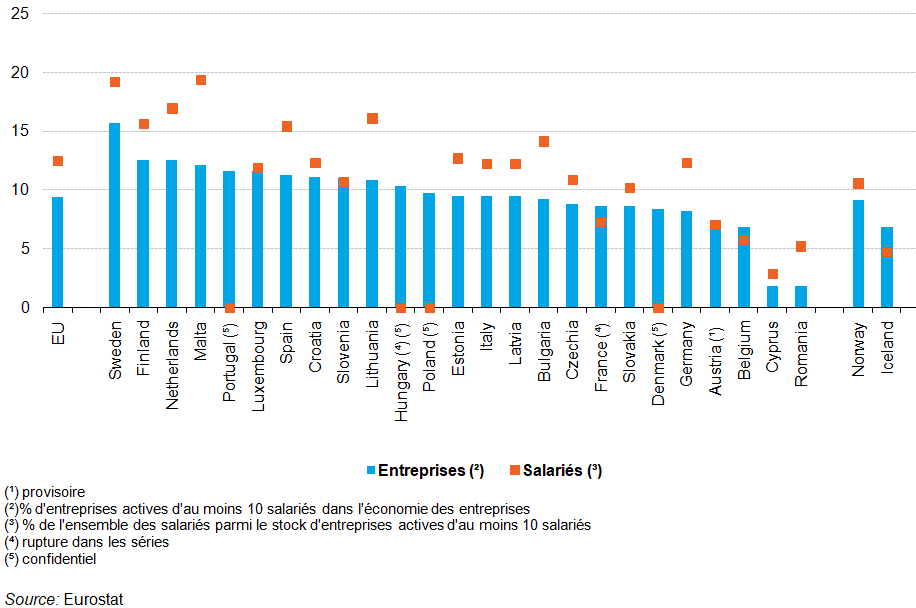
2/ l’apparail productif français
Selon une étude de l’Insee déjà citée, l’appareil productif français en 2019 apparaît toujours très concentré : quelques milliers de multinationales génèrent à elles seules plus de la moitié de la valeur ajoutée et sont à l’origine de près de 90 % des exportations. A contrario, le tissu économique local est constitué de plusieurs millions de PME, dont la très grande majorité sont des micro-entreprises : près des trois quarts d’entre elles ne disposent d’aucun salarié et on comptabilise près de 2 millions d’entreprises individuelles. L’organisation en groupe de sociétés n’est pas réservée aux seules entreprises de grande taille : près d’une PME hors micro-entreprises sur deux a opté pour ce mode d’organisation. La tertiarisation du système productif est massive, y compris dans l’industrie ou la construction, deux secteurs dans lesquels les grands groupes intègrent de plus en plus de filiales tertiaires.
Durant les cinq années précédant la crise sanitaire (2015‑2019), la situation moyenne des entreprises s’est améliorée : des gains de productivité dans l’ensemble des secteurs (+ 8 %), en particulier dans l’industrie (+ 12 %) et le commerce (+ 12 %) ; un partage de la valeur ajoutée plus favorable aux entreprises, notamment dans l’industrie, le commerce et la construction (le taux de marge y progresse respectivement de 1,6 point, 2,3 points et 3,0 points) ; une nette hausse du taux d’investissement dans tous les secteurs (+ 1,8 point) ; enfin, sont comptabilisées de très nombreuses créations d’entreprises (+ 55 %) ainsi qu’un net recul des défaillances (– 18 %).
Au‑delà de ce diagnostic global portant sur l’ensemble du système productif avant la crise, la situation économique des TPE‑PME indépendantes montre certaines spécificités en comparaison avec le reste des entreprises sur la période 2015‑2019 : absence de gains de productivité en moyenne sur la période ; amélioration plus marquée du taux de marge moyen (en partie liée aux mesures de baisse du coût du travail ciblées sur les bas salaires) même si un tiers d’entre elles enregistrent des pertes d’exploitation en 2019 (contre 16 % pour le reste des entreprises) ; taux d’investissement atone en dépit d’un taux d’autofinancement moyen supérieur à 100 %.
Quant à la situation financière de l’ensemble des TPE‑PME, elle n’a cessé de s’améliorer en moyenne sur la période 2015‑2019, tant en matière de liquidité (trésorerie plus abondante en fin de période) que de solvabilité (renforcement des fonds propres couplé à un net désendettement financier). Cependant certaines TPE‑PME se trouvent encore dans des situations financières difficiles en 2019 : ainsi 38 % rencontrent des problèmes de liquidité pour financer leur cycle d’exploitation et 29 % déclarent des problèmes de solvabilité (fonds propres négatifs ou taux d’endettement financier supérieur à 200 %). Qui plus est, au sein des TPE‑PME indépendantes, la proportion d’entre elles faisant face à des problèmes de liquidité ou de solvabilité en 2019 est plus élevée dans les secteurs qui seront en 2020‑2021 les plus exposés à la crise (hébergement‑restauration, services à la personne, commerce de détail, construction, etc.)
a) En France, les multinationales génèrent à elles seules plus de la moitié de la valeur ajoutée
1 – Structure des entreprises en France
En France, quatre catégories d’entreprises sont définies pour les besoins de l’analyse statistique et économique :
Pour déterminer la catégorie à laquelle une entreprise appartient, les données suivantes, afférentes au dernier exercice comptable clôturé et calculées sur une base annuelle, sont utilisées : l’effectif, le chiffre d’affaires et le total du bilan.
Les petites et moyennes entreprises (PME) sont celles qui, d’une part, occupent moins de 250 personnes, d’autre part, ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 43 millions d’euros. Parmi elles, les micro-entreprises occupent moins de 10 personnes et ont un chiffre d’affaires annuel ou un total de bilan n’excédant pas 2 millions d’euros.
Les entreprises de taille intermédiaire (ETI) sont des entreprises qui n’appartiennent pas à la catégorie des PME et qui, d’une part, occupent moins de 5 000 personnes, d’autre part, ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 1 500 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 2 000 millions d’euros.
Les grandes entreprises (GE) sont des entreprises non classées dans les catégories précédentes.
En 2020, en France, les secteurs marchands non agricoles et non financiers comptent près de 4,2 millions d’entreprises, dont près de 112 300 sont organisées en groupe. Ces dernières entreprises, constituées de plusieurs sociétés (une ou des filiales et une tête de groupe), rassemblent au total 300 000 unités légales implantées en France. En sus de ces unités légales organisées en groupe, le tissu productif compte près de 4,1 millions d’unités légales dites indépendantes, dont 55 % correspondent à des entreprises individuelles, le reste étant des sociétés. Moins de 300 entreprises concentrent un tiers de la valeur ajoutée et de l’emploi en France
En 2020, le système productif apparaît toujours aussi concentré : les 273 grandes entreprises (GE) génèrent à elles seules un tiers du chiffre d’affaires (CA), 31 % de la valeur ajoutée (VA) et emploient 29 % des salariés en France (tableau suivant). Elles sont par ailleurs à l’origine de plus de la moitié des exportations françaises et représentent 38 % de l’investissement en actifs corporels. La quasi–totalité des GE correspondent à la partie française de firmes multinationales (FMN) : 72 % sont sous contrôle français et 28 % sous contrôle étranger.
Chiffres clés caractérisant la structure de l’appareil productif français en 2020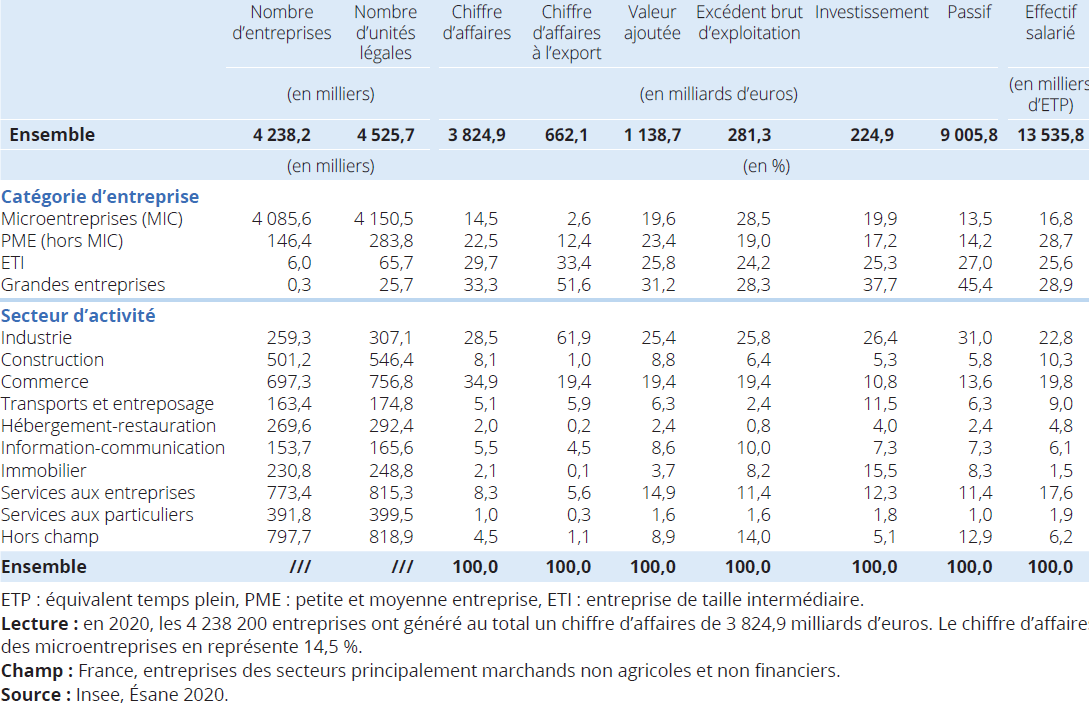
Les entreprises de taille intermédiaire (ETI) regroupent 6 000 entreprises en 2020 et représentent 26 % de la valeur ajoutée, de l’investissement et de l’emploi salarié. Elles jouent un rôle particulièrement important dans les exportations (en particulier de biens industriels), en enregistrant à elles seules un tiers des exportations totales. Près des deux tiers des ETI correspondent à la partie française de firmes multinationales.
Les petites et moyennes entreprises (PME)3, au nombre de 146 400 en 2020, sont organisées, pour près de la moitié, en groupe de deux ou trois sociétés. Les PME emploient 29 % des salariés en France mais, souvent moins capitalistiques que les ETI, elles ne génèrent au total que 23 % de la valeur ajoutée totale. Leur poids dans les exportations et l’investissement est plus modeste (respectivement 12 % et 17 %).
Enfin, les 4 085 600 micro-entreprises (MIC) constituent la très grande majorité des entreprises implantées en France en 2020 et assurent des fonctions essentielles dans la vie économique locale (artisans, commerces de proximité, services à la personne et aux entreprises, etc.). Une très grande majorité d’entre elles n’emploient aucun salarié (78 %), si bien que leur part dans l’emploi salarié total apparaît faible (17 %) eu égard à leur nombre. Très dispersées sur le territoire national, elles comptabilisent au total un cinquième de la valeur ajoutée.
2 – Les ETI et les grandes entreprises, au coeur du système français de production industrielle
En 2020, seules 6 % des entreprises ont une activité de production industrielle. Cependant, l’industrie regroupe de nombreuses GE et ETI. La définition économique des entreprises (loi LME de 2008) conduit donc à intégrer à l’estimation de leur activité celle de leurs filiales non industrielles. Finalement, le secteur industriel ainsi considéré emploie à lui seul 23 % des salariés en France et génère 25 % de la valeur ajoutée totale, dont l’essentiel (20 % des salariés et de la valeur ajoutée) dans l’industrie manufacturière.
Le secteur de la construction, qui rassemble près de deux fois plus d’entreprises que l’industrie,montre un visage assez différent. Avec une majorité de microentreprises ou de PME, le secteur a une contribution nettement moindre à la valeur ajoutée nationale que l’industrie (9 %). Par ailleurs, le secteur comprend quelques très grandes entreprises, constituées de nombreuses filiales, dont plusieurs exercent des activités très diverses et ne relevant pas de la construction (extraction de minerai, transport, commerce, fonctions support, etc.).
Le tissu productif français est largement dominé par les activités tertiaires. Au sein du tertiaire, les secteurs souvent en contact direct avec les ménages sont nombreux : commerce, transports et entreposage, et parmi les services marchands, l’hébergement–restauration, l’immobilier et les services aux particuliers. Ils totalisent près de 37 % de l’emploi salarié et génèrent 33 % de la valeur ajoutée nationale.
Davantage en contact direct avec les entreprises, les secteurs de l’informationcommunication et des services aux entreprises représentent à eux seuls 24 % de l’emploi salarié (les salariés y travaillant sont souvent des cadres très qualifiés) et génèrent 24 % de la valeur ajoutée nationale. Ils participent de près au développement des entreprises et de leur capacité d’innovation (notamment dans les technologies de l’information et la communication (TIC)).
Le niveau de concentration varie selon les secteurs d’activité. Les secteurs de l’énergie, des transports et de l’information‑communication sont les plus concentrés (présence de monopoles, d’oligopoles,etc.). Il est fréquent de trouver de telles structures de marché dans les secteurs où la technologie de production induit des coût fixes très élevés, à l’instar des secteurs de l’énergie (par exemple : centrales nucléaires), des transports (grandes infrastructures) ou des télécommunications. Ces secteurs dits stratégiques sont encore aujourd’hui sous l’héritage des grandes entreprises nationales (GEN) créées après la seconde guerre mondiale.
3 – Les multinationales concentrent près de 90 % des exportations
En 2019, les firmes multinationales concentrent à elles seules 89 % du chiffre d’affaires à l’export (graphique suivant). Ces entreprises disposant de filiales à l’étranger, une partie des exportations leur est directement destinée. Dans certains secteurs industriels, la chaîne de valeur mondiale peut être longue et les échanges commerciaux entre filiales d’un même groupe très importants. Les firmes multinationales affichent un taux d’export de 28 % (45 % dans l’industrie et 16 % dans les services marchands). Dans les firmes multinationales industrielles, l’essentiel des exports transitent via des filiales spécialisées du commerce de gros. À l’inverse, l’activité des groupes franco‑français est moins orientée vers l’international : ils sont en effet très présents dans des secteurs davantage tournés vers le marché domestique, à l’instar de la construction, de l’hébergement‑restauration ou de l’immobilier. Quant aux unités légales indépendantes, la majorité d’entre elles n’ont pas les moyens d’accéder aux marchés internationaux : seules 4 % ont exporté en 2019 (contre près de la moitié des firmes multinationales et 18 % des groupes franco‑français.
Chiffre d’affaires à l’export selon le type de groupe en 2019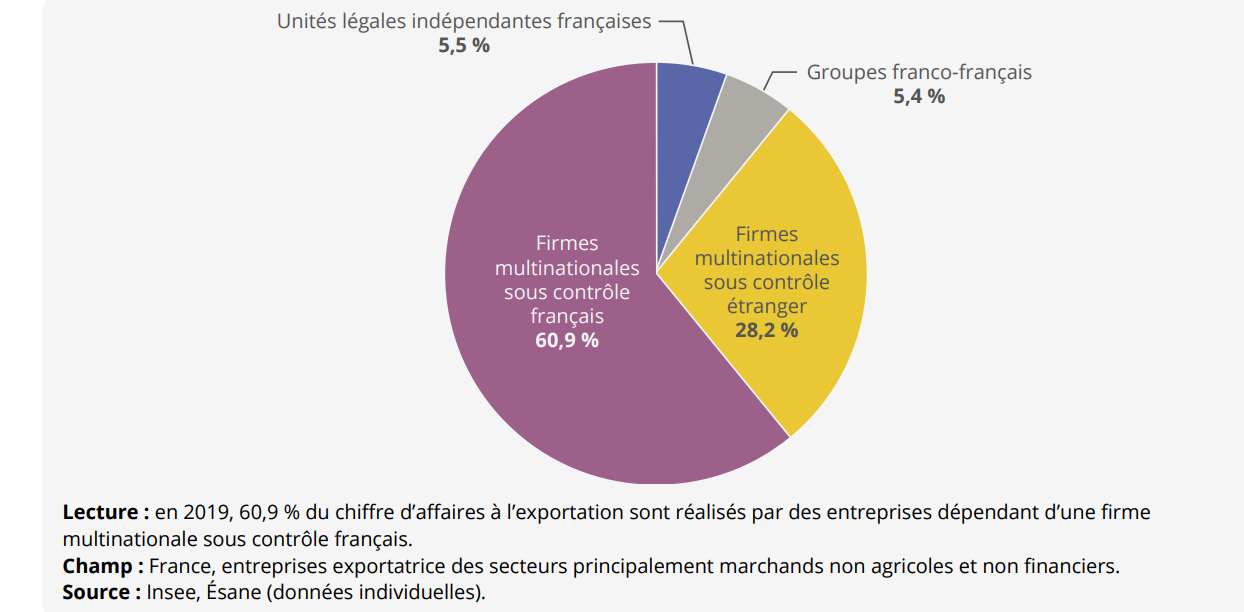
4 – Près de la moitié des PME, hors micro-entreprises (MIC), sont organisées en groupe
Le système productif compte 4,1 millions de petites et moyennes entreprises (PME), dont 3,9 millions de micro-entreprises. Si la très grande majorité des MIC sont constituées d’une seule unité légale, près de la moitié des PME non micro-entreprises ont opté pour l’organisation en groupe. Ce phénomène est observé depuis plusieurs décennies et prend de l’importance pour plusieurs raisons : la structuration en groupe permet de mieux gérer le risque, de rationaliser l’organisation, de faciliter la transmission ; elle peut aussi traduire l’attrait des investisseurs étrangers pour le rachat de sociétés de petite taille: 40 % correspondent à des groupes franco‑français et 8 % à des segments de groupes multinationaux. Ces petits groupes ne sont constitués en moyenne que de deux sociétés. Pour une PME de moins de 100 salariés, plus elle est grande (en matière d’effectifs salariés), plus sa probabilité d’être organisée en groupe est élevée, mais au-delà de 100 salariés, la très grande majorité des PME sont organisées en groupe (graphique suivant). En effet, Il existe des effets de seuil relatif au nombre de salariés dans la PME : en deçà de certains seuils (comme par exemple celui de 50 salariés) la formation des groupes s’intensifie et au-delà, les filiales se multiplient dans les groupes déjà constitués. Le choix de l’organisation en groupe peut résulter d’une stratégie d’optimisation des PME vis-à-vis du cadre réglementaire (seuils sociaux, etc.).
5 – Baisse de la rentabilité des entreprises en 2020
La rentabilité économique mesure la rentabilité d’exploitation (activité) de l’entreprise indépendamment de son mode de financement. Elle se mesure en rapportant l’excédent brut d’exploitation à la somme des immobilisations brutes corporelles et incorporelles et du besoin de fonds de roulement. La somme au dénominateur est appelée « actif économique » ou « capital économique » : elle représente en effet les moyens engagés par l’entreprise dans les cycles d’exploitation et d’investissement, autrement dit ce dont l’entreprise a besoin pour tourner. Ce taux n’est pas affecté par la structure financière de l’entreprise.
La rentabilité financière mesure la capacité des capitaux investis par les actionnaires et associés (capitaux propres) à dégager un certain niveau de profit.
La rentabilité économique, indicateur mesurant la capacité du capital physique à générer un revenu d’exploitation pour l’entreprise, a baissé de 1,6 point en 2020, après être restée relativement stable depuis 2014 (graphique suivant). La baisse concerne toutes les catégories d’entreprises. La rentabilité financière a également reculé en 2020 (– 3,6 points), de façon plus marquée que la rentabilité économique.
L’effet de levier financier a pu jouer négativement en 2020 dans les ETI‑GE, ce qui a induit une baisse de la rentabilité financière plus prononcée que celle de la rentabilité économique, notamment. D’ailleurs, à l’instar de ce qui a été observé pour l’évolution du taux de marge, le recul de la rentabilité financière en 2020 est d’autant plus marqué que les entreprises sont grandes.
Variation annuelle de la rentabilité selon la catégorie d’entreprise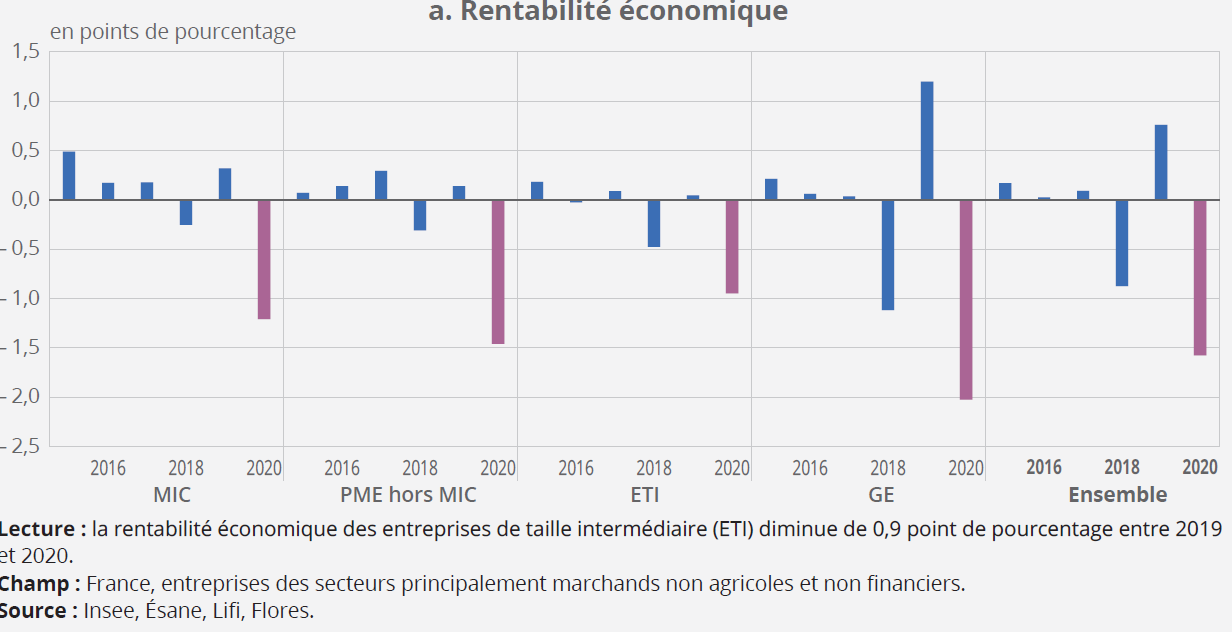
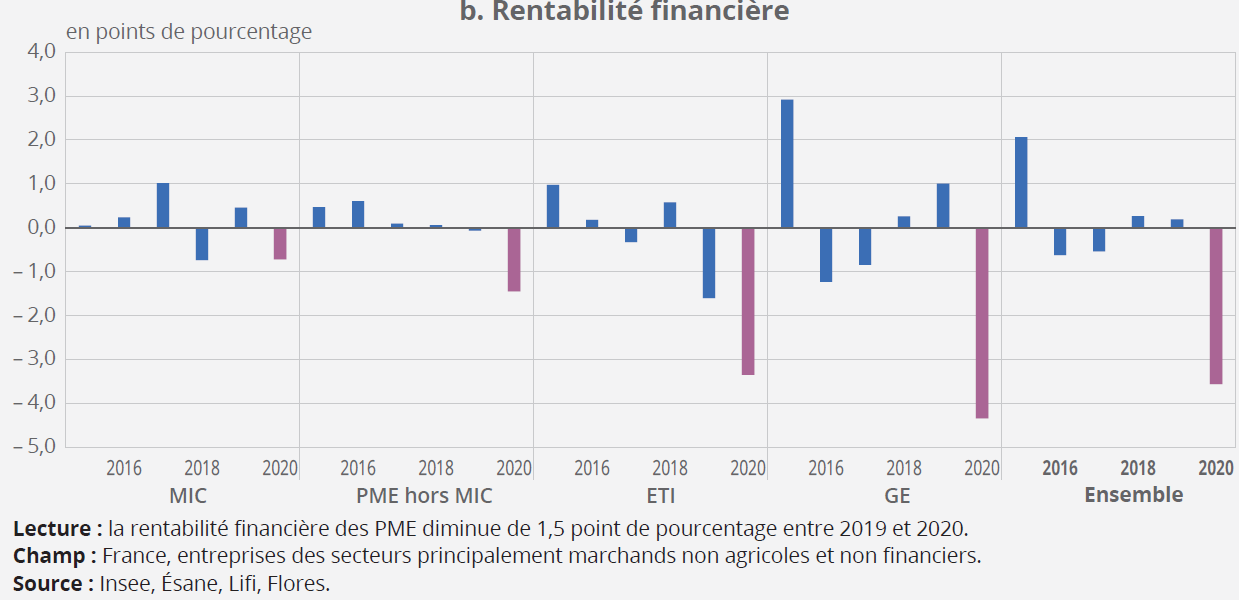
Michel Braibant
[1] M. Aglietta, la globalisation financière, http://www2.cepii.fr/PDF_PUB/em/2000/em2000-05.pdf voir aussi Réguler la financiarisation de l’économie, https://www.andese.org/contributions/chroniques-de-nadia-antonin/466-reguler-la-financiarisation-de-l-economie.html, voir aussi la financiarisation en perspective, Ben Fine, https://www.cairn.info/revue-actuel-marx-2012-1-page-73.htm
[2] Denis Clerc, https://www.cairn.info/revue-l-economie-politique-2009-2-page-105.htm#
[3] D. Gallo Lassere, https://silogora.org/financiarisation-de-leconomie/
[4] https://iris-recherche.qc.ca/blogue/quest-ce-que-la-financiarisation-de-leconomie
[5] Expanding the Integrated Macroeconomic Accounts’ Financial Sector, R.t J. Kornfeld, L. Lynn, and T.i Yamashita, January 2016, BEA , http://Expanding the Integrated Macroeconomic Accounts’ Financial Sector, voir aussi https://iris-recherche.qc.ca/wp-content/uploads/2021/04/Brochure_Financiarisation_WEB.pdf
[6] https://www.lafinancepourtous.com/decryptages/crises-economiques/crise-des-subprimes/crise-financiere/comment-la-crise-s-est-elle-propagee/ voir aussi https://blogs.alternatives-economiques.fr/les-economistes-atterres/2023/06/28/la-repartition-de-la-valeur-ajoutee-ou-en-est-on-ou-va-t-on
[7] rapport au CNIS « Coût du capital, O. Garnier, R. Mahieu, JP Villetelle »; juillet 2015″, https://www.cnis.fr/wp-content/uploads/2017/10/RAP_2015_139_cout-du-capital.pdf
[8] https://www.anti-k.org/2018/10/30/michel-husson-mystere-ou-sont-passes-les-dividendes/, lire aussi Le difficile comptage des dividendes, J. Bournay, M. Husson, O. Chagny, ADE, N° 120, mars 2015.
[9] https://www.insee.fr/fr/statistiques/4497265?sommaire=4494218, voir aussi les entreprises en France, Insee, édition 2022, https://www.insee.fr/fr/statistiques/6667157 voir aussi https://www.insee.fr/fr/statistiques/6967914?sommaire=6966784